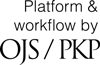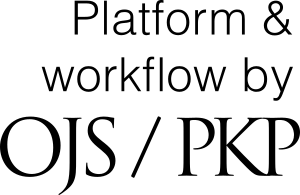Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
Bonnes feuilles
|
Planète interdite. Sur le voyage et la mobilité en temps de confinement suivi de
|
|
|
L’Être et le mouvement D’entre tous ses usages possibles, et afin de prendre du recul face à la diversité des modes d’enfermement de l’homme par l’homme — que l’homme enfermé et l’homme qui enferme soient le même ou un autre —, il faut distinguer des genres et des espèces de confinement. Il ne s’agira ici que de notes, suggestions et réflexions sur ce concept. Sa nature, les avatars de ses recours et de leurs valeurs. Ses multiples utilisations, ordinaires, extraordinaires ou infra-ordinaires — qui ont échappé à notre attention ou notre conscience1. Cela pour souligner la dimension anthropologique de l’acte et l’intérêt de le reconsidérer dans un cadre général. Car sémantiquement complexe, l’acte est protéiforme et révèle des modèles culturels déterminant son emploi et des tendances sociales qu’il reflète. Le concept de confinement mérite d’être pris en considération au même titre que les pratiques de la mobilité, des déplacements dans l’espace, mais aussi de l’alimentation, de la sexualité, du costume ou de l’habitat. L’acte d’enfermer a valeur de symptôme. Entre autres signes, à travers lui c’est une société qui dévoile sa logique, et même la trahit. |
1 Cf. Georges Perec, « L’Infra-ordinaire », Cause commune, 5, 1973. |
|
Aux origines d’un procédé complexe En amont de ses genres et espèces, le confinement, comme pratique universelle d’enfermement de l’homme par l’homme, est un procédé qui entre tout d’abord pleinement dans le champ de l’anthropologie de la mobilité. Ceci n’est pas une contradiction. Car le confinement, d’une part, ne serait pas si la mobilité n’existait pas : il ne peut signifier que par rapport à elle. Et d’autre part, le confinement n’est pas son simple contraire. Son vulgaire antonyme du point de vue linguistique ; ou son interruption sommaire du point de vue physique. Il n’est donc pas l’objet opposé d’une anthropologie inversée de l’immobilité. Il y a presque toujours, si limitée soit-elle, de la mobilité dans le confinement. Sauf recours à des formes extrêmes, le confinement ne tue pas le mouvement. Son but n’est pas de le détruire. Dans la plupart des cas il est plus subtil que cela, y compris dans ses manipulations répressives. Si exceptionnellement il annule la mobilité, en général il la réduit de façon mesurée, au prorata de la privation de liberté qui lui est associée. C’est ainsi qu’on peut bel et bien être confiné et encore mobile néanmoins, à l’instar du prisonnier marchant en rond dans la cour du pénitencier ou dans sa cellule, comme un lion en cage, mais aussi comme Montaigne marchant dans sa librairie pour mieux stimuler ses pensées, qui « dorment si je les assis ». Exception faite de l’immobilisation totale du corps, par des cordes, des sangles, des garrots, des bâillons sur la bouche, des menottes aux poignets, des chaînes aux chevilles, des camisoles physiques ou chimiques et autres entraves de contention — auxquelles peut s’ajouter l’immobilisation par ensevelissement, soudain sous les décombres d’un immeuble ou d’un tunnel effondrés, ou par séquestration prématurée dans un cercueil, cas horrifiques des enterrés vivants —, en général, si restreint que soit son espace, le confinement ne signe pas la fin du mouvement de façon systématique. C’est pourquoi ce procédé entre de plein droit dans le champ de l’anthropologie de la mobilité. L’usage du confinement comme procédé consiste en premier lieu à instaurer une situation qui se définit comme un état de mobilité restreinte. Une limitation qui touche à la circulation de tout un chacun en portant atteinte à l’étendue de son libre exercice. Faisant obstacle à l’exercice habituel des déplacements du corps, le confinement altère de diverses manières le mouvement des êtres, de par le monde en général, au sein de la vie sociale en particulier, prohibant en ce cas l’accès à l’espace de tous les contacts, rencontres et échanges avec autrui. L’espace même de la communication. Entravant cette dernière, le confinement implique la contraction de l’étendue naturelle et sociale au profit d’un espace réduit dédié à une mobilité circonscrite, isolée et séparée du monde et des autres par une clôture, un seuil, une borne, une frontière à ne pas franchir. Une limite à ne pas outrepasser. Ce que rappelle l’étymologie du mot « confins », du latin confinium, signifiant « limite commune à des champs, à des territoires »2. |
2 Dictionnaire historique de la langue française (dir. Alain Rey), 2010. |
|
Avant de rendre impossible tout mouvement par un moyen radical de totale immobilisation du corps, la situation de confinement se loge dans un espace clos de dimension restreinte laissant une place, si résiduelle soit-elle, à de la mobilité. En deçà du degré absolu de confinement qu’assure la camisole (enfermement à l’échelle du corps), qui relève de la contention la plus intime de l’être (sa capacité de mouvement étant annihilée), la privation de mouvement par limitation spatiale peut s’étendre de l’interdit de sortie du territoire (enfermement à l’échelle d’un pays, d’un état, d’une nation) en passant par des échelles intermédiaires comme l’assignation à résidence (à l’échelle de l’habitat, du quartier, de la ville), la mise en quarantaine (lieu de détention spécifique ou pas) ou l’interdiction de séjour (à l’échelle du village, de la ville, de la région ou plus). Il s’agit alors non pas de contention mais de rétention ou de détention, qu’elle soit collective ou individuelle. Massive ou personnelle, du camp de prisonniers à la zone limitée du tricard ou à la cellule du détenu en prison, déjà évoqué. De l’ordre de l’emprisonnement, de la séquestration, de la réclusion, de l’exclusion, de l’isolement ou de la liberté surveillée. Les mots ne manquent pas pour qualifier la variété des formes et stades possibles de cet état générique. Genres et espèces de confinements L’acte de confiner peut se diviser en deux catégories. À moins que l’acte ne soit la conséquence d’un accident, d’un naufrage sur une île déserte, par exemple — sans préjuger de l’intervention d’une volonté divine —, cet acte, en première acception, procède d’une intention humaine mais néanmoins transcendante. Il résulte du choix d’un autre qui, disposant d’une autorité supérieure en pouvoir ou en droit, prescrit l’enfermement d’un tiers. Le confinement est en ce cas un acte subi par qui en est l’objet. Il implique la résignation et la soumission de l’un à la volonté d’un autre, dominant. En seconde acception, cet acte relève au contraire d’une intention immanente, d’une libre décision, du moins en apparence ; endogène, dans tous les cas. Le confinement est alors un enfermement choisi. En se faisant choix propre, initiative personnelle, procédé indépendant, l’acte de confiner étant appliqué à soi, il se pronominalise. Se réfléchit dans tous les sens du terme (verbal et comportemental) et renvoie à l’idée d’autoconfinement. Division générique, le concept initial se scinde ici à l’aune de la différence de nature (non de degré), qui sépare deux états : être confiné (enfermé par quelqu’un) et se confiner (être enfermé par soi-même). Enfin, hybride, situé à l’interface des deux autres, il y a un troisième genre de confinement. L’acte est choisi et subi à la fois. Ce genre médian procède d’une intention contrainte renvoyant à l’idée d’un enfermement qui, bien qu’envisagé avec réticence ou davantage par qui en est l’objet, est cependant admis par lui. L’acte est accepté par nécessité, conviction ou précaution. Pour raison morale, médicale ou autre. L’acceptation du confinement est ici de principe. Forcée mais réfléchie. Imposée mais volontaire, obligée mais non ordonnée, l’interférence (des genres) conduit à un état paradoxal qui voit se mêler en un acte soumission et libre arbitre. C’est cette fois de l’enfermement consenti qu’il s’agit. On peut ainsi se confiner soi-même ou être confiné de différentes manières, selon divers motifs et circonstances. Cela peut advenir aussi bien par choix simple que par consentement, cet autre « choix »… Par exemple, accepter d’être hospitalisé pour une opération est un confinement consenti. Il n’est pas vraiment choisi. Mais pas ordonné non plus. Entre la tentation du possible refus de subir une intervention et l’adhésion au procédé d’hospitalisation, l’acte est équivoque. On pourrait en dire autant à propos de l’écolier ou du collégien, qui au fond, en dépit du rejet premier de l’enfermement institutionnel, accepte quand même de subir le confinement qu’impose l’enseignement — une contrainte au demeurant compensée par un espace de déconfinement temporaire : la cour de récréation, lieu de décompression fonctionnellement comparable à celle du prisonnier en son pénitencier pour sa « promenade » journalière. En dépit de leurs ressemblances troublantes, on n’ira pas plus loin dans le rapprochement de ces lieux aux rôles sociaux distincts. Au demeurant, Michel Foucault l’a déjà remarquablement fait, étendant la comparaison à d’autres lieux comme la caserne et le pensionnat, voire la clinique, considérée comme lieu carcéral du médical. En revanche, on notera que dans les deux cas la cour est un espace clos en forme de petit dehors intérieur destiné à rendre supportable l’enfermement, la privation de grand dehors extérieur, qu’elle soit éducative ou punitive. Sauf cas avéré de phobie scolaire (qui est une forme d’évasion par une pathologie du refus), moyennant quelques compensations récréatives, cet écolier et ce collégien consentent donc à se confiner, renonçant à s’opposer à la loi d’enfermement décidée par un autre. Quel autre ? On va le voir. Mais quelle décision d’abord ? Celle qui consiste — c’est le propre du confinement — à priver l’être de dehors, en instaurant une limite séparant son espace de vie du reste du monde. En le privant non pas tant de mouvement ou de mobilité que d’accès à l’extérieur. D’un droit de passage hors de son espace. En fait, de sortie, plus que de déplacement. Ce qui revient certes à priver l’être de liberté, mais de bien plus encore : à le priver d’existence, que cette privation de dehors soit consentie, subie ou même choisie. Car être dehors, c’est littéralement exister — du préfixe ex-, « hors de », et du verbe sistere, « être placé ». Aussi, pour être libre, encore faut-il exister. Pouvoir ou vouloir être dehors est un préalable. D’où le sens profond du confinement. Grave, tragique, angoissant ou mystique, il suppose toujours un sacrifice existentiel, qu’il soit forcé, contraint ou volontaire. (...) La réclusion comme paradigme Anthropologiquement, en prenant davantage de recul vis-à-vis de cette pratique (...), le confinement apparaît comme un modèle universel d’action, qu’on en soit l’agent et/ou le patient. Au sens le plus large du terme, le confinement est un paradigme politique de gestion du vivre-ensemble, qu’il s’agisse de vivre avec les autres, de vivre parmi les autres, de vivre à côté des autres ou de vivre sans les autres. Respectivement, en assimilé, en intégré, en marge ou en isolé. Qu’on soit seul, à deux, à trois, davantage ou plus encore : une foule, un peuple, une colonie. (...) Le confinement, c’est l’art d’instaurer des limites induisant un état fondé sur un sens aigu de la territorialité et de la frontière — un art appliqué à des réalités d’échelle très variable qui, du lieu à l’étendue, va de l’individu à la totalité et de l’ensemble à l’élément. Le confinement est un procédé de réclusion multidimensionnel. Quant à sa pratique, si son degré zéro est bien sûr la personne, il n’y a pas de limite supérieure à son emploi. Concernant l’individu, outre les cas de l’ermite ou du retraitant reclus (enfermé par choix) et du bagnard interné (emprisonné par ordre de justice) et autres avatars pénitentiaires déjà cités, on peut également évoquer le cas des capturés (par accident) — de Hans Staden, aventurier allemand au Brésil, qui, suite à un naufrage fut captif pendant neuf mois des anthropophages Tupinamba auxquels il échappa en 1555, à Miranda, enlevée et séquestrée dans une cave dans le roman de John Fowles, en passant par Marie Rowlandson, captive des Indiens au xviie siècle, ou par Auguste Guinnard, au xixe, captif des Patagons durant trois ans… |
|
|
Pour ce qui est des confinements de dimension supérieure, l’empereur Cheng Ho, au xve siècle, promulgua en Chine des édits menaçant de décapitation quiconque s’aventurant hors du pays3. Mais on peut mentionner d’autres cas de confinements collectifs plus récents. Outre les ghettos, apartheids, camps de détention de migrants, camps d’internement de Ouïghours et autres rétentions commises au nom du « zéro covid », dont on sait les effets désastreux sur les populations. (...) Une tradition ? Il est vrai qu’au pays de la Grande Muraille avec la Cité interdite au cœur de la capitale, l’esprit d’enfermement est là, matérialisé, inscrit et répété à tout niveau, du centre du pouvoir aux confins de l’empire… Mais balayons devant nos portes. Que sont au juste, in fine, le protectionnisme américain, l’isolationnisme russe, les indépendantismes insulaires, le Brexit, les régionalismes et les localismes divers, sinon un faisceau de signes qui vont tous dans le même sens ? Celui du huis clos et de l’entre-soi. Bien plus que d’un procédé, c’est d’une tendance qu’il s’agit désormais. D’un mode opératoire porté sur le repli, le retrait, la limite, la fermeture, l’enfermement. Et puis ne vivons-nous pas aujourd’hui dans un monde télématiquement confiné ? Ce monde, c’est la planète. La Terre. Un monde que Marshall MacLuhan en son temps nomma avec un certain optimisme « le village global ». L’image d’un monde de rêve, où tout le monde communique avec tout le monde. Celle d’un monde rêvé de l’échange universel, mais à laquelle on peut finalement opposer l’image tout autre d’un monde prisonnier de lui-même, ligoté par son irrigation médiatique et ses censures, cerné par ses constellations satellitaires, inondé par ses réseaux « sociaux » et leur circulation « virale ». Un monde que la Toile du web recouvre d’une trame si dense de communication qu’elle l’y enferme, avec ses services en tout genre, ses mailles de plus en plus serrées, ses mails et autres messages permettant toutes les malfaisances. Le déversement incontinent de haines, de violences et d’ostracismes anonymes. Et comme l’extension de ces flux est exponentielle, la croissance endémique de la mobilité de l’information participe au surplus à la pollution de l’orange bleue sur laquelle nous vivons. À cela s’ajoute la métasurveillance d’internet par des Etats autoritaires visant à créer chez eux un réseau coupé du reste du monde. En Chine (encore, mais pas seulement !), la « cybersouveraineté » gagne du terrain, qui cherche à surveiller toujours davantage les internautes. En Iran, les autorités ont créé un intranet national totalement à la main du régime. Et en Russie, dix mois avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie se donnait déjà les moyens législatifs et techniques de contrôler l’accès aux réseaux sociaux étrangers. (...) Les interdictions de sortie des uns et d’entrée des autres sont au fond comme le recto et le verso du même procédé de confinement. (...) Une histoire du confinement au sein de l’anthropologie de la mobilité ne serait donc pas celle de l’immobilité mais de l’usage des régulations et des limitations du mouvement dans les sociétés. De la mobilité des gens, mais aussi des choses, des biens ou de l’information. Ce serait une histoire qui pourrait s’apparenter à celle que suggère Pierre Nora à propos des sociétés secrètes, le goût du confinement des sociétés recluses partageant bien des points communs avec les premières, comme ceux du repli, du retrait, de la dissimulation et de la clôture. Ceux de la contention, de la détention et de la rétention, si tant est qu’on puisse identifier là trois degrés de mise au secret. |
3 D’après Daniel J. Boorstin, Les Découvreurs, Paris, Seghers, 1986, p. 188. |
|
Ce serait une histoire qui se tournerait notamment vers l’étude des pratiques de réclusion qui « ne sont nullement celles qui revendiquent le droit à l’existence sagement institutionnelle, mais celles, infiniment plus fourmillantes et ramifiées, qui ne s’avouent pas comme telles : innombrables en fait, mobiles en permanence, opaques à elles-mêmes, inconscientes de l’être et seulement secrètes [ou recluses], à la limite, pour ceux qui ont le sentiment de ne pas en faire partie 4»… |
4 Pierre Nora, « Le secret dans les sociétés contemporaines », Présent, nation et mémoire, Paris, Gallimard, 2011, p. 94. |
|
Du syndrome Onoda au complexe de Nemo Retenons cet aspect d’une éventuelle histoire du confinement en ce qu’elle se tournerait en particulier vers l’étude des pratiques de séquestration et réclusion qui « ne sont nullement celles qui revendiquent le droit à l’existence sagement institutionnelle, mais celles (…) qui ne s’avouent pas comme telles ». Celles qui, ni caserne, ni camp, ni prison, ni hôpital, ni monastère, ni école, ni pensionnat, ni asile, ni couvent, ni colonies de vacances, ni lamaserie ou béguinage, ni autre lieu ou établissement dédiés officiellement et explicitement à l’enfermement, sont en marge de ces institutions et, « opaques à elles-mêmes, inconscientes de l’être ». Ces usages sont sans nul doute innombrables, mais aussi généralement là où on ne les imagine pas. Où cela ? Dans le quotidien, les habitudes, l’habitat, les relations publiques, familiales, amicales, amoureuses, affinitaires, les loisirs, les vacances, les voyages, le tourisme. Ils sont dans ce que Pierre Nora qualifie de « réseaux solides et ténus des pratiques sociales »5. |
5 Ibid., p. 95. |
|
Autrement dit, quoique solides, ces usages du confinement sont moins visibles parce que diffus, voire moins conçus ou non perçus comme tels, car ils procèdent de pratiques implicites, informelles, tacites ou secrètes, involontaires ou inconscientes — ce qui, entre le choisi et le subi, ne préjuge en rien de la nature de ces enfermements. Mais quels types d’enfermements alors ? La crise sanitaire a sans nul doute accéléré l’intronisation de la société du « sans contact » et de la dématérialisation du lien social via les « réseaux ». Outre par la distance de la télécommunication, elle l’a fait aussi par la fragmentation de l’espace (sa parcellisation verticale en ville, horizontale en dehors, insulaire partout) et par la réduction de la part physique du phatique, tactile ou autre. (...) Force est de constater des convergences avec, d’une part, comme lieu de vie ordinaire, un désir croissant d’habiter de plus en plus individualiste, tourné vers le pavillon, la villa, la ferme, la chaumière, la résidence en lotissement, autonome, voire isolée, avec jardin, de préférence en périphérie des densités urbaines ou plus loin ; et, d’autre part, comme destination de loisir, des lieux d’enfermement comme les villages vacances, les Center Parcs, les Club Med, les coquilles hôtelières, les campings et autres complexes Thalasso, mais aussi les maisons de famille, les résidences secondaires des amis ou encore les croisières… Dans tous les cas, des espaces clos et aussi étanches que possibles. Au fond, un désir de Nautilus. D’enfermement de plaisir, avec éventuellement un grand hublot sur le monde ou juste un périscope. C’est le complexe de Nemo. L’ambiguïté de l’île Le complexe de Nemo, c’est le désir d’enfermement en un lieu plein, suffisant, émancipé du dehors et de sa dépendance. Un lieu comblé pour confinés heureux qui ne doivent rien à personne. Mais la métaphore marine et maritime est une image qui va très bien aussi à la description de la situation de confinement en contexte épidémique. Sitôt qu’on l’applique, tout s’éclaire. Tandis que certains purent se perdre en pleine terre à bord d’esquifs individuel pour traverser la tempête virale, la ville, elle, ne fut-elle pas au fond une sorte de gros port encombré de gros bateaux à touche-touche immobilisés ? On appelle cela des immeubles ou des « pâtés de maisons ». Ils sont à quai et la ville apparaît alors comme un port dont on ne peut pas sortir. (...) |
|
|
Chambre en ville ou demeure perdue dans la campagne, à chacun son île. À chacun son bateau. Les îles sont « des bateaux immobiles », a écrit Olivier de Kersauson, ce « qui permet, ajoute-t-il, d’être un navigateur paresseux »6. Du moins quand on en habite une, dira-t-on ? Mais on en a tous une, sans même en avoir conscience. On a l’île qu’on peut, qui n’est pas forcément déserte ni même cernée d’eau. C’est une question de fortune, mais aussi de vécu. Les avatars de l’île sont innombrables : elle émerge sitôt inventé un lieu protégé et réservé à soi, si modeste soit-il. (...) |
6 Olivier de Kersauson, « Préface » à Judith Schalansky, Atlas des îles abandonnées, Paris, Arthaud / Flammarion, 2020, p. 7. |
|
Géographiquement parlant, l’île est l’archétype du confinement. Mais si sa topographie peut se déformer à l’infini, et sa place être partout, sa double fonction demeure, qui la scinde en deux types. Cette différence existentielle est celle qui sépare Alcatraz de Tahiti. Ou le pénitencier du paradis — même si l’on peut être aussi bien prisonnier du second que du premier7. Le paquebot de croisière est une île flottante. Le Nautilus aussi, plongeante de surcroît. (...) |
7 Lire par exemple le roman d’Arto Paasilina, Prisonniers du Paradis, Paris, Denoël, 1996. |
|
Chambre en ville ou cabane perdue dans la campagne, certains ont les deux, et parfois davantage, qui, au-delà de la dyade insulaire, vivent dans un archipel. Mais il reste ce rapport ambivalent à l’île, aimée ou détestée. Celle qu’on désire et celle qu’on fuit. Celle qui attire et celle qu’on craint. En dépit de ses déclarations d’amour aux îles grecques et à la Corse, Paul Morand n’en disait pas moins avoir horreur des îles parce qu’elles donnent toujours cette pénible impression qu’on ne pourra pas en sortir. D’autres au contraire s’y plaisent tant qu’ils voudraient y rester à jamais. S’y enfermer avec plaisir. Ainsi y a-t-il des confinés heureux et volontaires et des confinés malheureux qui répugnent à un tel séjour en huis clos. Et puis il y a des confinés qui se délitent dans le temps, heureux au départ, malheureux à l’arrivée. (...) Impactant évidemment à tout moment notre psychologie de la mobilité, notre liberté de mouvement, notre rapport au monde et aux autres, proches ou lointains, on peut, pour le meilleur comme pour le pire, par envie ou malgré soi, se sentir confiné partout : dans son corps, dans sa ville, dans sa vie, dans son métier, dans son rôle, dans sa maison, sur un bateau, sur la planète. Et l’on oscille de la sorte entre les délices de l’autarcie et du cocooning — avec cette jouissance narcissique de l’être comblé, clos sur lui-même — et les affres de la séquestration et de la claustrophobie — avec les étouffements de l’être privé d’espace et du pouvoir de bouger et de se déplacer. Au sujet de cette ambiguïté, Roland Barthes, comparant le Nautilus de Verne au « Bateau ivre » de Rimbaud, a bien noté cette réalité équivoque du confinement à propos du bateau. Il écrit : « Le bateau peut bien être symbole de départ ; il est, plus profondément, chiffre de la clôture. Le goût du navire est toujours joie de s’enfermer parfaitement ». Et il ajoute : « Aimer les navires, c’est d’abord aimer une maison superlative, parce que close sans rémission, et nullement les grands départs vagues : le navire est un fait d’habitat avant d’être un moyen de transport »8. |
8 Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1970, pp. 81-82. |
|
Certains, fait d’habitat également, s’enferment dans leur corps — c’est le cas de l’hypocondriaque, mais de bien d’autres aussi —, ou y sont enfermés — outre la camisole, c’est le cas de la contention symbolique, qui va de la lettre écarlate de l’adultère9 à l’étoile jaune du juif —, et d’autres veulent sortir de leur corps — c’est le propre de l’extase10 —, mais aussi de la maison, de la ville, voire de la planète, et même de la vie… Pourquoi certains veulent-ils quitter la ville ? (...) Et pourquoi certains veulent-ils quitter la Terre ? Parce qu’ils s’y sentent confinés, de plus en plus, agitant au besoin le spectre d’une surpopulation et d’une pollution endémique appelées à rendre peu à peu la planète invivable. (...) Pourquoi évoquer ainsi, pour finir, le voyage dans l’espace vers d’autres planètes ? Parce que s’il n’est plus vraiment conçu comme une promesse d’aventures et de découvertes il rejoint une autre promesse : celle du déconfinement de la planète par l’exode interplanétaire — ce qui prospectivement nous renvoie une fois de plus à la science-fiction. Plus précisément à une très célèbre bande dessinée d’Edgar P. Jacobs, L’Énigme de l’Atlandide, dont le récit s’achève par la migration dans le cosmos de tout un peuple : les Atlantes, jusqu’ici confinés sous terre depuis l’effondrement de l’île Atlantide, aux alentours de l’archipel des Açores, il y a douze mille ans… |
9 Cf. Nathaniel Hawthorne, La Lettre écarlate (1850), trad. Verviers, Gérard & Co, 1968. 10 Du latin extasis, « fait d’être hors de soi », du grec ekstasis, dérivé du verbe existanai, « faire sortir ». |
|
* On en restera là, pour l’instant, avec cette réflexion sur l’île, les multiples avatars de son concept et la complexité des formes, des fonctions et des valeurs du confinement. Ses usages et ses lieux, du corps au cosmos, de la prison aux villages-vacances, de l’enfermement comme procédé à la séquestration comme mode de vie. Pour paraphraser Georges Perec, après qu’il nous a invités à nous interroger sur notre quotidien11, comme lui je dirai qu’il importe peu que les réflexions énoncées ici soient fragmentaires, à peine indicatives d’une méthode, tout au plus d’un projet. Car ce qui importait d’abord, au sortir d’une expérience collective qui marquera durablement notre société, c’était de donner la place qui lui revient à la catégorie du confinement afin de préparer ainsi la reconnaissance de son importance au sein d’une anthropologie générale de la mobilité. |
11 Cf. « L’Infra-ordinaire », op. cit. |
1 Cf. Georges Perec, « L’Infra-ordinaire », Cause commune, 5, 1973. 2 Dictionnaire historique de la langue française (dir. Alain Rey), 2010. 3 D’après Daniel J. Boorstin, Les Découvreurs, Paris, Seghers, 1986, p. 188. 4 Pierre Nora, « Le secret dans les sociétés contemporaines », Présent, nation et mémoire, Paris, Gallimard, 2011, p. 94. 5 Ibid., p. 95. 6 Olivier de Kersauson, « Préface » à Judith Schalansky, Atlas des îles abandonnées, Paris, Arthaud / Flammarion, 2020, p. 7. 7 Lire par exemple le roman d’Arto Paasilina, Prisonniers du Paradis, Paris, Denoël, 1996. 8 Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1970, pp. 81-82. 9 Cf. Nathaniel Hawthorne, La Lettre écarlate (1850), trad. Verviers, Gérard & Co, 1968. 10 Du latin extasis, « fait d’être hors de soi », du grec ekstasis, dérivé du verbe existanai, « faire sortir ». 11 Cf. « L’Infra-ordinaire », op. cit. |
|
______________ Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |
|
Recebido em 10/12/2023. / Aceito em 14/03/2024. |