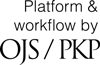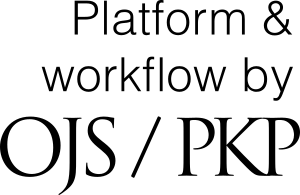Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
Le point sémiotique
|
Multivers, non merci. Guido Ferraro
Publié en ligne le 10 juillet 2024
|
|
|
Drôle de film, cet Everything Everywhere All at Once1 ! Il a eu énormément d’écho, a remporté plusieurs prix et, ce qui importe le plus, a fait l’objet de débats intellectuels apparemment de haut vol. Pourtant, j’ai pu le constater, nombreux sont ceux (en général de plus de trente ans) qui ne l’ont pas vraiment aimé : on dit que c’est un film trop long, répétitif, ennuyeux, déplaisant, étourdissant et chaotique, sans perspective narrative définie... Mais d’un autre côté, il se pourrait tout de même qu’à sa manière ce film soit au fond génial et subtilement signifiant. En tout cas, il ne fait aucun doute que la façon dont il se branche sur (et en même temps se détache de) toute une série de thèmes, de formes de langage et de manières de construire une ligne narrative (ou de la détruire) — toutes choses propres à une certaine culture contemporaine — est pour nous tout à fait intéressante. |
1 Sorti en 2022, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert. |
|
Au premier abord, ce film, qui paraît entièrement fondé sur l’idée de « multivers »2, peut sembler s’inscrire dans le domaine de la science fiction... ce qui n’est cependant pas le cas. Il ne s’agit pas non plus à proprement parler d’une comédie de l’absurde, ni d’un récit philosophique, et on pourrait continuer à énumérer ce qu’il n’est pas. Car la force et l’identité de ce film tiennent justement, pour l’essentiel, à ce qu’il paraît mais n’est pas. Selon nos catégories traditionnelles, il se situe dans la zone du mensonge, du simulacre, de la dénégation critique et de la déconstruction des illusions courantes. D’où l’idée qu’il mérite un bref article dans la présente rubrique, quelque peu atypique, de notre revue. Il ne s’agira ni d’en proposer une évaluation critique ni d’en faire une véritable analyse. Le Point Sémiotique a vocation à lancer des éléments de réflexion, des perspectives possibles, des interrogations plus que des conclusions achevées. Je prends donc cette œuvre surtout comme un exemple qui me permet, d’un côté, de soulever quelques questions théoriques d’intérêt général en sémiotique, et d’un autre côté, plus immédiatement évident, de suggérer certaines réflexions à propos du rapport entre la culture contemporaine et un emploi sui generis des architectures narratives. |
2 « Multivers » : en sciences, dans le cadre d’une théorie cosmologique donnée, l’ensemble des univers présents concurremment ; dans la fiction, utilisation d’univers parallèles pour l’élaboration de récits. D’après Wikipédia. (Ndlr). |
|
Tout d’abord, voyons ce qui a été dit par les critiques les plus enthousiastes, pour la plupart des cinéphiles déclarés et avertis. Ils exaltent surtout la virtuosité technique d’un film qu’ils disent être continuellement surprenant, « pyrotechnique », incontrôlé, bizarre, fou, excentrique, redondant — bref, à leurs yeux, plus pétillant et amusant, dirait-on, que d’une manière ou d’une autre signifiant. On en souligne (ce qui, à n’en pas douter, était escompté par le metteur en scène) l’insistance à multiplier les citations les plus différentes, à jouer avec les genres les plus divers sans s’inscrire en propre dans aucun d’eux. Pour ne prendre qu’un seul exemple, voici le résumé qu’en donne la revue Écran large — résumé significativement repris par Wikipedia : « Everything Everywhere All at Once réussit l’exploit d’être un pur chaos organisé, un bijou d’orfèvrerie tourné vers le n’importe quoi pour pleinement embrasser son délire cosmique… »3. On l’a compris : il s’agirait en somme de pur kitsch. Et pourtant, ce n’est pas vraiment, pas exactement ça, en tout cas aux yeux d’un sémioticien. |
3 A. Desrues, « Everything Everywhere All at Once : critique dans le vrai Multivers de la folie », Ecran large, 31 août 2022. |
|
Première question. Du point de vue d’un spectateur simplement curieux plutôt que véritablement cinéphile, qu’est-ce qui pourrait faire apprécier ce film excessif, répétitif, désordonné, chaotique et somme toute désagréable ? Il suffit (peut-être) de dire qu’on y met en scène la vie d’une pauvre femme qui cherche, tant bien que mal, à faire fonctionner sa petite entreprise de nettoyage, et en même temps à maintenir unie une famille qui paraît sur le point de voler en éclat. Oui, ce film est excessif, répétitif, désordonné, chaotique et désagréable — exactement comme cette pauvre vie. Pourquoi aurait-il dû être différent ? Mais il ne s’agit pas d’une simple question de correspondance par mimésis. La construction enchevêtrée de ce film, avec l’évidente impossibilité de traiter séparément d’histoires personnelles distinctes, d’en suivre une quelconque logique intérieure, d’en sauver même, si on peut dire, la « narrabilité » sans passer par le renvoi à d’autres personnages et à d’autres histoires, tout cela pose des questions qui n’ont rien de superficiel car elles se situent sur un plan où la référence au concept de multivers devient bien autre chose, bien davantage qu’une citation à la mode. Reconsidérons avec attention le titre même du film. L’idée d’une narration qui englobe tout (everything), sans la moindre ligne de démarcation, ni d’espace (everywhere) ni de temps (all at once), ne se présente-t-elle pas comme un défi ouvert à la pensée aristotélicienne ? Voilà qui nous conduit à des thèmes de réflexion qui, pour nous sémioticiens, sont éminemment d’actualité. Aristote (dont, comme on sait, la perspective a dominé durant des millénaires) pensait que la structure axiologique d’une vie (ou d’une de ses parties) en constitue l’aspect essentiel, et que par contre les enchevêtrements et les complications de toutes sortes qui surviennent au fil du temps ne sont que de simples accidents. Cette perspective justifiait la forme narrative que tout le monde connaît et que tout le monde à tendance à maintenir et à répéter... jusqu’au moment où quelqu’un s’en écarte — et cela, admettons-le, non sans quelques raisons. Car il semble bien qu’aujourd’hui, dans le rendu narratif d’une histoire de vie, il ne soit plus possible de faire abstraction de l’imbrication entre plusieurs vies, autrement dit qu’on ne puisse plus comprendre une vie indépendamment de l’environnement intersubjectif où le protagoniste se trouve immergé. L’accidentalité même des faits de la vie, loin d’être vue comme accessoire, est maintenant considérée comme une composante incontournable et essentielle4. |
4 Rien d’étonnant par conséquent à ce que le « régime de l’accident » fasse désormais partie intégrante de la théorie sémiotique de l’interaction. |
|
Dans un précédent numéro d’Acta Semiotica, j’ai fait référence à un autre texte où il s’agissait aussi d’une narration tout à fait déconcertante et chaotique, passant par tous les genres, les débordant — un roman où mille histoires viennent à tout moment se croiser, et qui en vient finalement à s’ouvrir sur la multiplicité même des possibles. Il s’agissait d’un texte du XVIIIe siècle, Jacques le fataliste et son maître, écrit par un des intellectuels les plus représentatifs de son temps, Denis Diderot5. Dans ce texte d’une surprenante modernité, l’auteur souligne sa distance par rapports au règles d’Aristote. Ces règles qui fondent les formes traditionnelles du récit nous apparaissent aujourd’hui comme une construction artificielle, trop éloignée de la façon dont se déroule la vie réelle. Déjà à l’époque, la construction cahotique et incohérente du non-roman de Diderot visait un meilleur rendu de l’expérience humaine effective. Car, comme je cherchais à le montrer dans l’article en question, les règles qui régissent le modèle d’Aristote ne sont pas seulement des principes formels. Elles constituent en fait la base d’une grammaire du récit qui, comme toute grammaire, est l’expression d’une perspective culturelle déterminée. Cela pose évidemment des problèmes très complexes qu’il est exclu d’aborder ici en détail. En revanche, ces quelques indications vont nous permettre de mieux nous interroger maintenant sur l’organisation narrative et rhétorique de ce film, et sur sa structure de sens effective. |
5 Cf. G. Ferraro, « Maîtres des règles. De la notion de code à la grammaire de l’imaginaire », Acta Semiotica, II, 4, 2022. |
|
Du point de vue de son articulation textuelle en tant que texte narratif, ce film présente deux niveaux, ou peut-être mieux deux faces. D’un côté, on a l’histoire d’une journée difficile d’Evelyn, une Chinoise propriétaire (selon un cliché évident) d’une laverie automatique. Embrouillée dans ses affaires, elle est incapable de s’en sortir face à ses problèmes d’impôts et à ses multiples difficultés de relation, que ce soit avec son mari, son père, et surtout sa fille, Joy, dont le coming out homosexuel et la présentation de sa fiancée Becky viennent tout à coup la secouer. Une situation en somme aussi pénible que banale, et surtout de bien peu d’intérêt pour un film qui ne dure pas moins de deux heures ! Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter : d’une manière aussi calme qu’évidente, et bien sûr sans qu’aucune explication véritable ne soit donnée, Evelyn paiera en fin de compte sans problèmes ses impôts, reprendra une relation romantique avec son mari et accueillera aimablement Becky comme faisant partie de la famille. A-t-on jamais vu une histoire plus triviale ? C’est pourtant là l’essence de ce film, une œuvre peut-être à sa manière originale et raffinée. Selon les distinctions les plus fondamentales de la théorie de la narration, on sait qu’à côté de programmes narratifs visant au changement d’une situation initialement donnée, il existe aussi d’autres « PN » (programmes narratifs) qui visent au contraire à la reconstitution d’un équilibre initialement posé. A cette seconde classe appartiennent les histoires où, entre le début et la fin du récit, rien ne change à proprement parler : la suite des événements ne sert alors qu’à rendre manifeste ce qui, au départ, ne l’était pas suffisamment, souvent en suscitant chez les destinataires l’effet typique du « on l’avait déjà compris dès le début ». L’idée sous-jacente à ce genre d’architectures narratives, que j’appelle « positionnelles »6, est qu’au fond il y a bel et bien un ordre dans le monde, et que toutes les choses ont idéalement la place qui leur revient : il suffit de surmonter les accidents de surface pour saisir l’ordre profond du réel et, bien sûr, en être définitivement rassuré. Puisque ce genre d’architectures narratives ne prévoit donc aucun véritable dispositif de transformation, le rapport entre le segment initial et le segment final du récit ne présente pas la relation classique d’inversion (« contenu inversé » / « contenu posé » ). Il se laisse mieux définir dans des termes du genre virtuel / réalisé ou être sans paraître / être et en même temps paraître, ou encore en des termes comme illisible / lisible ou indéterminé / déterminé. Si, en ce point, on se souvient qu’à en croire les critiques, l’essentiel de notre film est de l’ordre du chaos et de la folie, de la surprise et de la multiplicité, il devient intéressant de constater la présence centrale d’une construction narrative qui, tout à l’opposé, pointe vers la détermination, la lisibilité, l’univocité. Y a-t-il là une contradiction ? Essayons de mieux comprendre l’organisation rhétorique du texte. |
6 Cf. Teorie della narrazione, Rome, Carocci, 2015, § 3.5. |
|
Entre le segment initial et le segment final, on trouve en effet un second niveau de construction textuelle. Il faut, à cet égard, revenir aux premiers moments de l’histoire. Evelyn et son mari Waymond sont allés ensemble au bureau des impôts. Et les voilà effrayés devant une impitoyable inspectrice qui les menace de terribles ennuis. Mais soudain le timide Waymond se transforme en un Alpha Waymond, sa version correspondante dans un univers parallèle, l’Alphavers. Cette version alternative du pauvre Waymond est bien sûr tout à fait géniale, performante et invincible : rien à voir avec sa misérable version « standard ». A partir de ce moment, il devient impossible de suivre les innombrables sauts d’un endroit à l’autre de ce qui prétend être un immense « multivers » à la mode, mais qui se présente en fait comme une simple collection de figures familières, à commencer par la terrible Jobu Tupaki, personnage qui contrôle tout le multivers grâce à une sorte de générateur de trous noirs... et qui n’est autre que la version alternative de Joy, la fille de la famille : comme dans un jeu de kaléidoscope, on retrouve toujours les mêmes personnages, bien que dans leurs plus fantastiques transpositions. Le « multivers », c’est l’idée fascinante que la réalité admet une infinité de variantes, que par suite tout est possible, que quelque part, ailleurs, tout peut être vrai. Voilà un espace vertigineux et magnifique, où nous-mêmes nous démultiplions selon toutes les variations de personnalité possibles, dans toutes nos histoires possibles... Nous pouvons donc nous lancer en vol dans l’infini, nous enivrer de la possibilité d’être autre que ce que nous sommes, rêver de ce que nous ne sommes pas capable de faire, dépasser nos médiocres limites, oublier la mesquinerie de notre vie réelle. Elle est donc bien « géniale », la perspective du métavers, surtout pour une génération qui, ayant perdu ses points de repère, confond trop souvent l’incapacité de choisir et de prendre position avec la sensation d’un espace virtuel énorme, indéfini. Un espace où chacun pourrait être différent de ce qu’il est, deviendrait le protagoniste d’un tout autre récit, où chacun à sa convenance disposerait d’un savoir dépassant ses limites et d’un pouvoir échappant à la portée de sa pensée. En tant que manière de rendre manifeste la dimension du choix, le jeu des possibilités virtuelles a bien entendu souvent un rôle très intéressant dans la construction des récits. Mais quand on parle de « multivers », on pense à la possibilité de comparer entre eux non seulement des programmes narratifs distincts mais aussi des systèmes de pensée et de vie plus globaux. Il s’agit des architectures narratives que j’appelle de Classe Beta7, où le récit n’est plus centré sur les vicissitudes individuelles mais sur l’exploration de l’ordre et de la grammaire du monde — comme il arrive par exemple dans les narrations mythologiques. |
7 G. Ferraro, Semiotica 3.0, Rome, Aracne, 2018, chap. III. |
|
Rien de tel, pourtant, dans Everything Everywhere All at Once. Ce film refuse de se servir du multivers comme moyen d’élaborer des hypothèses de réalités systématiquement différentes. Le cas de Joy, qui serait aberrant dans le cadre d’un système de valeurs traditionnel, est emblématique à cet égard, d’autant plus qu’il est central dans la thématique du film. On aurait cru évident qu’un film traitant des problèmes d’une mère affrontée à la singularité des penchants sexuels de sa fille poserait des questions au niveau des valeurs, des règles sociales... donc au niveau de la configuration du système culturel — ce qui l’aurait placé parmi les récits de Classe Beta, centrés précisément sur les systèmes de valeurs et sur la grammaire du monde. Et rien de mieux pour cela, aurait-on pu penser, qu’un récit exploitant les possibilités alternatives offertes par ce « système des systèmes » qu’est le multivers. Mais non, c’est tout le contraire : la question est abordée en termes purement personnels et familiaux, liés à la seule capacité de comprendre et d’aimer qui fait ce qu’on appelle une « bonne mère » ! On voit que ce film présente une élaboration visuelle et imaginative complexe, mais qui n’aboutit pas à ce qui semblerait en être la mission naturelle. Après avoir fait percevoir le vertige des possibles (en « branchant » les protagonistes sur leur vies alternatives), le film propose un parcours d’autant plus simple qu’il est parfaitement linéaire. Aucun saut dans une autre réalité, aucun changement spectaculaire des personnages, qui restent de modestes membres d’une quelconque famille chinoise gérant une laverie. Morale : il ne faut pas se laisser séduire par les illusions d’univers inexistants mais accepter de bon gré ce qu’on est. Ce sont peut-être les personnes les plus humbles qui sont le mieux à même de comprendre ce qu’il peut y avoir d’illusoire dans les effets spéciaux et dans les grandes transformations : mieux vaut penser que le bonheur est fait de petits moments et de petits gestes, ceux en particulier qui nous permettent de nous réconcilier avec autrui, et avec nous-mêmes. On l’aura compris, ce qui nous intéresse n’est pas cette humble philosophie de vie mais la manière dont, d’un côté, le film joue sur la fascination du multivers (tout en la niant, au bout du compte), et, de l’autre côté, dont les spectateurs se laissent capturer par cette fascination sans s’interroger sur son sens, sa nature, sa place dans le film. Mais, à ce qu’il me semble, c’est là justement le rôle culturel d’une construction de l’imaginaire comme le multivers : elle donne à ceux qui en ont besoin l’illusion qu’une autre vie est possible, et que, mieux encore, une vie meilleure pourrait exister sans qu’il faille soi-même la construire (selon le schéma bien connu : vouloir, acquisition de compétences, mise en œuvre d’un faire transformateur, etc.). Le lent déclin — lent mais, semble-t-il, inexorable — des histoires « à l’ancienne » (celles qui suivent par exemple l’ancien modèle du schéma canonique greimassien) devrait nous faire réfléchir. Avant qu’il ne soit trop tard. Avant qu’une génération trop plongée dans le virtuel, habituée à penser que tout est possible mais qu’il n’y a pas beaucoup à faire de concret dans le monde réel, ne risque de tout accepter, y compris la destruction totale de ce monde. Un monde qui — faut-il le rappeler ? — ne dispose d’aucune alternative. |
|
Bibliographie Ferraro, Guido, Teorie della narrazione, Rome, Carocci, 2015. — Semiotica 3.0, Rome, Aracne, 2018. — « Maîtres des règles. De la notion de code à la grammaire de l’imaginaire », Acta Semiotica, II, 4, 2022. Desrues, Antoine, « Everything Everywhere All at Once : critique dans le vrai Multivers de la folie », Ecran large, 31 août 2022. |
|
1 Sorti en 2022, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert. 2 « Multivers » : en sciences, dans le cadre d’une théorie cosmologique donnée, l’ensemble des univers présents concurremment ; dans la fiction, utilisation d’univers parallèles pour l’élaboration de récits. D’après Wikipédia. (Ndlr). 3 A. Desrues, « Everything Everywhere All at Once : critique dans le vrai Multivers de la folie », Ecran large, 31 août 2022. 4 Rien d’étonnant par conséquent à ce que le « régime de l’accident » fasse désormais partie intégrante de la théorie sémiotique de l’interaction. 5 Cf. G. Ferraro, « Maîtres des règles. De la notion de code à la grammaire de l’imaginaire », Acta Semiotica, II, 4, 2022. 6 Cf. Teorie della narrazione, Rome, Carocci, 2015, § 3.5. 7 G. Ferraro, Semiotica 3.0, Rome, Aracne, 2018, chap. III. |
|
______________ Résumé : Nous assistons à un recul progressif des textes narratifs construits de manière classique, en faveur de textes non linéaires, jouant sur le croisement de plusieurs lignes narratives virtuelles. Le récent film à succès Everything Everywhere All at Once, fondé sur la notion de multivers, semble aller dans ce sens. En fait, il s’en distancie de façon critique et par là nous conduit à une série de réflexions concernant la remise en cause du modèle aristotélicien, le rapport entre narration et expérience de vie, et la place des formes narratives dans la culture contemporaine. Resumo : Assistimos a um progressivo retroceder dos textos narrativos construídos de modo clássico, substituídos por textos de tipo não linear, fundados sobre o cruzamento de várias perspectivas narrativas virtuais. O recente film de grande sucesso Everything Everywhere All at Once, baseado na noção de multivers, parece ir neste sentido. Na realidade, ele se distancia disso de modo crítico, o que nós conduz a uma série de reflexões relativas à evolução do modelo aristotélico, à relação entre narração e experiência de vida e ao papel das formas narrativas na cultura contemporânea. Abstract : We are witnessing a progressive decrease of narrative texts constructed in a classical way, in favor of non-linear texts, founded on the intersection of many virtual narrative lines. The recent hit film Everything Everywhere All at Once, based on the fashionable concept of multiverse, while it would seem to go in this direction, actually distances itself, thus leading us towards a series of thoughts that concern the evolution of the Aristotelian model, the relationship between narrative and life experience, the place of narrative forms in contemporary culture. Riassunto : Stiamo assistendo a una progressiva diminuzione di testi narrativi costruiti in modo classico, a favore di testi non lineari, giocati sull’incrocio tra più linee narrative virtuali. Il recente film di successo Everything Everywhere All at Once, fondato sul concetto alla moda di multiverso, sembrerebbe andare in questa direzione, ma ne prende in realtà criticamente le distanze, conducendoci così verso una serie di riflessioni che toccano le evoluzioni del modello aristotelico, il rapporto tra narrazione e esperienza di vita, il posto delle forme narrative nella cultura contemporanea. Mots clefs : architectures narratives, chaos, mimésis, multivers. Auteurs cités : Aristote, Denis Diderot, Algirdas J. Greimas. Plan : |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |
|
Recebido em 10/04/2024. / Aceito em 30/05/2024. |