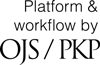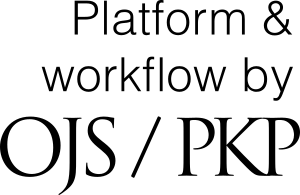Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
Dossier — Aspects sémiotiques du changement
|
Présentation Pourquoi le changement ? Eric Landowski
Publié en ligne le 23 décembre 2023
|
|
|
Il y a quelques années nous avons été amené à présenter dans nos chers anciens Actes Sémiotiques (avant qu’ils ne changent, comme toute chose) un ensemble de travaux qui portaient sur les « organisations », leur formation, leur fonctionnement, leurs problèmes. Pour commencer, nous observions que ce terme, organisation, ne fait pas partie du métalangage de la sémiotique mais que les acteurs collectifs — administrations ou entreprises — qu’il désigne dans l’idiolecte des sociologues nous sont familiers depuis longtemps en tant qu’objets d’étude1. La même observation vaut aussi, et même davantage encore pour le présent dossier préparé en duo avec Paolo Demuru autour de l’idée de changement. |
1 Actes Sémiotiques, 122, 2019, dossier « Sémiotique et organisations. Critique, réforme, dépassement ». |
|
Ce mot ne figure pas non plus parmi les entrées du Dictionnaire raisonné qui nous sert de référence conceptuelle la plus constante2. Et à notre connaissance, jusqu’à présent personne parmi nous ne faisait heuristiquement usage de la notion correspondante dans ses travaux — à une exception près3. Or, malgré cela, nous n’avons en fait jamais cessé, les uns et les autres, sémioticiens d’obédience structurale, de nous occuper de processus qui constituent bel et bien des « changements » au sens courant du terme, que ce soit sous le nom de « transformations d’états », notion clef de la grammaire narrative depuis le départ comme on sait, ou par la suite en cherchant à rendre compte des processus graduels qu’implique le « devenir »4. Il n’en reste pas moins que de même qu’il n’existe toujours pas, à proprement parler, une « sémiotique des organisations » — ce qui ne constitue pas, nous semble-t-il, un manque théorique trop grave —, de même une théorie sémiotique du changement fait aujourd’hui encore défaut. Et cette lacune-là nous paraît, elle par contre, vraiment regrettable. |
2 A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. 3 Toute modestie mise à part, cette exception, c’est nous, en particulier dans « Continuité et discontinuité. Vivre sa génération » (La société réfléchie, 1989), « Échelles du temps » (E/C, 32, 2021) et surtout « Mode, politique et changement » (Présences de l’autre, 1997), article entièrement consacré à la notion qui nous occupe aujourd’hui. 4 Voir notamment J. Fontanille (éd.), Le devenir, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1997. |
|
1. Conceptualiser la notion de changement et ce qu’elle implique pourrait en effet, croyons-nous, faire avancer utilement la réflexion sémiotique sur le plan le plus général. Problématique du sens et problématique du changement sont étroitement liées. Les conditions de l’émergence du sens tiennent effectivement à des faits de syntaxe qui, très souvent, en surface, prennent la forme de discontinuités perceptibles dans le temps ou dans l’espace. Tout en correspondant à ce qu’on appelle ordinairement des changements, ces discontinuités sont autant de manifestations occurrentielles du principe fondateur de toute signification, à savoir le principe de différence. A tel point que la vieille « épreuve de commutation », qui consiste, expliquait Barthes, « à introduire artificiellement un changement dans le plan de l’expression et à observer si ce changement entraîne une modification corrélative du plan du contenu » reste à la base de toutes nos recherches sémiotiques aussi bien que sémantiques5. |
5 R. Barthes, Eléments de sémiologie, Communications, 4, 1964, p. 118. |
|
Certes, une différence signifiante n’est pas nécessairement liée à un processus de changement. La coexistence de deux grandeurs en tant qu’unités paradigmatiquement corrélées, du type vie / mort ou par exemple permis / interdit, peut y suffire. Ce qui signifie ne se réduit donc pas à ce qui « change » — disons : à ce qui se transforme sous nos yeux, pour prendre ce verbe en un de ses sens les plus usuels. En revanche, toute variation, tout changement perçu par rapport à un état de choses servant de référence (un état présent qui tranche par rapport à un état passé, l’étrangeté d’un ailleurs par rapport à la « normalité » d’ici) ou bien fait immédiatement sens ou bien, en faisant énigme, engage une quête de sens. On peut même dire que dans une grande mesure, pour que du sens émerge au fil de l’expérience vécue, il faut qu’il y ait changement. Tant que rien ne change, c’est à peine si on s’interroge sur ce que veut dire l’état de choses présent. S’écoulant « comme un long fleuve tranquille » dans la continuité d’une programmation sans accroc, le temps devient pour ainsi dire étale (tel un baromètre au « beau fixe ») si bien que la question même du sens semble alors n’avoir aucune raison d’être6. Tout se passe comme si la continuité, insignifiante par nature, l’abolissait. |
6 Sur le temps « étale », cf. « Échelles du temps », art. cit. (§3.Prospective et désillusion). |
|
Mais que le moindre changement — la moindre « solution de continuité » — vienne perturber cette sorte de normalité des choses données, et aussitôt s’impose le besoin d’un sens qui rende intelligible et, s’il le faut, qui justifie ce qui advient de différent, d’« autre », de nouveau. Il suffit même de la simple promesse — ou de la menace (selon le point de vue qu’on adopte) — de quelque modification possible de l’ordre des choses pour que la question du sens devienne ou redevienne une préoccupation, le ressort d’un espoir ou au contraire un motif d’inquiétude. Ce qui allait de soi sans qu’il soit besoin de le thématiser, de le justifier, de le « monter en épingle », devient objet de discours passionnés qui en revendiquent (en découvrent ou en inventent) le sens et la valeur dès que l’ordre habituel se trouve mis en cause par l’actualité ou la simple perspective d’un changement. Ainsi constate-t-on par exemple qu’à aucun moment un groupe social ne donne davantage de sens et de valeur à ce qu’il estime constituer sa propre identité que lorsqu’il la croit menacée d’être « altérée », « dénaturée » (comme disent les intéressés) par sa mise en contact de proximité avec une population culturellement différente, regardée comme jouant le rôle d’un intrus, d’un « envahisseur ». En France, un parti d’extrême droite des plus influents donne à un tel changement fantasmé le nom de « grand remplacement ». Et c’est sur cette peur délibérément entretenue qu’il fonde, avec grand succès, l’essentiel de sa propagande.
2. La richesse mais aussi la complexité du thème tient évidemment à la multiplicité des dimensions sémiotiques qu’il articule les unes aux autres. A commencer par les modulations aspectuelles dont il convoque toute la panoplie. La même notion de changement peut aussi bien recouvrir, comme cela a été maintes fois relevé, des processus métamorphiques progressifs plus ou moins rapides que des ruptures abruptes, aussi bien des processus cycliques impliquant le retour épisodique du même que des évolutions linéaires et irréversibles, chacune de ces variantes étant, de plus, presque toujours associée à des investissements axiologiques et/ou passionnels eux-mêmes d’orientations diverses. En se limitant à des figures-types, quasi stéréotypées, on aura par exemple, d’un côté, un « maintenant » dévalorisé en regard d’un « autrefois » révolu et regretté : Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville et de l’autre, à l’inverse, un présent dévalorisé par rapport soit à un passé reconfiguré en « âge d’or », soit à un temps futur vu comme « avenir radieux » : Debout ! les damnés de la terre (...) ... sans évidemment exclure le simple constat, axiologiquement neutre : « C’est étonnant de voir à quel point cette ville / ce parti / ce collègue a changé en si peu de temps ». De la même isotopie temporelle relève la thématique, moins étudiée peut-être, non pas de la discontinuité mais de sa négation ou de son dépassement (la non-discontinuité). A la commune mortalité des êtres vivants et à l’inévitable dépérissement des choses (conformément au principe d’entropie), on oppose alors sinon la permanence (ce serait la continuité) du moins la conservation temporaire d’états de choses censés ne pas pouvoir durer — par exemple la persistance, la jouissance continuée de compétences « en principe » (« normalement ») éphémères : « A son âge ! encore vaillante ! Tout de même ! Ne changera-t-elle jamais ? Mais comment fait-elle donc ? » : question pertinente car dans un monde où la seule constante est l’impermanence — l’inévitabilité du changement —, son opposé, le maintien en l’état, la non-discontinuité, ne suppose pas moins d’« agentivité » — de soins ou d’efforts — que la production du nouveau7. |
7 Voir ici même les remarques de Franciscu Sedda sur les ruses cosmétiques contre « l’usure du temps ». |
|
Ici tout particulièrement, la modulation aspectuelle est cruciale. Face à l’éventualité d’un changement subit, la prudence est de rigueur, comme face à n’importe quel risque d’accident. C’est la seule stratégie possible : ne pas prendre de risques. Mais quand il s’agit de processus de transformation non pas brutaux et évitables mais lents, insidieux, « duratifs » et inéluctables, alors une autre stratégie s’impose. Il ne s’agit plus en pareil cas d’éviter un changement mais tout au plus d’en repousser l’échéance, sachant que le terme final est, comme on dit aujourd’hui, « incontournable ». Pour rendre compte de ce type de cas, à côté de la syntaxe classique des transformations d’état, dont le principe est d’inverser les valeurs (de la conjonction à la disjonction, ou dans l’autre sens), il a fallu prévoir, il y a déjà bien longtemps, une syntaxe de « transformations stationnaires »8 garantissant qu’au contraire, envers et contre tout, la valeur ne changera pas — certes non pas ad aeternam mais du moins « tant que ça dure ! ». Manar Hammad nous apprend que « les mathématiciens [aussi] ont un nom pour les transformations qui maintiennent l’identité d’un élément : ils les appellent transformations identiques »9. |
8 Cf. E. Landowski et P. Stockinger, « Problématique de la manipulation : de la schématisation narrative au calcul stratégique », Degrés, 44, 1985. 9 M. Hammad, « De l’espace et des hommmes. Identité de groupe et traces de la privatisation de l’espace et de la propriété à l’époque néolithique », Acta Semiotica, III, 5, 2023, p. 159. |
|
En faisant exception sur un fond d’impermanence, un tel non-changement, ne fût-il que provisoire, contredit le principe de mutabilité qui préside à l’ordre ordinaire des choses. Autant que le changement, le non-changement peut donc être signifiant. Entre les contraires — ou bien la permanence (et à la limite, l’éternité... l’immortalité), ou bien le changement (l’évolution, l’inconstance, la fugacité, la précarité, la fragilité, selon les divers registres possibles, et en tout cas, en dernière instance, la mortalité) —, le non-changement, pourrait-on dire, « ça change », le verbe étant pris en ce cas dans son emploi absolu : « Pour une fois, quelque chose ou quelqu’un qui ne change pas, ça change ! ». Victoire contre des forces perturbatrices ou résistance à « l’usure du temps », il arrive, de fait, que — pour un temps — le même perdure, identique (grosso modo) à ce qu’il était. Toutefois, parler à ce propos de « l’usure du temps » n’est évidemment rien de plus que se satisfaire d’une métaphore commode. En faisant comme si « le temps », magiquement, agissait à lui seul, on se dispense d’identifier les facteurs effectifs de changement. Quels qu’ils soient, ces facteurs (mécaniques, chimiques, biologiques, psychologiques, sociétaux, idéologiques, politiques, économiques ou autres encore) ont certes besoin d’une durée d’action déterminée pour exercer efficacement leur action transformatrice. Mais ce n’est pas dans cette durée que réside leur pouvoir transformateur même. Tout comme les principes interactionnels qui assurent la prise d’un agent quelconque sur un autre, les principes et les processus de changement, dans quelque domaine que ce soit, changent de nature en fonction de l’échelle d’observation qu’on adopte10. Vu de très haut, le Temps — le « passage » du temps — suffit pour tout expliquer. Mais à mesure qu’on se rapproche de l’espace où l’interaction se déroule (certains diraient peut-être de la « scène prédicative » à analyser) apparaît une kyrielle presque infinie d’agents transformateurs dont l’action n’est perceptible et analysable qu’à petite ou très petite échelle, jusqu’au niveau microscopique11. |
10 Cf. E. Landowski, Avoir prise, donner prise, Limoges, Pulim, 2009 (2e partie, « Les échelles du sens »). 11 A propos de la superposition des échelles d’observation macro-, méso- et microscopiques, outre le texte mentionné ci-dessus, cf. E. Landowski, « Échelles du temps », art cit. (§2, « La discordance des temps »). |
|
Bien entendu, il n’est pas question que, pour expliquer comment, dans leur infinie diversité, les choses changent, le sémioticien se transforme tour à tour en physicien, en chimiste, en économiste, en historien ou, plus improbable encore, en psychanalyste !12 Mais il lui revient de rendre compte des principes d’interaction et corrélativement des régimes de sens qui sont mis en jeu sur les divers terrains à considérer parce qu’une dynamique de transformation y est à l’œuvre. Il y a là tout un pan de la problématique du changement qui n’est guère abordé dans ce dossier mais que nous signalons parce qu’il est immense et nous paraît passionnant. Il concerne à l’évidence la sémiotique des objets, mais aussi celle des corps et du vivant en général, qu’il s’agisse de la croissance, de la maturation ou du vieillissement. Un colloque consacré à l’étude des formes de l’usure, tenu il y a longtemps à Urbino, avait été l’occasion d’esquisser une première approche de ce genre de questions13. Notre propre approche comparative de la vie et la mort, certes dérisoire, des petites cuillères (et des louches), certaines en plastique, qui fondent ou qui pètent, d’autres en bois, qui s’embellissent à l’usage, de même que celles de Jacques Fontanille sur la patine des vieux meubles14, indiquent quelques pistes qui mériteraient sans doute d’être reprises et prolongées sur un plan plus général. Mais la temporalité n’est pas seule en cause. « Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà », constatait Pascal. Lorsque la « vérité », ou quoi que ce soit d’autre, diffère d’un lieu à un autre, d’une culture à une autre, la perception de cette différence ne peut pas ne pas provoquer, pour le philosophe qui compare les choses in abstracto comme pour le voyageur qui les observe tour à tour en se déplaçant, des effets de dépaysement liés à la découverte d’une altérité. « Dépaysement » est le nom que la langue française donne à cet effet de sens du changement quand il est appréhendé dans l’odre de la spatialité : effet d’étrangeté souvent vécu dysphoriquement, mais aussi, parfois, comme régénérateur. D’où la sagesse d’une recommandation de ce genre : « Partez donc un moment au bord de la mer, ça change les idées ». |
12 Il est vrai néanmoins que pour rendre compte d’un changement décisif, d’ordre institutionnel — l’apparition des rapports de propriété —, le sémioticien Hammad ne peut pas ne pas se faire aussi, pour une part, archéologue, historien, anthropologue. Voir sa contribution au dossier qui suit, « Des choses et des hommes : les prémices de la propriété des objets ». 13 7-9 juillet 1997, colloque “Les formes de l’usure / L’usura : forme della consunzione”, org. G. Ceriani et E. Landowski. Voir G. Ceriani, Forme dell’usura : lo spreco e l’impronta, Pre-pubblicazioni dell’Università di Urbino, 263, 1997 ; réédité en 2012 dans la revue de l’association italienne de sémiotique, E/C. 14 Cf. « La patine et la connivence », in E. Landowski et G. Marrone (éds.), La société des objets, Protée, 29, 1, 2009. |
3. Telles sont, nous semble-t-il, quelques-unes des formes élémentaires de la différence à la base du sentiment de changement. Or à partir de là, dès qu’apparaît l’impression que « ça change » se pose la question de ce que cela « veut dire ». Point n’est besoin de chercher bien loin un exemple à cet égard. Aujourd’hui — aujourd’hui enfin —, tout le monde le constate : partout, le climat est en train de changer. Ou plutôt, il a déjà dramatiquement changé15. Qu’est-ce à dire ? A quoi en rapporter la cause ou à qui en attribuer la responsabilité ? Telles sont les premières questions qu’on peut se poser dans l’espoir de donner un sens à cette mutation assurément décisive (bien qu’il n’en soit pas un instant question dans les articles qui suivent). Pour énormément de nos contemporains, les variations de ce genre sont dans l’ordre normal des choses. Ce sont des fluctuations programmées par « la nature » ; nous n’y sommes pour rien ; il n’y a rien à y faire. Que cela nuise le moins possible à la continuité de nos lucratives affaires, voilà l’essentiel. Pour d’autres, l’origine anthropique du « dérèglement » en question ne fait aucun doute. Par suite, des remèdes sont en principe possibles, au prix d’immenses changements sur mille autres plans. Du même coup, sans que le phénomène proprement dit ne change en rien — si ce n’est dans le sens de l’accélération et de l’aggravation —, il change de nom dans le vocabulaire des politiques. Il devient un beau jour « transition » (écologique) : manière de changer sinon la chose du moins le regard qu’on porte sur elle. Changer les noms pour ne pas avoir à changer les choses, ne serait-ce pas aussi un thème de réflexion à retenir pour une future « sémiotique (critique) du changement » ? |
15 Voir ici-même Cl. Calame, « Pour une sémiotique écosocialiste des relations de l’homme avec son environnement : phúsis et tékhnai ». |
|
Un conflit d’interprétations analogue s’était développé presque dans les mêmes termes lorsqu’il y a peu une pandémie est venue bouleverser toutes nos conditions d’existence. Pour certains gouvernants, il suffisait d’attendre — patiemment, passivement — le retour à la normale sans écouter ceux qui, analysant le phénomène comme une conséquence du régime de nos interactions avec l’environnement, appelaient à des changements radicaux de toutes nos pratiques en ce domaine. Tout comme à propos du changement climatique, d’un côté on niait au fond l’existence même du changement, vu comme retour cyclique du même, de l’autre lui était au contraire attribuée une signification qui interpellait chacun d’entre nous16. |
16 Voir le dossier « La pandémie : hasard ou signification ? », Acta Semiotica, I, 1 et 2, 2021, ainsi que E. Landowski, « Face à la pandémie », Degrés, 182, 2020. |
|
Ce ne sont là que quelques aperçus mais qui permettent, nous semble-t-il, de prévoir que l’analyse des processus de tous ordres auxquels renvoie l’idée de changement pourrait apporter une vue synthétique et coordonnée sur un ensemble de questions sémiotiques le plus souvent envisagées séparément mais qui toutes sont, plus ou moins directement, en relation avec la catégorie de base continuité versus discontinuité. Cela sans oublier la question immémoriale (quasi métaphysique) de ce qu’il en est de l’« identité » d’une grandeur quelconque (vue comme sujet ou comme objet) dans un univers où à chaque instant chacun et toute chose est en train de devenir autre. L’objectif du présent dossier est d’effectuer un premier pas en vue d’éclairer ce champ immense.
4. Pour cela, comment procéder ? Les discours sur ce qui est en train de changer, sur ce qui va changer, ce qui ne peut pas ne pas ou même doit changer (d’« urgence », ajoute-t-on volontiers en ce cas), ou au contraire à propos de ce qui ne pourra jamais ou ne doit surtout pas changer sont actuellement légion, aussi bien dans les médias que sur la scène politique et dans les conversations quotidiennes les plus ordinaires, qu’il s’agisse de propos relatifs à des mutations à petite échelle, d’ordre personnel ou local, ou de portée planétaire. L’analyse sémiotique de ces discours qui constatent, prônent ou déplorent des changements de tous ordres ne pose pas de problème théorique ou méthodologique particulier, pas plus que l’étude de n’importe quels autres discours relatifs à d’autres sujets. Pour traiter du changement, on a donc là un vaste matériel tout disponible. Pourtant, ce n’est pas de ce côté-là que s’est tournée l’attention des contributeurs du dossier. Aux discours, ils ont préféré la « chose même », si on peut dire. On se souvient à ce propos du regret que Greimas exprimait à l’égard du travail de Roland Barthes, qui, pour écrire Le système de la mode, s’était appuyé sur les journaux de mode au lieu de s’intéresser à la mode même17. Hélas, nous ne saurons jamais ce qu’aurait été, de la part de Greimas, une approche sémiotique de la mode « elle-même ». Sa propre thèse, elle aussi sur la mode (celle des années 1830), portait, ni plus ni moins que celle de Barthes, sur un corpus uniquement linguistique (« le vocabulaire vestimentaire d’après les journaux de mode de l’époque »), raison pour laquelle, bien plus tard, quand on le lui demanda, il refusa catégoriquement que ce travail à ses yeux dépassé soit publié18. A vrai dire, cette thèse datant de 1948, il ne pouvait pas en être autrement étant donné que Greimas ne réinventerait la sémiotique sur une base structurale dépassant les limites du linguistique qu’environ vingt ans plus tard19. |
17 Cf. A.J. Greimas, « Conversation » avec Alessandro Zinna, Versus, 43, 1984, p. 44. 18 Il le sera néanmoins — après sa mort, quelle qu’ait été sa volonté. Cf. La mode en 1830, Paris, P.U.F., 2000. 19 Est-il nécessaire de le rappeler ? Pour Greimas, « la sémiotique, ce n’est pas les langues naturelles. On est d’accord sur le fait qu’il n’y a pas de pensée sans langage, mais il s’agit là du langage au sens large du mot, donc pas seulement des langues naturelles mais aussi d’autres systèmes ». « Conversation », art. cit., p. 44. |
|
Mais sans doute sommes-nous mieux armés aujourd’hui pour penser sémiotiquement les phénomènes mêmes, par delà les discours, narratifs ou prescriptifs, qui les prennent en charge. C’est probablement ce qui explique que tous les auteurs dont les textes suivent aient laissé de côté la masse des discours sur le changement — le changement raconté — et pris le risque d’affronter, d’une manière ou d’une autre, le « changement même ». Deux voies différentes ont été explorées. Les uns — Giulia Ceriani, Jacques Fontanille, Franciscu Sedda —, se situant sur un plan géneral, ont cherché à apporter directement des éléments à une future théorie sémiotique du changement, quels que puissent en être les formes de surface et les domaines d’exercice. Les autres participants se sont attachés à l’analyse du déroulement de divers processus de changement. Selon les cas, il s’agit ou bien d’évolutions actuellement en cours et directement observables sur tel ou tel plan particulier — socio-politique (K. Caetano), esthético-politique (T. Migliore) ou politique tout court (E. Cuevas, S. Moreno et E. Yalán), ou encore alimentaire (I. Ventura) —, ou bien de mutations qui ont eu lieu soit dans un passé tout récent et relativement aisé à reconstituer (A. Perusset), soit au contraire dans un temps très ancien et n’ayant laissé que de rares traces très difficiles à interpréter (M. Hammad). Bien sûr, ces deux approches sont heuristiquement complémentaires. A terme, la construction théorique ne pourra que tirer parti de la variété des études ponctuelles disponibles (et réciproquement, ce qui est moins sûr mais qu’il faut espérer). Les quelques enseignements sémiotiques de caractère général qu’on peut d’ores et déjà tirer de la mise en relation de ces deux séries de travaux font l’objet de l’article conclusif de Paolo Demuru.
5. Pour notre part, nous nous bornerons à ajouter quelques remarques en marge des différentes pièces du dossier. A la base de la théorie sémiotique de la signification, une des idées les moins contestées est que la relation prime sur les termes qui en sont les aboutissants. Pourtant, chose curieuse, dans la pratique des analyses, lorsqu’il s’agit de rendre compte d’un changement, qu’il soit rapporté au fil d’un récit ou empiriquement observable, la démarche intellectuelle que nous constatons — démarche inspirée par la problématique narrative standard ou par le simple bon sens ? cela restera à déterminer — nous semble reposer implicitement sur l’idée exactement inverse : il y aurait d’abord des états de choses, jouant en l’occurrence le rôle de termes, et ensuite, sous certaines conditions, la dynamique relationnelle (interactionnnelle) susceptible de les transformer. Donnés en premier, les états de choses, les « situations » (en principe réductibles à des états de conjonction ou de disjonction des sujets par rapport à des valeurs) paraissent appelés à durer tels quels, « en l’état », à moins que, dans un second temps, n’intervienne le cas échéant quelque facteur de changement. Autrement dit, la transformation est pensée comme possible, non comme nécessaire. Pour qu’elle ait lieu, il faut qu’intervienne quelque agent anthropomorphe désireux que « ça change » ou quelque autre facteur capable d’exercer une force disruptive (ne serait-ce, encore une fois, que cet agent passe-partout, « le temps », censé « user » toute chose rien qu’en « passant »). Selon cette optique, alors que l’état va, somme toute, de soi — il n’a pas besoin d’être théoriquement fondé —, la transformation d’état, le changement apparaît comme presque hors norme. D’abord, par définition, il ne peut venir qu’en second puisqu’il présuppose un état premier, à transformer. Ensuite, contrairement à l’état, il doit être fondé en raison : c’est ce à quoi pourvoit la référence à l’action d’une forme ou une autre d’« agentivité » à même de dynamiser l’état de choses posé au départ, comme dans le conte populaire où le méchant vient de l’extérieur perturber l’ordre. Et si changement il y a, il débouche sur la production d’un nouvel état qui présente structuralement les mêmes propriétés que l’état initial, la même vocation à durer tel qu’en lui-même : pour l’essentiel, à l’arrivée, au « terme » final, un nouveau « temps étale » répète — re-produit — le temps étale de départ20. Enfin et surtout, le processus même de changement ne constitue qu’une éventualité, conditionnelle et nullement nécessaire. |
20 Cf. « Echelles du temps », art. cit., schéma p. 32. |
|
La perspective alternative qui nous semble à explorer consisterait à considérer qu’il y a au contraire, en tant que donné premier, un flux continu (celui du « temps qui passe »), un devenir-autre perpétuellement à l’œuvre pour toute chose. La transformation retrouve alors sa primauté de principe. Il n’y a pas des états figés dans leur immobilité jusqu’à ce que quelque intervention contingente vienne les faire bouger. La dynamique du passage constant d’un état à un autre, le mouvement est au contraire la règle. La seule continuité est la continuité paradoxale du changement. Par rapport à lui, les états ne sont que des arrêts artificiels, des sortes d’instantanés (à la manière des images de chevaux galopants photographiés par Etienne Marey) qui viennent figer le cours des choses continuement en marche. Cette inversion de perspective — le mouvement est premier, les arrêts sont presque des illusions — invite à un autre regatd sur le changement. Par ailleurs, si, parmi les nombreuses définition possibles, on retient l’idée du changement comme passage ou transition d’un état à un autre (« le jour se lève », « la neige fond ») ou comme remplacement d’un état de choses par un autre (« il faisait jour — il fait nuit »), le terme renvoie généralement à des processus qui ou bien se déroulent sous les yeux d’un observateur ou bien, dans le cas contraire, dont on peut plus ou moins reconstituer les étapes. Plus étrange, il désigne aussi parfois — au moins une fois par an — un rien : le rien qui, à minuit, le 31 décembre, sépare une année de la suivante (ou l’y rattache ?) sans qu’absolument rien ne change hormis le chiffre du millésime : tel est le mystère de la fête de la Saint-Sylvestre, valorisation du changement à l’état pur21. Mais ce cas mis à part, si le changement nous intéresse, ce n’est pas uniquement en tant qu’observable à distance. |
21 Cf. « Mode, politique et changement », art. cit., 4.1 « Vertu de l’inchoatif ». |
|
C’est aussi en tant que devenir existentiellement vécu. Et souvent, c’est alors un sentiment de continuité qui prime, comme si rien ne changeait. A tel point que ce n’est qu’après coup, moyennant le détour par quelque forme de résurrection, de reconstitution ou de redécouverte du temps révolu (forme du « temps retrouvé »), que l’effectivité du changement se donne à saisir. Sur ce mode imperceptible de la « transformation silencieuse »22, les styles de vie, les façons de parler, mon propre corps, mes goûts, mes points de vue... inexorablement, tout change. Qu’est-ce, dans ces conditions, qu’être « de son temps » sinon continuellement changer, et plus précisément changer en mesure, en épousant la cadence des transformations qui, autour de soi, affectent tous les plans de la vie quotidienne, et sans doute aussi de la pensée ? Adhérer à son propre être-en-devenir ne reviendrait alors qu’à se conformer, fût-ce sans même s’en apercevoir, à l’air du temps, à l’épistémé, ou tout simplement à la mode, perpétuel changement par principe, qui peut-être n’a pas de meilleure justification que de satisfaire le désir et le plaisir du changement : la mode, changement pour le changement. Du fait même qu’elle n’est que changement, la mode, écrivait Georg Simmel, « se [tenant] constamment sur la ligne de partage des eaux entre le passé et l’avenir, nous dispense (...) un fort sentiment de présent, comme peu d’autres phénomènes en sont capables”23. Théoriser le changement, ce serait aussi, nous semble-t-il, chercher à rendre raison de cet aspect vécu. |
22 Expression empruntée à François Jullien, Les transformations silencieuses, Paris, Grasset, 2009. Cf. aussi « Mode, politique et changement », art. cit., 3.3 « Le détour rétrospectif ». 23 G. Simmel, « La mode » (1909), Philosophie de l’amour, Paris, Rivages, 1988, p. 101, cité dans « Mode, politique et changement », art. cit. (in fine). |
|
Enfin, nous ne saurions conclure ces remarques éparses sans dire un mot des rapports entre le thème de ce dossier et la théorie interactionnelle que nous défendons. Notre approche étant fondée sur l’opposition entre continuité et discontinuité, il ne serait ni très difficile ni inapproprié de l’interpréter comme une réflexion sur la manière dont les choses « changent » — ou ne changent pas. Ce que nous appelons la « programmation » est un régime de sens et d’interaction qui suppose le règne de lois immuables, qui valorise la continuité, prône le statu quo, commande la résistance au changement : c’est le triomphe du conservatisme, attitude conduisant à des stratégies destinées à contrer les facteurs de déstabilisation de l’existant. A l’opposé, on trouve une configuration où tout n’est que ruptures, solutions de continuité, sous la forme soit d’accidents ponctuels (« catastrophiques » au sens mathématique mais aussi selon l’acception usuelle du terme), soit de lents processus de mutation remettant inexorablement en cause les données apparemment les plus stables. Et on a par ailleurs, entre ces deux pôles, des configurations plus complexes où, d’un côté, le changement des rapports entre agents passe par la concertation (gage de non-discontinuité) et la contractualité, autrement dit par la « manipulation » intersubjective, et où, de l’autre côté, l’impermanence (la non-continuité) de toute chose est vécue sur le mode d’« ajustements » entre des présences épousant mutuellement leurs dynamiques respectives. Loin de prétendre qu’on ait là une théorie sémiotique du changement en bonne et due forme, il nous semble que ce modèle fournit du moins quelques points de repère en articulant entre eux ce que Jacques Fontanille appelle ici-même des « régimes » du changement. |
|
Bibliographie AAVV, dossier « Sémiotique et organisations. Critique, réforme, dépassement », Actes Sémiotiques, 122, 2019. AAVV, dossier « La pandémie : hasard ou signification ? », Acta Semiotica, I, 1 et 2, 2021. Barthes, Roland, Eléments de sémiologie, Communications, 4, 1964. Calame, Claude, « Pour une sémiotique écosocialiste des relations de l’homme avec son environnement : phúsis et tékhnai », Acta Semiotica, III, 6, 2023. Ceriani, Giulia, Forme dell’usura : lo spreco e l’impronta”, Urbino,Università di Urbino, Pre-pubblicazioni, 263, 1997 ; rééd. E/C, 2012. Fontanille, Jacques, « La patine et la connivence », in E. Landowski et G. Marrone (éds.), La société des objets, Protée, 29, 1, 2009. — (éd.), Le devenir, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1997. Greimas, Algirdas J., et Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. — « Conversation » avec Alessandro Zinna, Versus, 43, 1984. — La mode en 1830 (1948), Paris, P.U.F., éd. posthume, 2000. Hammad, Manar, « De l’espace et des hommmes. Identité de groupe et traces de la privatisation de l’espace et de la propriété à l’époque néolithique », Acta Semiotica, III, 5, 2023. Jullien, François, Les transformations silencieuses, Paris, Grasset, 2009. Landowski, Eric, « Continuité et discontinuité. Vivre sa génération », La société réfléchie, 1989. — « Mode, politique et changement », Présences de l’autre, 1997. — « Les échelles du sens », Avoir prise, donner prise, Limoges, Pulim, 2009. — « Face à la pandémie », Degrés, 182, 2020. — « Échelles du temps », E/C, 32, 2021. — et P. Stockinger, « Problématique de la manipulation : de la schématisation narrative au calcul stratégique », Degrés, 44, 1985. Simmel, Georg, « La mode » (1909), Philosophie de l’amour, Paris, Rivages, 1988. |
|
1 Actes Sémiotiques, 122, 2019, dossier « Sémiotique et organisations. Critique, réforme, dépassement ». 2 A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. 3 Toute modestie mise à part, cette exception, c’est nous, en particulier dans « Continuité et discontinuité. Vivre sa génération » (La société réfléchie, 1989), « Échelles du temps » (E/C, 32, 2021) et surtout « Mode, politique et changement » (Présences de l’autre, 1997), article entièrement consacré à la notion qui nous occupe aujourd’hui. 4 Voir notamment J. Fontanille (éd.), Le devenir, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1997. 5 R. Barthes, Eléments de sémiologie, Communications, 4, 1964, p. 118. 6 Sur le temps « étale », cf. « Échelles du temps », art. cit. (§3.Prospective et désillusion). 7 Voir ici même les remarques de Franciscu Sedda sur les ruses cosmétiques contre « l’usure du temps ». 8 Cf. E. Landowski et P. Stockinger, « Problématique de la manipulation : de la schématisation narrative au calcul stratégique », Degrés, 44, 1985. 9 M. Hammad, « De l’espace et des hommmes. Identité de groupe et traces de la privatisation de l’espace et de la propriété à l’époque néolithique », Acta Semiotica, III, 5, 2023, p. 159. 10 Cf. E. Landowski, Avoir prise, donner prise, Limoges, Pulim, 2009 (2e partie, « Les échelles du sens »). 11 A propos de la superposition des échelles d’observation macro-, méso- et microscopiques, outre le texte mentionné ci-dessus, cf. E. Landowski, « Échelles du temps », art cit. (§2, « La discordance des temps »). 12 Il est vrai néanmoins que pour rendre compte d’un changement décisif, d’ordre institutionnel — l’apparition des rapports de propriété —, le sémioticien Hammad ne peut pas ne pas se faire aussi, pour une part, archéologue, historien, anthropologue. Voir sa contribution au dossier qui suit, « Des choses et des hommes : les prémices de la propriété des objets ». 13 7-9 juillet 1997, colloque “Les formes de l’usure / L’usura : forme della consunzione”, org. G. Ceriani et E. Landowski. Voir G. Ceriani, Forme dell’usura : lo spreco e l’impronta, Pre-pubblicazioni dell’Università di Urbino, 263, 1997 ; réédité en 2012 dans la revue de l’association italienne de sémiotique, E/C. 14 Cf. « La patine et la connivence », in E. Landowski et G. Marrone (éds.), La société des objets, Protée, 29, 1, 2009. 15 Voir ici-même Cl. Calame, « Pour une sémiotique écosocialiste des relations de l’homme avec son environnement : phúsis et tékhnai ». 16 Voir le dossier « La pandémie : hasard ou signification ? », Acta Semiotica, I, 1 et 2, 2021, ainsi que E. Landowski, « Face à la pandémie », Degrés, 182, 2020. 17 Cf. A.J. Greimas, « Conversation » avec Alessandro Zinna, Versus, 43, 1984, p. 44. 18 Il le sera néanmoins — après sa mort, quelle qu’ait été sa volonté. Cf. La mode en 1830, Paris, P.U.F., 2000. 19 Est-il nécessaire de le rappeler ? Pour Greimas, « la sémiotique, ce n’est pas les langues naturelles. On est d’accord sur le fait qu’il n’y a pas de pensée sans langage, mais il s’agit là du langage au sens large du mot, donc pas seulement des langues naturelles mais aussi d’autres systèmes ». « Conversation », art. cit., p. 44. 20 Cf. « Echelles du temps », art. cit., schéma p. 32. 21 Cf. « Mode, politique et changement », art. cit., 4.1 « Vertu de l’inchoatif ». 22 Expression empruntée à François Jullien, Les transformations silencieuses, Paris, Grasset, 2009. Cf. aussi « Mode, politique et changement », art. cit., 3.3 « Le détour rétrospectif ». 23 G. Simmel, « La mode » (1909), Philosophie de l’amour, Paris, Rivages, 1988, p. 101, cité dans « Mode, politique et changement », art. cit. (in fine). |
|
______________ Mots clefs : changement, continuité / discontinuité, mode, permanence / impermanence, temps. |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |
|
Recebido em 10/10/2023. / Aceito em 30/11/2023. |