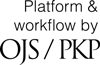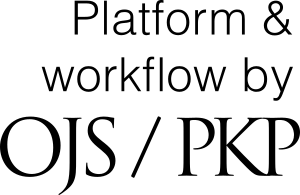Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
In vivo — Miroirs du stade
|
Malheur aux vaincus ! Françoise Ploquin
Publié en ligne le 30 juin 2023
|
|
|
En 390 avant notre ère, les Gaulois soumirent Rome à un siège qui dura sept mois. Des négociations eurent lieu avec les assiégés affamés aux termes desquelles une rançon de mille livres d’or fut exigée pour libérer la ville. Au dernier moment, Brennus, le chef gaulois, augmenta encore le poids d’or exigé en jetant son épée et son baudrier dans la balance. « De quel droit ? » s’indignèrent les Romains. Vae victis répondit le vainqueur, selon Tite-Live. C’est ce cri, « Malheur aux vaincus ! », qui semblait résonner dans la tête des joueurs de l’équipe de France après la grande Finale du Mondial de football qu’ils venaient de perdre, le 18 décembre 2022, face aux Argentins, après un match haletant terminé par une séance de tirs au but. Dès le match achevé, chaque joueur, chaque équipe et par un phénomène de contagion propre au sport, chaque ressortissant (ou presque) des deux pays représentés adopta, en l’espace d’un instant, le rôle « pathémique » que le talent, complété par la chance, venait d’attribuer aux uns et aux autres : aux Argentins l’allégresse, aux Français la honte. Gens qui pleurent et gens qui rient Lorsque les vainqueurs sud-américains ont brandi le trophée mondial, les Argentins devant leurs écrans pleuraient de bonheur ; il s’en est suivi une nuit blanche où la joie éclatait dans les maisons, dans les cafés, dans les rues, dans les campagnes, dans le pays tout entier. Lorsque, quelques jours plus tard, l’équipe victorieuse, brandissant la Coupe, a défilé sur la grande avenue de Buenos Aires, elle a tracé son sillage au milieu d’une foule en liesse. L’euphorie fut telle qu’elle a parfois même confiné au délire. Le jour du retour des joueurs a été déclaré jour férié, les écoles et les administrations ont fermé afin que chaque citoyen puisse pleinement savourer son ravissement, dans un bonheur collectivement ressenti. Les difficultés économiques du pays ont été, un temps, oubliées, les sujets de conflit abolis, les rancœurs évanouies. L’allégresse aurait-elle atteint un pareil niveau d’intensité si l’Argentine était sortie victorieuse d’une guerre meurtrière ? On peut en douter. A quoi comparer une telle euphorie ? Très certainement à la joie immense que manifestèrent les Français quand ils furent sacrés champions du monde en 2018, de même que précédemment, en 1998. Même ferveur d’un peuple devenu tout entier supporter de son équipe de football, mêmes rassemblements joyeux, même griserie de la victoire. Tout à coup, d’un continent à l’autre, les différences culturelles, qu’on se plaît à souligner dans d’autres contextes, n’existent plus. Mieux, les passions qu’on dit habituellement individuelles, à la fois instinctives et culturellement spécifiées, se montrent ici sous une lumière crue : elles sont, pour une bonne part, collectives, programmées et universelles. Pendant ce temps, accablés par le poids de leur défaite, les joueurs français, pourtant arrivés en finale au faîte d’un parcours en lui-même héroïque, affichaient sur leur visage la honte de l’humiliation au point de ne pas souhaiter se montrer en public. Il avait fallu toute la force de conviction de leur entraîneur, arguant que venir saluer leurs supporters faisait partie des obligations du métier, pour qu’ils consentent à se présenter aux nombreux spectateurs enthousiastes venus les féliciter et les acclamer, à Paris, place de la Concorde. Le lendemain de la Finale, le lundi 19 décembre, la place était noire de monde ; certains supporters avaient attendu plus de cinq heures l’arrivée de leurs héros quand, vers 21 heures 30, le gardien de but et les défenseurs, les milieux de terrain puis les attaquants vinrent se montrer au balcon de l’hôtel Crillon qui domine la vaste esplanade. D’un côté des barrières de protection destinées à contenir les élans passionnés d’un public fier, reconnaissant et ravi ; de l’autre, face à eux, au balcon, des joueurs honteux, accablés et malheureux. Ils étaient là, sur leur promontoire, mal à l’aise, sans voix et sans micro, la mine triste, toujours rongés par l’obsession du ratage. Seuls deux anciens, qui avaient connu quatre ans plus tôt la liesse populaire réservée aux champions du monde, finirent par afficher un sourire contraint tout en agitant la main pour répondre aux acclamations de la foule ; les vingt-deux autres joueurs, immobiles, tristes, empruntés, ne parvinrent pas, durant les cinq minutes à peine que dura cette exposition aux regards, à esquisser le moindre sourire. L’esprit de Championnat opposé à l’esprit de Coupe Les observateurs naïfs peuvent s’étonner d’une telle différence de traitement accordé au premier et au deuxième de la compétition, alors que l’écart dans le jeu est minime et que le hasard — particulièrement dans le cas des tirs au but — fait souvent la décision. Au regard de l’enchantement vécu par les Argentins, le mal-être palpable vécu par l’équipe de France et les citoyens français peut paraître difficile à expliquer. Et pourtant... Et pourtant, arriver à ce niveau de la compétition est un véritable exploit. La sélection s’effectue tout au long des deux ans qui précèdent le grand moment. Sur la ligne de départ se présentent toutes les équipes nationales reconnues par la FIFA, soit 210 équipes. Durant le « Tour préliminaire » le monde est divisé en six zones. L’Europe par exemple aligne dans cette phase de qualification cinquante cinq équipes, dont seules treize seront qualifiées. Les pays sont répartis dans des poules de douze équipes qui s’affrontent régulièrement, la peur au ventre, pendant les deux ans précédant la date fatidique. Dans la dernière confrontation, la France, sortie première de son groupe, s’est hissée vers la phase décisive disputée au Qatar ; mais l’Italie, par exemple, classée deuxième de sa poule, a dû disputer des matches de barrage qu’elle a perdus (trois places seulement pour douze deuxièmes). L’Italie, qui fut quatre fois championne du monde et qui concourait pour le Mondial 2022 avec le titre de Champion d’Europe, s’est donc trouvée dès ce tour préliminaire éliminée de la compétition, tout comme la Turquie ou la Russie. Après ce parcours du combattant, ce sont les trente et une équipes victorieuses de cette redoutable sélection qui ont été invitées au Qatar (le pays hôte disposant automatiquement de la trente deuxième place). A ce stade, les rescapés méritent déjà grandement la reconnaissance de leurs supporters. Après le tour préliminaire commence la grande épreuve qui va durer un mois et est retransmise sur tous les écrans du monde. Elle comporte deux phases. La première est jouée selon les règles d’un championnat. La seconde, celle des huitièmes, quarts de finale, demies-finales et finale, est disputée dans un esprit de coupe, c’est-à-dire à élimination directe.
Or, si arriver deuxième dans une épreuve mondiale est en soi une prouesse, le schéma actantiel sous-jacent au règlement, en séparant radicalement l’esprit de Coupe de l’esprit de Championnat, change non moins radicalement le sens de cette prouesse. Le Mondial, qui se joue tous les quatre ans, est régi par les règles propres à la Coupe et toutes les émotions qu’il provoque dépendent de ce cadrage. L’esprit de Championnat est pacifique, il favorise le partage. Il s’approche de la mentalité olympique, mondiale elle aussi, où sont décernées des médailles, d’or pour le premier, d’argent pour le deuxième, de bronze pour le troisième. En championnat, le destinateur suprême est l’excellence et les équipes qui s’affrontent sont classées sur une même échelle de valeurs ; l’estime se distribue de façon graduelle. Les termes de la confrontation se pensent comme une comparaison entre rivaux. Les passions que déclenchent les épreuves sont mesurées ; elles accordent la fierté aux premiers et une bonne part d’estime aux moins bien classés ; elles rendent ainsi largement hommage aux deuxièmes et aux troisièmes. Nous sommes dans le registre du continu. Le championnat se caractérise par l’image du podium où, sur une marche élevée aussi bien que sur les marches basses, chacun sourit du bonheur d’avoir réussi — plus ou moins bien, certes, mais chacun a été touché par l’aile de la victoire. L’esprit de la Coupe, celui du Mondial de football, est guerrier, il favorise l’exclusion. Le destinateur unique est la Victoire qui signifie l’écrasement sans pitié du vaincu. Les passions que suscite cette élimination structurelle sont extrêmes. C’est le triomphe d’une pensée du discontinu sur une pensée du continu, du catégorique sur le graduel, du discrétisé sur le nuancé, du structural sur le tensif. Celui qui est battu connaît l’humiliation ; il est réduit à néant, rejeté ignominieusement. A ses oreilles résonne le Vae victis des triomphes antiques. Ainsi l’Allemagne, comme l’Italie quatre fois vainqueur de l’épreuve, a-t-elle été éliminée lors du Premier tour ; l’Espagne a été chassée en huitième de finale, les Pays-Bas et le Brésil en quart de finale, de même que le Portugal et l’Angleterre. Le parcours est jonché de vaincus ; à y bien regarder, l’épreuve entière fait figure d’hécatombe programmée. Le vainqueur, tel un conquérant sanguinaire et impitoyable est comparable à saint Georges terrassant le dragon. Revenons à la question autour de laquelle s’organise le sentiment de la réussite ou celui de l’échec. Elle tient à la multiplicité des destinateurs. La communion de tout un pays avec les joueurs qui ont remporté le trophée montre que l’équipe est considérée comme la représentante de tout un peuple. Tel le combat engagé jadis entre les Horace et les Curiace, lors des grandes manifestations sportives l’affrontement entre les équipes est vécu comme la métonymie d’un affrontement entre les peuples. Le destinateur final serait donc la nation. On voudrait le croire, mais une image prise tout juste après la fin du match permet d’en douter. Mbappé, couronné du titre envié de meilleur buteur de la compétition, est effondré sur l’herbe du stade, la tête entre les mains, en proie à une infinie tristesse. Le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, grand amateur de football et admirateur du jeune prodige, descend sur le terrain et lui prodigue des paroles d’encouragement. Non, il n’y a pas de quoi pleurer, le parcours de l’équipe a été superbe ; la nation est reconnaissante à ses joueurs ; il doit sortir du terrain la tête haute. Reconnu comme héroïque par le destinateur suprême, le joueur devrait retrouver le sourire… Il n’en est rien. Mbappé, tout à son chagrin, a-t-il seulement perçu la présence du chef de l’Etat ? On peut en douter. La même incompréhension entre un destinateur satisfait et un sujet inconsolable se retrouve dans la cérémonie ratée de la Place de la Concorde. A supposer que la figure du président ne suffise pas en ces circonstances à représenter la nation, c’est le peuple qui se doit d’attribuer la récompense. Et il est là, moins dense certes que quatre années plus tôt où la foule en liesse s’étirait sur les deux kilomètres et demi qui séparent l’Arc de triomphe de la Place de la Concorde, mais tout de même présent, reconnaissant, applaudissant, remerciant l’équipe. Le peuple admet d’être représenté par cette équipe car il estime que loin d’avoir démérité, elle est arrivée assez près de la Victoire pour être fêtée. Mais il apparaît que le mandataire a si bien intégré la mission qui lui a été impartie — être le gagnant — qu’il subit la défaite comme une blessure personnelle alors même que l’instance qu’il représente manifeste sa satisfaction. Autre conséquence de cette étrange répartition des rôles : le deuxième connaît le désarroi absolu alors que le troisième rentre dans son pays auréolé d’un succès relatif. En effet, le règlement veut qu’avant la Grande Finale se joue la Petite Finale qui oppose les perdants des deux demi-finales. De cette épreuve ressort un vainqueur, qui en éprouve toutes les joies, et un vaincu dont le statut de perdant est simplement confirmé. Ce statut de troisième est intéressant à observer. L’équipe, de même que le pays qu’elle représente, sont soumis à une double contrainte. L’intensité de la morsure de la défaite se trouve tempérée par la résurgence du sentiment de la gagne. Il en résulte un curieux doux amer qui rend le sort du troisième finalement plus enviable que celui du deuxième, pour sa part tout accablé du seul venin de l’échec. Dans ce nuancier des émotions, les Français ont fini défaits alors que les Croates, en troisième position, sont rentrés au pays légèrement réhabilités. La promptitude avec laquelle les acteurs endossent leur rôle fait que les deuxièmes, revêtus de la tunique ignominieuse des vaincus, restent à jamais humiliés alors que les troisièmes, qui ont connu la rédemption d’une demie victoire en éprouvent un partiel réconfort. Le baiser du dieu de la Victoire Une des particularités du Mondial est que le titre de champion du monde ne se partage pas. Pourtant, aux Jeux olympiques, le second, honoré par la médaille d’argent, est largement respecté et fêté. Et surtout, en cas d’égalité (par exemple l’obtention du même temps dans les épreuves chronométrées), deux médailles d’or peuvent être attribuées. De même, il est arrivé qu’au Festival de Cannes, dans l’impossibilité de trancher entre des lauréats, deux palmes d’or soient décernées à deux films en compétition (par exemple, en 1993, La leçon de piano de Jane Campion a reçu la Palme ex-aequo avec Adieu ma concubine de Kaige Chen). En revanche, au Mondial, surtout en cas de match nul, comme ce fut le cas lors de l’édition 2022, l’attribution du titre (unique) de champion du monde dépend d’une disposition réglementaire qui, pour trancher, tend à remettre la décision au hasard. Dans la notation du résultat final, l’égalité est certes mentionnée, mais en quelque sorte seulement pour mémoire, car le résultat final n’en tient pas compte. Le caractère ex-aequo de l’affaire est lisible : « 3-3 (4-2) », la notation entre parenthèses indiquant le résultat des tirs au but après prolongation, résultat qui lui seul est décisif bien qu’il laisse une grande place au hasard, rien en effet n’étant plus incertain qu’un tir au but, même pour un très grand joueur. Il n’en a pas toujours été ainsi. Avant 1986, lors de la Finale, en cas d’égalité après prolongations, le match était rejoué. Mais depuis cette date, trois Coupes du monde sur dix (dont deux impliquant la France) se sont jouées au quasi hasard des tirs au but. Autrement dit, si l’esprit de la gagne à tout prix ne prévalait pas, il pourrait y avoir deux gagnants, soit deux peuples en liesse au lieu d’un. Face à la suprématie absolue dont jouit le vainqueur se pose une question de vocabulaire. Aux Jeux Olympiques, on parle de dauphins. Quel nom, au Mondial, désigne celui qui n’a pas obtenu le titre ? Il restera éternellement finaliste, un mot qui change totalement de connotation selon qu’il est prononcé avant ou après l’épreuve décisive. Avant, c’est la joie de s’approcher du graal et les supporters chantent à l’envi : « On est en finale, on est en finale… ». Après le dernier match, les gagnants partent avec le titre chéri de champion, les perdants avec la dénomination descriptive et inaboutie de finaliste, acquise lors du match précédent, signifiant alors : « ayant participé à une finale sans l’avoir remportée » !
Le rôle joué par le hasard dans la désignation du vainqueur est capital. Remarquons d’abord que lors de la phase finale de la compétition, celle qui a duré un mois au Quatar, les épreuves ont, conformément au règlement, débuté par une phase de poules (donc régie par l’esprit de championnat), suivie, à partir des huitièmes de finale, d’une ultime série de matchs débouchant, élimination après élimination, sur la désignation d’un unique vainqueur. L’Argentine, finalement couverte de gloire, a été battue dans cette première phase (sans conséquence puisqu’en régime de poule) par l’Arabie Saoudite, pays peu réputé pour ses exploits footballistiques… Ainsi, le vainqueur de la Coupe a-t-il été sauvé du désastre par le règlement du championnat ! Le vent du hasard a soufflé sur l’épreuve… N’est-il pas paradoxal que le règlement, c’est-à-dire ce qui, dans toute organisation, constitue en principe le garant de la régularité, de la constance, de la prévisibilité des processus, aboutisse en l’occurrence à accroître le poids de ce qui représente au contraire l’essence même de ce qu’on peut imaginer de plus imprévisible, le hasard ? |
|
|
Si on revient sur le déroulement du match décisif, on se rendra aisément compte du rôle capital que l’imprévu a joué tout au long. D’un bout à l’autre, le match fut palpitant par les retournements de situation inattendus auxquels il donna lieu. Pendant toute la première mi-temps et le début de la seconde, l’équipe de France, sans doute impressionnée par l’ampleur de l’enjeu, ne parvint pas à entrer dans le match. Dans un coup d’audace désespéré, comparable à celui qui envoya au front les soldats de l’An II ou les taxis de la Marne1, le sélectionneur Didier Deschamps remplaça les vedettes défaillantes qui pendant une heure de jeu n’avaient tenté aucun tir en direction des buts, par des jeunes peu expérimentés mais ardents ; sept changements furent effectués au cours du match ! A dix minutes de la fin du temps réglementaire, l’équipe de France est menée 2–0. A la quatre-vingtième minute, Mbappé transforme un penalty puis, une minute plus tard, marque un superbe but : 2–2. D’où trente minutes de prolongation au cours desquelles Messi, la star argentine, marque un but, suivi, en réplique, d’un but inscrit sur penalty par Mbappé, la star française. Dans le temps additionnel de la prolongation, le jeune Randal Kolo, tout nouveau dans l’équipe tricolore, décoche un tir superbe que le gardien argentin parvient in extremis à repousser du bout du pied. C’est à cette minute que la Victoire échappa aux Champions du monde encore titulaires du titre. Puis les tirs au but ratés par la France eurent l’effet de deux « coups brefs frappés à la porte du malheur », pourrait-on dire en parodiant Camus dans l’Etranger. Le scénario présenta de tels sursauts d’émotion que tous les commentateurs évoquèrent le caractère admirable du déroulement du spectacle qui, entre défaite assurée, retournement inespéré puis égalisation finale, rythma le cours du match. Aussi le mot de dramaturgie, jusqu’alors rarement utilisé par le grand public, émailla-t-il pendant quelques jours les récits qui suivirent l’événement. Deux inconnus, abordant le sujet dans un café ou dans un train, ponctuaient invariablement leurs propos de l’exclamation légèrement savante : « Ah, vous avez vu ça, dimanche dernier… quelle dramaturgie ! ». Le sentiment que le hasard joue un rôle prépondérant dans l’obtention du résultat final fait que l’appréciation de la qualité du jeu est reléguée au second plan. La victoire existe, est la Victoire, indépendamment du processus qui a permis d’y arriver. Et plus approche fin de l’épreuve, plus le rôle du hasard devient prépondérant, sur le terrain comme dans les esprits. L’intensité de l’enthousiasme provoqué par la victoire est d’autant plus grand que la part de chance pour y parvenir est palpable. Un résultat acquis grâce à une suprématie technique évidente est moins savoureux qu’une victoire acquise à l’arraché. Sinon, comment expliquer l’écart colossal qui sépare l’euphorie du vainqueur de la détresse du vaincu, alors que chacun peut juger combien, du point de vue de la compétence purement footballistique, l’écart qui sépare les deux formations est minime ? Tout au cours du match — on pourrait même dire tout au cours de l’épreuve —, c’est la rationalité technique et stratégique qui est observée par les supporters et les commentateurs. On scrute les hors-jeu quand bien même il n’apparaissent au ralenti que sur une photo-témoin qui en révèle le caractère millimétrique. On compte les mètres parcourus, le nombre de passes effectuées, les duels gagnés par chaque joueur. On admet les coups francs et les penaltys décidés par l’arbitre. Tout au long de la partie le supporter observe la stratégie mise en œuvre par les deux équipes dans une rationalité quasi professionnelle. Mais au moment du coup de sifflet final, une autre rationalité, magique et passionnelle celle-là, l’emporte et le submerge. Comme si le dieu de la victoire avait accordé son baiser à l’un des deux combattants. Tout à coup ce n’est plus la compétence des joueurs qui importe mais un choix comme divin qui vient accorder sa grâce à son élu. Les deux types de rationalité, la technique et la magique, coexistent bien durant le parcours mais c’est au résultat final qu’explose l’immense bonheur d’avoir été désigné par le dieu de la Victoire. Les joueurs de poker connaissent bien la superposition des joies provoquées par l’efficacité technique accompagnées et bientôt supplantées par la griserie face au rôle joué par la chance. Ce qui est exaltant, c’est ce moment où, parvenu au sommet grâce à la compétence technique, l’état d’esprit change de registre et passe d’un comportement largement rationnel distributeur d’estime à un éblouissement magique. Quand le président de la République vient dans les vestiaires après le match féliciter les joueurs, il ne leur dit pas : « Vous avez bien joué », il leur dit : « Vous avez fait rêver tout un peuple ». Les fées ou les anges ont un moment flotté autour des maillots des Bleus avant d’aller se poser sur ceux de l’Albiceleste !
La vertu du Mondial de foot dans son universalité ne serait-elle pas de mettre clairement à jour ce mécanisme des comportements humains qui après avoir, dans un parcours évolutif et continu, agi selon une rationalité revendiquée, débouche au bout de l’aventure sur une autre logique pour s’adonner tout entier à la passion en même temps qu’à une sorte d’assentiment à l’inespéré-qu’on-espère — ou qu’on redoute — au pur aléa. Combien, dans l’univers politique aussi bien qu’économique, oublient les calculs précis et détaillés qui les ont menés à adopter une position pour devenir in fine passionnés par l’esprit de la gagne ? Lors de cette Coupe du monde, le dieu de la Victoire a longuement hésité avant de se décider à retirer la couronne de lauriers du front des précédents vainqueurs pour la poser sur la tête des nouveaux élus. Ce geste ressenti comme venu d’en haut plus que du terrain a plongé tout un peuple dans l’extase alors qu’il rendait inconsolable son adversaire malchanceux. De son début jusqu’à sa fin, que d’émotions a offert le Mondial aux spectateurs du monde entier dans une inégalable dramaturgie ! |
1 Les soldats de l’an II : le 2 mars 1793, an II de la Révolution française, face à l’invasion des Prussiens, la Convention décide soudain la mobilisation de trois cent mille hommes en état de porter les armes. Les Taxis de la Marne : pendant la première guerre mondiale, les 6 et 7 septembre 1914, l’armée française réquisitionne d’un jour à l’autre tous les taxis parisiens pour transporter environ 6000 hommes sur le champ de bataille de la Marne. NDLR. |
1 Les soldats de l’an II : le 2 mars 1793, an II de la Révolution française, face à l’invasion des Prussiens, la Convention décide soudain la mobilisation de trois cent mille hommes en état de porter les armes. Les Taxis de la Marne : pendant la première guerre mondiale, les 6 et 7 septembre 1914, l’armée française réquisitionne d’un jour à l’autre tous les taxis parisiens pour transporter environ 6000 hommes sur le champ de bataille de la Marne. NDLR. |
|
______________ Mots clefs : aléa, catégorique vs graduel, compétence, défaite / victoire, discrétisé vs nuancé, structural vs tensif, règle. Plan : Gens qui pleurent et gens qui rient L’esprit de Championnat opposé à l’esprit de Coupe |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |
|
Recebido em 31/03/2023. / Aceito em 10/04/2023. |