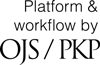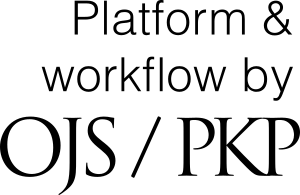Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
Dossier : Règles, régularités et création
|
La sémiotique en prise Nijolé Kersyté
Publié en ligne le 26 décembre 2022
|
|
|
Introduction : prévisibilité et nouveauté Toute l’entreprise structurale, dès son début, s’est orientée vers le social (le collectif) à l’encontre de l’individuel, vers le commun (le normal) à l’encontre du particulier (l’anormal), vers le général ou l’universel à l’encontre du singulier. Cette perspective était déjà tracée dans la linguistique structurale, celle de Saussure et de Hjelmslev. Chez Saussure, cela se manifestait par le choix d’analyser le système comme relevant du social par opposition à la réalisation (la parole) relevant de l’individuel. Chez Hjelmslev, par le projet de constituer une « science systématique, exacte, généralisatrice » qui permette « de prédire tous les événements possibles (c’est-à-dire toutes les combinaisons possibles d’éléments), et les conditions de leur réalisation »1. |
1 L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, 1968, p. 16. |
|
Si la recherche structurale consiste à mettre en évidence et à décrire le système de tous les phénomènes réels mais aussi possibles et donc prédictibles, alors comment une nouveauté est-elle possible dans ce type d’entreprise ? Dans un tel cadre, chaque phénomène (un texte, un discours, une œuvre, un événement), n’est-t-il pas une simple réalisation d’un schéma, d’un modèle ou d’une structure connue à l’avance et a priori ? Et en ce cas, faut-il admettre que l’approche structurale ne pourrait rendre compte d’aucune véritable nouveauté ni créativité ? Autrement dit, quel est le rapport entre l’œuvre singulière et le système général dans la perspective structurale ? Il est impossible de parler de la structure d’un objet particulier : un texte, une institution. Ce qui est structuré n’est pas la chose elle-même, comme le croit souvent la critique littéraire (qui va parfois jusqu’à désigner dans la structure ce qui ferait l’originalité de l’œuvre qu’elle étudie !) mais c’est l’ensemble dont cette chose peut être considérée comme une représentation, comparé à d’autres ensembles. C’est pourquoi le structuralisme va de la structure au modèle.2 |
2 V. Descombes, Le même et l’autre, Paris, Minuit, 1979, p. 106. |
|
Ce passage du philosophe Vincent Descombes, qui décrit le structuralisme français (la sémiologie) et le compare à l’approche phénoménologique, renferme toutes les tensions de l’approche structurale. Il est vrai que les structuralistes, que ce soit en linguistique, en anthropologie, en littérature ou ailleurs, pour décrire un système « primaire » (celui de la langue de communication) ou « secondaire » (celui du langage des rapports sociaux, de la mode, de la cinématographie, des contes, des mythes ou des récits)3, ne se sont presque jamais occupés d’un objet particulier mais toujours d’un ensemble, d’un « corpus » (entendu comme une série d’occurrences formant un tout). Cela veut-il dire que l’approche structurale ou sémiologique non seulement ne s’intéresse jamais à l’objet particulier en tant que tel mais n’est pas non plus en mesure de rendre compte de sa particularité ou de sa singularité ? Voilà maintenant un autre point de vue, cette fois-ci non pas celui d’un témoin extérieur mais d’un participant du structuralisme. Dans « L’actualité du saussurisme », après avoir énuméré les études centrées sur l’individuel ou le particulier dans l’art, Greimas ajoute : Nous ne voudrions pas qu’on se méprenne sur nos intentions : une telle définition de l’œuvre individuelle est utile, nécessaire même, et un grand pas sera fait le jour où l’on pourra définir celle-ci linguistiquement, voire sémiologiquement, sans faire appel à des catégories esthétiques ou psychologiques toujours un peu inquiétantes.4 |
3 Au début, dans le prolongement de l’idée de la sémiologie de Saussure, on les appelait « systèmes secondaires de signes ». Dans la sémiotique de Greimas, le système secondaire à décrire, c’est le système des discours d’une substance quelconque et, plus tard, de n’importe quelle entité signifiante immanente, c’est-à-dire ayant des limites dans l’espace et le temps : un texte, un rite, une pratique, une interaction. Greimas abandonne progressivement le concept de signe et passe à celui de signification car il considère que la problématique du signe est le plus grand obstacle à tout progrès théorique. Cf. « Entretien avec A.J. Greimas sur les structures élémentaires de la signification », in F. Nef (éd.), Structures élémentaires de la signification, Bruxelles, Complexe, 1976, p. 18. 4 A.J. Greimas, « L’actualité du saussurisme » (Le français moderne, 1956), rééd. posthume in A.J. Greimas, La mode en 1830, Paris, P.U.F., 2000. Voir p. 378. |
|
Mais comment définir sémiologiquement ou sémiotiquement une œuvre individuelle ? Comment y voir plus qu’une représentation d’un ensemble, d’un Modèle, d’une Structure, ou bien, en d’autres termes, un variant d’un invariant ? Est-ce possible si tout le souci du structuralisme consiste à décrire les structures générales et généralisables ? A vrai dire, Greimas ne l’a jamais fait lui-même. Chaque fois qu’il a entrepris d’analyser une œuvre concrète, par exemple une nouvelle de Maupassant, cela a été pour l’utiliser comme terrain d’essai de la méthode. A ses yeux, « la stratégie de la recherche sémiotique » consiste, « à chaque fois qu’on se trouve en présence d’un phénomène non analysé, à construire sa représentation de telle sorte que le modèle en soit plus général que le fait examiné ne l’exige, afin que le phénomène observé s’y inscrive comme une de ses variables »5. Greimas fait allusion à l’attitude de certains critiques littéraires qui insistent « sur l’unicité de chaque texte », chacun étant censé constituer « à lui seul, un univers en soi » — d’où « la nécessité de construire une grammaire pour chacun ». A cela il objecte que « le propre d’une grammaire est de pouvoir rendre compte de la production et de la lecture d’un grand nombre de textes »6. Ainsi élude-t-il au fond la question. |
5 A.J. Greimas, Maupassant. La sémiotique du texte : exercices pratiques, Paris, Seuil, 1976, p. 263. 6 Op. cit., p. 9. |
|
Rien n’empêche pour autant de revenir à cette question laissée en suspens par le maître de la sémiotique. Il est évident qu’une grammaire décrit le fonctionnement de plusieurs textes et qu’il ne peut pas y avoir une grammaire pour chacun. Mais qu’est-ce qui, dans cette grammaire, permet de saisir la singularité d’une œuvre, sa différence par rapport aux autres, ce par quoi elle s’en distingue et non pas ce par quoi elle leur ressemble ? Avant d’aborder ce problème, il nous sera utile d’examiner brièvement comment il a été envisagé par d’autres chercheurs se réclamant de l’approche structurale, ou par d’autres encore, qui sans la pratiquer, l’ont connue de près. |
|
|
1. Le rapport entre particulier et général 1.1. La place du singulier dans l’approche structurale Il y a à notre connaissance principalement deux théoriciens qui ont cherché une réponse à des questions de ce genre : Paul Ricœur, qui, dans ses considérations sur le récit, a cherché à marier deux approches, phénoménologique-herméneutique et structurale, et Roland Barthes. « Ce qui est en question aujourd’hui, écrit Ricœur, c’est le rapport même entre telle ou telle œuvre singulière et tout paradigme reçu »7. Chez lui, « paradigme » est « à peu près synonyme de règle de composition » et « son contraire est l’œuvre singulière, considérée dans sa capacité d’innovation et de déviance »8. Le terme paradigme n’a pas ici de rapport avec le paradigmatique structural ; il est employé au sens habituel (pré-structural) comme équivalent de « modèle » (du grec paradeigma, modèle, exemple typique). Il s’agit « des principes les plus formels de composition », « des principes génériques (le genre tragique, le genre comique, etc.) », « des types plus spécifiés (la tragédie grecque, l’épopée celtique, etc.) ». |
7 P. Ricœur, Temps et récit II, Paris, Seuil, 1984, p. 18. 8 Ibid. |
|
La connaissance de ce paradigme est acquise par l’expérience, la pratique de lecture, par la « fréquentation » de toutes sortes de récits. Ricœur la lie à l’intelligence narrative qui est de type inductif et la distingue de « la rationalité sémiotique » qui est plutôt déductive. Cette distinction est tacitement empruntée à Kant, qui distingue l’entendement appuyé sur l’expérience sensible et la raison pure qui n’opère qu’avec les catégories abstraites. Si nous acceptons cette distinction de Ricœur, de nouvelles questions se posent : comment fonctionne la « rationalité sémiotique » ? Est-ce que ses catégories sont du même genre que celles de l’« intelligence narrative » des « types, genres et formes »9 ? |
9 Op. cit., p. 19. |
|
Cependant Ricœur n’a pas été le premier à s’interroger sur l’œuvre singulière et son rapport au général, qu’il s’agisse de la langue, du système, du paradigme, du code ou de la structure. Bien avant lui, l’un des coryphées du structuralisme, Roland Barthes s’en est préoccupé aussi. Voici comment il présentait la situation dans S/Z : C’est ce qu’auraient bien voulu les premiers analystes du récit : voir tous les récits du monde (il y en a tant et tant eu) dans une seule structure : nous allons, pensaient-ils, extraire de chaque conte son modèle, puis de ces modèles nous ferons une grande structure narrative, que nous reverserons (pour vérification) sur n’importe quel récit : tâche épuisante (« Science avec patience, Le supplice est sûr ») et finalement indésirable, car le texte y perd sa différence.10 |
10 R. Barthes, S/Z, Paris, Seuil, 1970, p. 9. |
|
S’agissant du texte singulier ou « unique », Barthes, en tant que structuraliste, se garde bien de le substantialiser par son individualité ou « quelque qualité pleine ». Il le définit comme « une différence qui ne s’arrête pas et s’articule sur l’infini des textes, des langages, des systèmes : une différence dont chaque texte est le retour »11. Cette pluralité des langages et des systèmes englobée par le texte, il la décrit en terme de « code ». |
11 Ibid. En disant « le retour », Barthes fait allusion au concept connu de Nietzsche, « l’éternel retour du même ». |
|
Pourtant, toujours dans S/Z, tout en soulignant et la pluralité irréductible du sens et des codes, ainsi que leur caractère « indécidable », et « l’infini du langage » (p. 11), Barthes ne renonce pas à la systématicité : les sens trouvés du texte « sont avérés » « par leur marque systématique » (p. 16). Donc, dans son entreprise, il garde le terme structural de système, qu’il comprend comme code et dont il souligne la pluralité. En revanche, il s’empresse de bannir le terme de structure : (…) pour le texte pluriel, il ne peut y avoir de structure narrative, de grammaire ou de logique du récit ; si donc les unes et les autres se laissent parfois approcher, c’est dans la mesure (en donnant à cette expression sa pleine valeur quantitative) où l’on a affaire à des textes incomplètement pluriels (...).12 |
12 S/Z, op. cit., p. 12. |
|
Car Barthes, en tant que sémiologue, veut « produire une structuration » et non pas « manifester la structure » (S/Z, p. 24), il veut « étoiler le texte au lieu de le ramasser » (p. 17). Il veut ainsi souligner le processus de signification, le « miroitement du sens » (p. 23) et non pas une structure figée une fois pour toutes : « tout signifie sans cesse et plusieurs fois, mais sans délégation à un grand ensemble final, à une structure dernière » (p. 16). |
|
|
Le plus significatif dans ces considérations de Barthes qu’on a qualifiées plus tard de « post-structurales » et attribuées à « la pensée de la différence » en la distinguant de celle « du système » — représentée par les premiers structuralistes (Saussure, Hjelmslev, Lévi-Strauss, y compris Greimas)13 —, c’est la façon de définir le rapport du « texte unique » à la structure. En premier lieu, Barthes évoque une « structure légale de normes et d’écarts, une Loi narrative et poétique », « un Modèle » (p. 17). Une structure imposerait donc des lois, des règles ou des normes, et le texte ne pourrait qu’ou bien les suivre ou bien les transgresser (« l’écart »). D’autre part, le texte singulier serait considéré comme une représentation d’une structure en position de « Modèle ». Bien que le structuralisme ait banni l’idée de Représentation (ni la langue ni le texte ni le discours ne « représentent » quoi que ce soit : ni la réalité, ni la pensée ni les sentiments), on dirait que l’un de ses principaux défenseurs la fait revenir par derrière en établissant un rapport de représentation entre le texte concret et le système envisagé comme « une seule structure ». Drôle de renversement (ou d’« éternel retour du même ») dans l’histoire de la pensée en sciences humaines ! On peut ainsi voir que les deux interrogations, bien qu’elles soient différentes, se croisent sur certains points. Et dans la perspective plutôt traditionnelle de Ricœur, et dans celle de Barthes, la généralité — genre, type discursif ou structure narrative — est comprise comme un modèle, un exemple typique (un « paradigme »), une norme ou une loi par rapport à laquelle la singularité n’a que deux modes d’existence possibles : ou bien elle la représente comme sa variante, ou bien elle la transgresse et constitue une déviation ou un écart. Est-ce le seul moyen de voir le rapport entre le général et le singulier, et notamment entre la structure et une occurrence ? La structure est-elle nécessairement un modèle, bien plus, un modèle unique, érigé en modèle normatif ou canonique (« une structure dernière ») dans lequel le texte « perd sa différence » ? Mais en quoi alors la différence du texte, son pouvoir de différenciation consiste-t-il sémiotiquement parlant ? |
13 Cf. F. Worms, La philosophie en France au XXe siècle, Paris, Gallimard, 2009, pp. 469-470, 482. Voir la critique de cette idée par P. Maniglier dans « Les années 1960 aujourd’hui » in id. (éd.), Le Moment philosophique des années 1960 en France, Paris, P.U.F., 2011, p. 17. |
|
1.2. Le système, entre paradigmatique et syntagmatique Les approches structurales des systèmes secondaires de signification proposées par différents chercheurs — Propp, Lévi-Strauss, Brémond, Barthes, Todorov, Genette, Metz, Greimas — divergent selon qu’elles attribuent le plus d’importance soit aux rapports paradigmatiques soit aux relations syntagmatiques. Les uns suivent l’idée de Saussure et de l’école phonologique selon laquelle le système implique les rapports paradigmatiques, tandis que sa réalisation (par exemple la parole) engage les rapports syntagmatiques. Cette idée a été suivie en grande partie par Lévi-Strauss, Lacan, Brémond, Todorov, Genette. Certes, leurs modèles et les objets pour lesquels ils ont été élaborés sont bien différents. Il suffirait de comparer la narratologie de Genette, appelée « rhétorique du récit » (par opposition à la grammaire du récit de Greimas), à la démarche de Lévi-Strauss. La première consiste en grande partie en une taxinomie des figures spécifiques du discours narratif (types de narrateurs, figures de l’ordre, de la durée et de la fréquence temporelle, types de focalisation, discours du narrateur et du personnage, etc.)14, tandis que la seconde conduit à analyser le système mythologique comme s’il était l’équivalent du système phonétique : un système constitué d’unités appelées « mythèmes », qui forment des « paquets » (l’équivalent des faisceaux en phonologie), lesquels à leur tour s’organisent en séries de paradigmes (équivalents des ordres de phonèmes)15. Autrement dit, alors que dans la narratologie de Genette la discursivité est réduite à la taxinomie des figures qui circulent dans un acte communicatif ou dans la narration produite par un narrateur, chez Lévi-Strauss, la discursivité est éliminée et ramenée au contenu conceptuel (car le mythe, c’est la suite des concepts avant d’être celle des mots — « le mythe est simultanément dans le langage, et au-delà »16), et la syntaxe des mythes réduite à une sérialité où les rapports ne sont que des oppositions binaires (une fois de plus comme dans un système phonologique). |
14 G. Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972. 15 Lévi-Strauss le souligne : « les véritables unités constitutives du mythe ne sont pas les relations isolées mais des paquets de relations », in « La structure des mythes », Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 234. Cf. A. Martinet, Économie des changements phonétiques (1955), Berne, A. Francke, 1964, pp. 70, 72. 16 Op. cit., p. 230. Cela permet d’opposer le mythe à la poésie. « La substance du mythe ne se trouve ni dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la syntaxe, mais dans l’histoire qui y est racontée. Le mythe est langage ; mais un langage qui travaille à un niveau très élevé, et où le sens parvient, si l’on peut dire, à décoller du fondement linguistique sur lequel il a commencé par rouler ». Op. cit., p. 232. |
|
Certes, Lévi-Strauss veut « rendre compte des caractères spécifiques de la pensée mythique », il cherche « l’originalité qu’offre le mythe par rapport à tous les autres faits linguistiques »17. De même, Genette vise à décrire la spécificité du discours narratif par rapport aux autres types de discours. Cependant il s’agit de la spécificité des types langagiers ou discursifs et non pas de leurs réalisations singulières. Ni dans un système taxinomique des figures narratives, ni dans un système mythique considéré comme la répétitivité des séries et des paradigmes (ordres, classes ou groupes) — où les rapports ne sont que purement formels et (op)positionnels —, il n’y a de place pour une singularité, une nouveauté. Il n’y a d’ailleurs pas lieu de s’en étonner puisque l’objectif de Lévi-Strauss n’est pas de saisir ce qui différencie les mythes les uns des autres ou de saisir leurs spécificités respectives mais de comprendre pourquoi, « d’un bout à l’autre de la Terre, les mythes se ressemblent tellement »18 sans qu’on puisse expliquer cette ressemblance par l’influence culturelle. Il est évident que leur ressemblance ne tient pas à ce qu’ils raconteraient tous le même type d’histoire ou chanteraient tous la même chansonnette (la même mélodie). Ce sont les rapports paradigmatiques (l’équivalent de l’harmonie19) qui permettent d’expliquer leurs ressemblances, et non pas les chaînes syntagmatiques, contrairement à ce qu’on observe dans un genre du discours ethnologique tel que le conte merveilleux russe analysé par Propp. |
17 Op. cit., pp. 230, 232. 18 Op. cit., p. 229 19 Cf. op. cit., p. 234. |
|
Là où règne le principe de substitution dans la répétition — la substitution étant la base de tout paradigme —, il s’agit en fait d’une structure d’invariance, comme l’observe très justement Greimas20. Or on arrive à la même conclusion si on considère le système comme constitué de rapports syntaxiques figés en proto-formes selon la description des contes faite par Propp : chaque conte n’est qu’une variante du modèle invariant. Si aucune de ces approches structurales du récit ne peut rendre compte d’un récit dans sa singularité, a fortiori, comment la sémiotique narrative le pourrait-elle, elle dont le domaine de recherche est encore plus large, plus global — pour ainsi dire universel — étant donné qu’elle se donne pour objet non pas un type langagier ou discursif particulier (le discours narratif, le mythe, le conte) mais n’importe quel discours ? Dans ces conditions, quels sont donc, par rapport aux démarches précédentes, les avantages théoriques que peut présenter la sémiotique narrative de Greimas, cette approche syntaxique qui, au départ, s’inspire du modèle de Propp ? |
20 « La substitution permet de reconnaître les variables dans le cadre d’une structure d’invariances ». A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979, entrée « Substitution », p. 369. |
|
2. La particularité de l’approche sémiotique 2.1. La grammaire générative du discours En partant des travaux antérieurs de Lévi-Strauss concernant un exemple de système social (les structures de la parenté) ou un système mythologique (les structures des mythes), plusieurs tentatives ont été effectuées durant les années 1970 en vue de décrire certains « systèmes secondaires », et notamment un hypothétique système du récit21. Bien que la grammaire construite par Greimas ait par la suite été appelée « grammaire narrative », on sait que ce n’était pas une grammaire « du récit » mais qu’elle visait en fait à dégager les structures de n’importe quel discours signifiant. Si Greimas l’a lui-même qualifiée de « narrative », c’est parce qu’il a eu l’idée originale de lier les structures de la signification à la narrativité, c’est-à-dire à l’(inter)action. Par rapport aux autres structuralistes, l’envergure de son projet était la plus large et la plus ambitieuse car la plus universalisante. Mais justement, elle ne pouvait l’être qu’à condition de rester aussi formelle et abstraite que possible et, du même coup, de permettre de décrire une pluralité de structures, et non pas « une seule grande structure » (comme dit Barthes) qui serait un « Modèle » avec ses règles normatives ou ses « lois ». |
21 Projet collectif dont témoigne, dès 1966, le célèbre numéro 8 de la revue Communications consacré à « L’analyse structurale des récits ». |
|
Quand on parle de la grammaire narrative, on oublie souvent qu’elle est construite en suivant le modèle de la grammaire générative et non pas de la grammaire prescriptive traditionnelle, avec ses règles normatives. De la grammaire de Chomsky, Greimas reprend l’idée de générativité : à partir d’un ensemble fini d’éléments (les catégories, les règles), on peut engendrer un ensemble infini de phrases ou de discours. Cette possibilité d’un engendrement infini à partir d’un nombre fini d’éléments met en évidence la créativité du langage et donc la possibilité d’innovation. Si cette possibilité est ouverte d’emblée par la grammaire narrative, elle l’est d’autant plus largement que, dans sa construction, Greimas ne reprend pas les distinctions chomskyennes entre grammatical et agrammatical, interprétable et non-interprétable, distinctions qui, en présupposant l’opposition entre correct et incorrect, impliquent une certaine normativité — ce qui fixe par construction des limites à la créativité. Car on sait bien que dans la création artistique l’agrammatical peut aussi avoir du sens et donc être interprétable. Ce n’est donc pas un hasard si cette idée d’agrammaticalité et de non-interprétabilité a par la suite été critiquée22 ; et ce ne l’est pas non plus si de l’idée même d’agrammaticalité sont issus des développements fructueux dans l’analyse des textes poétiques23. |
22 Cf. J. Derrida, La voix et le phénomène, Paris, PUF, 1967, pp. 109-111. 23 Voir l’analyse de l’agrammaticalité comme l’élément productif de la signification dans la théorie intertextuelle de Michael Riffaterre, La production du texte, Paris, Seuil, 1979. |
|
Donc tout en étant de la plus grande généralité, la grammaire narrative permet en principe de mettre en lumière la créativité ou de faire apparaître la spécificité d’un discours. De fait, la combinatoire discursive étant infinie, les principes génératifs permettent de comprendre comment les discours sont générés sans qu’il soit pour cela nécessaire de les encadrer par des normes. Par ailleurs, la capacité de la grammaire narrative à rendre compte de la complexité discursive dépasse celle des autres approches structurales du fait qu’elle décrit le système secondaire autant en termes paradigmatiques qu’en termes syntagmatiques24. Du fait que ce qui le préoccupe est le système de la signification et non pas des signes, sa conception est bien différente : pour lui, c’est en fin de compte du système discursif qu’il s’agit. Au lieu d’être paradigmatique et topologique, sa conception est syntactique-paradigmatique ; au lieu de se limiter au rapport binaire (différence = opposition) comme le font Saussure, Jakobson ou en partie Barthes et Lévi-Strauss, Greimas prévoit un large éventail de toutes sortes de rapports différentiels qui dépassent le binarisme des systèmes de signes. La syntaxe du discours n’est pas une série linéaire, fût-ce une série des paradigmes. Cela a probablement été une pomme de discorde entre lui et Lévi-Strauss à un moment où — tout au début — il était son assistant. Lévi-Strauss voit une analogie entre la diachronie d’un système et celle du discours. Or il s’agit en réalité de diachronies de nature tout à fait différente25. Celle du système — par exemple, au fil du temps, les changements d’une langue ou d’un mythe dans ses versions historiques successives — est linéaire et irréversible. Celle du discours, par contre, n’est ni linéaire ni sérielle, en tout cas elle ne se réduit pas à ces aspects. Ou plutôt, comme Greimas cherche à le montrer, sa linéarité temporelle n’est qu’un effet de surface. En réalité, cette diachronie est logique ou algorithmique. Il s’agit d’un « ordre de présupposition logique à rebours » où chaque unité présuppose celle qui la précède26. C’est pour cette raison que la lecture structurale du discours s’effectue à l’inverse de la lecture ordinaire : non pas du début à la fin mais, comme on sait, de la fin au début, à rebours. |
24 Voir « Eléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique » (Communications, 8, 1966, pp. 37-38), où Greimas, reprenant l’analyse d’un mythe faite par Lévi-Strauss, propose de concevoir le système mythique (à l’époque encore qualifié de « code ») en termes non seulement paradigmatiques mais aussi syntagmatiques. 25 Je soutiens l’observation critique de Georges Mounin : Lévi-Strauss confond la distinction entre synchronie et diachronie avec celle entre paradigme et syntagme. La diachronie du système n’est pas la même chose que les rapports syntagmatiques. Cf. G. Mounin, « Lévi-Strauss et la linguistique », Introduction à la sémiologie, Paris, Minuit, 1969, pp. 199-214. 26 Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., p. 245. |
|
2.2. Au-delà de la canonicité, la syntaxe narrative Pour saisir à quoi tient la capacité propre à la grammaire narrative de mettre en valeur la créativité innovatrice d’un discours donné, il est important de comprendre la différence capitale qui sépare le modèle greimassien de la syntaxe narrative du modèle de Propp, bien que Greimas s’en soit inspiré. Le modèle de Propp est linéaire et implique une succession temporelle des unités. C’est à cause de cela qu’il constitue une forme figée, une proto-forme, un type d’intrigue qui ne convient que pour un genre de discours (le conte populaire) ou, dans le meilleur des cas, pour les discours où l’histoire se déroule comme une suite d’épreuves (le roman d’aventure, le roman ou le film policier, le film d’action, le thriller, etc.). La syntaxe narrative de Greimas, par contre, ne se réduit pas à l’établissement d’une seule et unique configuration syntaxique, d’un seul modèle narratif qui se ramènerait à une morphologie figée. Il s’agit en effet d’une approche structurale et non pas formelle au sens du formalisme russe, prédécesseur du structuralisme français. Les suggestions de Lévi-Strauss concernant la différence entre ces approches, ou la distinction entre la forme (la morphologie) et la structure, sont très éclairantes, bien qu’il ne soit pas certain qu’elles aient été vraiment prises en compte dans la pratique sémiotique27. Ce qui est en tout cas certain, c’est que la sémiotique de Greimas ne cherche pas à révéler une (proto)forme ou un sub-genre, autrement dit, un invariant dont les variantes seraient les discours concrets. |
27 Cl. Lévi-Strauss, « La structure et la forme » (1960), Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 1973, surtout pp. 144, 158, 165, 168-172. |
|
Ce n’est que par un emploi erroné que l’un des modèles de la sémiotique narrative, le « schéma narratif », est trop souvent compris comme une proto-forme, c’est-à-dire comme un modèle équivalent à celui de Propp. Pour beaucoup de « greimassiens », il est malheureusement devenu l’équivalent d’une forme figée élevée au rang « canonique ». Or le schéma narratif n’est pas un invariant constitué d’un ordre de succession (temporel) constant, d’un type de mise en intrigue fixé ad aeternam. Ce schéma est d’ailleurs tout autant paradigmatique que syntagmatique étant donné que les stades qu’il distingue, de même que les actants qu’il convoque, s’interdéfinissent et fonctionnent en fait comme les unités paradigmatiques. Et pour cette raison, il s’applique aussi bien aux discours particuliers qu’à des ensembles discursifs plus vastes (ou « corpus signifiants », en particulier mythiques ou publicitaires) et même à toutes sortes d’actions ou d’interactions cognitives et/ou pragmatiques. Constitué de séquences d’action liées entre elles par les présuppositions logiques, ledit schéma narratif ne se réduit donc pas à une suite d’étapes dont la succession figée se répèterait invariablement dans les discours qu’on analyse. Certes, on peut dire que Greimas lui-même n’a pas suffisamment souligné ce qui fait la différence entre sa syntaxe et celle de Propp. Certaines de ses observations laissent croire qu’il utilise le schéma proppien après l’avoir tout au plus un peu réarrangé et généralisé28. Bien plus, « la sémiotique narrative parvient à établir, dit-il, la canonicité de ses structures »29. Pourtant, d’un autre côté, ses avertissements sont très clairs. Il dénonce sans ambiguïté « l’impasse » consistant en « une certaine exploitation mécanique du schéma proppien », comme il arrive lorsqu’« après sa simple projection sur des textes littéraires », on y reconnaît « une suite attendue de “fonctions” ». Tout cela apparaît alors « comme autant de techniques répétitives, sans projet scientifiques : elles ne servent ni à augmenter notre connaissance des organisations narratives ni à rendre compte de la spécificité des textes étudiés »30. |
28 Maupassant, op. cit., p. 8. 29 Op. cit., p. 266. 30 Op. cit., p. 8. |
|
2.3. La sémantique : cohérence sans systématicité Le schéma narratif est plus qu’un simple algorithme formel au sens mathématique, et cela fait encore une différence par rapport au modèle sériel phonologique utilisé par Lévi-Strauss. Greimas ne le souligne peut-être pas suffisamment, mais ce schéma est en fait aussi sémantique. Car la logique des présuppositions entre actions implique non pas une raison mathématique mais ce que Ricœur appelle l’intelligence narrative, c’est-à-dire une connaissance du déroulement des actions humaines qui vient de l’expérience de notre vie dans le monde social. La sanction présuppose la performance et celle-ci la compétence et celle-ci la manipulation non pas du point de vue de la logique formelle mais du point de vue de la « logique » des (inter)actions humaines, de l’activité humaine dans le monde social et dont la base est un « ensemble de comportements ayant un but »31. C’est pour cette raison que Greimas peut l’extrapoler sur l’échelle plus grande de la vie humaine entière32. |
31 « Éléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique », art. cit., p. 35. 32 Cf. Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., p. 245. |
|
De ce point de vue aussi, la grammaire narrative se démarque par rapport à la grammaire générative. Tout en conservant les deux composantes principales de la grammaire générative, la syntaxe et la sémantique, la sémiotique se garde de les séparer, de postuler l’autonomie de la syntaxe en la plaçant au niveau profond et en ne laissant la sémantique que pour le niveau de surface, comme le fait Chomsky. En sémiotique, le niveau profond étant tout autant sémantique que syntaxique (logique), il y a place pour une logique sémantique profonde. Et comme on vient de le dire, même le niveau le plus formel, celui de la syntaxe narrative, est lui aussi implicitement sémantisé. Certes, la plus grande complexité sémantique se déploie sur le plan figuratif. Mais l’intégration de la sémantique à tous les niveaux s’explique par le fait que la sémiotique de Greimas, comme le structuralisme français dans son ensemble, dépasse la linguistique de la phrase pour s’occuper de la linguistique (et de la sémantique) du discours. Or le discours, loin de se réduire à une somme ou à une série de phrases, a ses propres principes de construction. L’apport capital de la sémiotique greimassienne n’est pas seulement la combinaison des rapports syntaxiques et paradigmatiques qui permet de décrire la plus grande variété de types de discours, d’actions et d’interactions au lieu de se limiter à l’application d’un modèle ou d’une structure figée, c’est-à-dire à une reconnaissance d’une invariance dans les variations. Son apport capital, c’est aussi l’intégration de la sémantique, alors que précédemment, dans les autres approches des « systèmes sémiologiques secondaires », elle avait été sinon éliminée du moins réduite au minimum (à des oppositions binaires). |
|
|
On sait que des deux dimensions linguistiques, la grammaire et le lexique (la sémantique), le second se laisse systématiser le plus difficilement. Au début de la formation de la sémiotique, Greimas prévoyait la possibilité d’une systématisation de la composante sémantique, au moins pour certains types de discours, notamment le discours des mythes33. Il parlait alors de la construction éventuelle d’un code ou d’un dictionnaire mythique. Mais il soulignait en même temps toutes les difficultés d’une telle entreprise, notamment en raison de la différence entre lexème et sémème, entre la dénomination et le contenu, ou encore du fait des transformations qui peuvent avoir lieu à partir d’une figure lexicale donnée. |
33 Cf. « Éléments pour une théorie... », art. cit., pp. 40-42. |
|
Tout cela a amené Greimas à construire plus tard une sémantique dite morphologique, différente de celle, dite taxinomique, de Bernard Pottier suivi par François Rastier34. Très sommairement, alors que la sémantique taxinomique construit a priori un ensemble de classes sémantiques35, la sémantique morphologique construit des classes chaque fois différentes sur la base des discours soumis à l’analyse. Cela veut dire que la sémantique de Greimas est inséparable des rapports syntaxiques-paradigmatiques du discours ou d’une occurrence signifiante déterminée (qu’il s’agisse d’une interaction, d’une pratique, ou encore, par exemple, d’une configuration architecturale, etc.). Si ce type d’analyse sémantique permet de faire apparaître la cohérence du texte, il est vrai qu’il ne peut pas déboucher sur des résultats exhaustivement systématisables. Greimas prévoyait la possibilité de construire le vocabulaire d’un auteur ou d’un genre discursif pour systématiser la sémantique des figures récurrentes, mais ce travail a rarement été fait. Il n’est effectivement envisageable que pour les auteurs qui construisent toujours le même genre de discours (par exemple des romans policiers, des feuilletons ou les séries télévisés). Les autres, qui se veulent plus « créateurs », cherchent au contraire à inventer des univers figuratifs et narratifs différents et inattendus pas rapport aux usages dominants, au canon ou aux normes esthético-poétiques, ou par rapport à eux-mêmes, à leurs œuvres précédentes. |
34 Sur ce qui les différencie, cf. Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., pp. 334-335. 35 Cf. Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., p. 337, sur la taxinomie des « sièges » conçue par B. Pottier. |
|
3. Le niveau discursif comme champ de l’inventivité Pendant longtemps, les sémioticiens proches de Greimas ont considéré la syntaxe narrative comme « la source originante de tout procès sémiotique »36 et par suite estimé que le niveau figuratif (la sémantique discursive) ne fait que concrétiser les relations plus abstraites de la syntaxe narrative en les investissant de contenus sémantiques sensibles. Cette perspective générativiste a ensuite été dépassée grâce à des analyses qui ont montré que le niveau discursif-figuratif peut en réalité prendre en charge le procès sémiotique dans son entier. |
36 Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., p. 383. |
|
Une telle revalorisation théorique du plan figuratif est essentielle pour l’approche du texte en tant qu’œuvre particulière. Le Maupassant le montre parfaitement. La lecture de ce « conte savant » comme parabole chrétienne n’est possible que grâce à l’analyse attentive du niveau figuratif. La même chose nous est apparue en analysant un roman de Nabokov où l’essentiel repose sur les rapports entre deux plans relevant du niveau discursif-figuratif, celui de l’énonciation et celui de l’énoncé. De même dans le cas d’un film d’action où nous avons montré que l’affrontement entre deux idéologies opposées (une idéologie catholique de gauche face à celle du capitalisme, née de l’esprit protestant), qui sous-tend tout le film, ne se laisse comprendre que moyennant l’analyse détaillée des espaces avec leur qualités plastiques et les mouvements corporels du héros principal qui incarne ainsi le Sauveur d’un monde corrompu37. On peut l’illustrer par un autre exemple hollywoodien classique, un film de Billy Wilder, Ariane (Love in the Afternoon, 1957), que nous allons maintenant évoquer succinctement avant de conclure. L’analyse de cet exemple montrera à la fois l’importance essentielle du niveau discursif et la nécessité de tenir ensemble la composante formelle-structurelle et la composante sémantique. |
37 N. Kersyté, « Par où le scandale arrive : Nabokov et ses méprises littéraires”, Actes Sémiotiques, 116, 2013 ; « La sémiotique en action », in A.Cl. de Oliveira (éd.), As interações sensíveis, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2013. |
|
Si, en suivant une suggestion de Ricœur, nous considérions que la singularité d’un récit dépend de son degré de déviance par rapport à un paradigme, en l’occurrence par rapport à un « genre » cinématographique convenu — type discursif que notre « intelligence narrative » reconnaît grâce à notre fréquentation du cinéma —, alors nous ne verrions dans Ariane qu’une assez banale « comédie romantique ». Quasiment toutes les règles, tous les schémas de construction du genre y sont respectés et les stéréotypes culturels qui vont de pair sont exposés dès le début (prologue sur Paris, « ville de l’amour ») puis parsemés tout au long (la différence entre les Françaises et les Américains, etc.). Par contre, si on regarde ce film avec les yeux du sémioticien et sa « raison narrative », alors on en découvre la singularité. Et on va voir qu’elle ne se réduit pas à une déviance par rapport à une norme canonique. La spécificité de la structure discursive de ce film repose sur des rapports de substitution dans le cadre d’une structure du désir. Dans d’autres films aussi (The lost weekend, The Apartment), Wilder utilise des chaînes de substitutions entre sujets ou entre objets. Mais dans Ariane, il s’agit de paradigmes qui forment des séries, comme dans le système mythologique décrit par Lévi-Strauss. Et à travers ces séries de substitutions — et leurs inversions —, on découvre au fur et à mesure que les figures substituées sont investies de contenus mythiques. Ce récit apparaît dès lors comme une superposition inattendue, innovante et tout à fait originale, de plusieurs mythes classiques grecs et de divers contes de provenance ethnographique, sans pour autant en constituer des « variantes ». Tout d’abord, on observe trois séries impliquant les mêmes rôles thématiques (les mêmes catégories paradigmatiques) : le prétendant, son concurrent (le rival) et l’objet du désir. Dans chaque série, les mêmes personnages accomplissent des rôles différents. Dans la première, le rival est un riche Américain (Flannagan) qui « vole » l’objet de désir, l’épouse du prétendant, un Anglais. Quand l’époux apprend, par un détective privé (le père d’Ariane), qui est le « voleur », il est prêt à le tuer. Le meurtre est empêché par Ariane, qui sauve le Don Juan américain en se substituant à sa maîtresse. Dans la deuxième série, les rôles restent les mêmes mais sont joués par des personnages substitués : Flannagan devient le prétendant d’un nouvel objet du désir, à savoir, cette fois-ci, Ariane, qui lui fait régulièrement des visites in the afternoon sans lui révéler son identité et en jouant le rôle d’une femme qui fréquente d’autres hommes et qui vit avec l’un d’entre eux, dont l’identité reste cachée. En réalité, tout en étant une fille innocente, jusqu’à présent jamais amoureuse de personne, Ariane raconte à Flannagan des aventures amoureuses et des histoires d’adultères comme si elles étaient ses propres histoires, alors qu’elle les trouve dans les archives de son père, le détective. Et ce dernier, elle le présente comme « l’homme avec lequel elle vit », ce qui amène Flannagan à prendre son père pour son rival. Ainsi, tout en éveillant le désir, elle crée un mystère que Flannagan veut résoudre. Pour percer l’identité de son objet de désir, et celle de son rival, Flannagan, après avoir rencontré l’Anglais de la première série et reçu son conseil, va voir un détective privé, le père d’Ariane, pour lui commander une enquête. Le détective fait pour cette fois l’enquête sur lui-même sans le savoir et découvre vite que le vrai objet de désir de Flannagan, c’est sa fille Ariane, et que son prétendu « concurrent », c’est lui-même. Et voilà ainsi la troisième série de substitutions, où il apparaît qu’en réalité Ariane était le concurrent de Flannagan puisque, par ses récits (donc dans l’imaginaire pur), elle essayait de l’égaler dans la course à l’objet de désir ou dans le désir tout court. C’est la quête de la vérité — qui est le coupable (ou le concurrent) ? — qui rend possible les passages d’une série à l’autre. La deuxième version, qui transforme l’enquêteur (le détective) en objet d’enquête (et plus précisément d’auto-investigation), ne peut pas manquer d’éveiller notre « intelligence narrative » (issue de la « fréquentation des récits ») et de nous amener à y reconnaître l’histoire d’Œdipe, mais inversée. Car l’Œdipe de Wilder découvre non pas sa culpabilité fatale comme dans le mythe grec mais l’innocence trompeuse de celle qui, au lieu d’être l’objet du désir, le produit à l’aide de ses récits volés. L’amour familial, « œdipien » (un quasi-inceste), entre le père et la fille est remplacé par l’amour conjugal où un homme âgé et étranger (l’Américain) se substitue à un autre homme âgé (le Français) dans le rapport à une jeune fille innocente. Ainsi, à partir du mythe d’Œdipe, l’histoire peut être lue comme le passage d’une jeune fille du stade de l’enfance (l’amour enfantin) au stade d’adulte à travers la symbolisation, au sens lacanien (les récits étant vus comme la mise en langage du désir). On voit que la fin de l’histoire est en fait l’inversion « des structures et des contenus » du début, conformément à une formule de Greimas. Mais cette structure de l’investigation autoréflexive comme investigation œdipienne en fait découvrir d’autres, comparables car relevant du même paradigme. Le rapport cognitif à soi se répète dans le rapport sensible à l’autre, en particulier entre Flannagan et Ariane. Ainsi reconnaît-on dans leur histoire un autre mythe (à ceci près qu’il est inversé), sinon deux : celui de l’amour impossible entre Narcisse et Echo et celui entre Ariane et Thésée. Flannagan tombe amoureux d’une femme-enfant ou plutôt d’une femme-garçon qui n’est pas du tout à son goût mais au lieu de la fuir (comme il le faisait avec toutes ses autres amoureuses) il l’emmène avec lui. Qu’est-ce donc que ce désir pour une autre qui lui ressemble, ou en tout cas qui essaie de lui ressembler en l’imitant ? C’est le désir narcissique, le désir de l’autre comme figure de soi. Mais si Flannagan est Narcisse, qui est Ariane ? Eh bien, son fil nous mène facilement à la sortie du Labyrinthe : c’est Echo ! Ariane, comme Echo, tombe amoureuse de Narcisse et ne fait rien d’autre que répéter les discours des autres : les récits tirés des archives paternelles ou les phrases volantes de son séducteur. L’amour impossible du mythe de Narcisse et Echo devient l’amour retrouvé entre deux êtres de l’imaginaire (de l’air : l’un voyage en avion et écoute la musique, l’autre joue de la musique). Voilà deux autres structures autoréflexives, l’une sur le plan visuel (Narcisse), l’autre sur le plan auditif (Echo), qui répètent celle du détective (Œdipe) et qui, de plus, se répètent ou se réfléchissent l’une (dans) l’autre. Que ces deux personnages soient une réplique et en même temps une inversion l’un de l’autre, bien d’autres figures le prouvent (faute de place nous n’en indiquons que deux : un soulier perdu d’Ariane et une pantoufle de Flannagan retrouvée) et permettent d’y voir encore un autre récit ancien, en ses deux versions, indo-européenne et américaine, celui de Cendrillon et de Ash boy38. |
38 Des observations de Lévi-Strauss sur ces deux contes « symétriques et inverses dans les moindres détails », ne retenons ici que ce qui convient pour le film de Wilder : « Les deux personnages sont des figures phalliques (médiateurs entre les sexes) (…) et des médiateurs sociologiques (alliance matrimoniale entre (…) riches et pauvres) ». Anthropologie structurale, op. cit., p. 250. |
|
Trois séries, trois paradigmes récurrents, trois récits mythiques et deux contes superposés dans un seul récit individuel et inventif de Wilder. Comme son personnage Ariane, Wilder s’approprie les récits étrangers mais les retranscrit d’une manière irreconnaissable ou plutôt dont les contenus sémantiques ne se reconnaissent qu’à partir des relations et interactions entre les acteurs, et non pas à partir de figures intertextuelles (mythologiques) qui renverraient directement à la taxinomie culturelle (le film ne donne pratiquement aucune référence aux mythes évoqués). Wilder agit comme un vrai structuraliste, il travaille avec les relations et les structures, non pas avec des figures substantialisées reconnaissables. Pour découvrir son inventivité, il faut bien une sémiotique inventive. |
|
|
L’analyse structurale n’est pas la reconnaissance, par construction toujours prévisible, de modèles a priori. C’est le recours à des éléments structuraux en vue de cerner les significations particulières du texte, leur « différence » — différence que la structure, quand elle est liée à la sémantique, aide à saisir au lieu de la cacher, contrairement à l’idée de Barthes. Par contre, l’intuition de Barthes était certainement juste quand il cherchait le texte singulier, sa « différence » à partir de la sémantique discursive. Les « codes » qu’il met en place (dans S/Z surtout) représentent au fond une première tentative de systématiser la sémantique du niveau figuratif39. Certes, avec ses cinq codes, il la réduisait à une Topique de la culture en général et la séparait de la syntaxe discursive. Comme si toute l’originalité de l’œuvre consistait à jouer avec des lieux communs, des schèmes d’action ou de comportement préétablis, des citations intertextuelles sans source, etc. Il aboutissait ainsi à l’analyse atomisante d’un texte « étoilé » avec sa pluralité des « codes indécidables », son « miroitement du sens ». Mais si on s’abstient d’opposer la sémantique du texte et sa structure, si au contraire on les intègre comme des présupposés réciproques, et si on refuse de réduire la structure à un modèle figé (tel le schéma narratif « canonique »), alors la sémiotique narrative peut très bien aider à analyser les textes dans leur singularité. A condition de ne pas borner l’analyse elle-même à la répétition des mêmes schémas ou modèles, à condition qu’elle soit elle-même inventive dans son interaction interprétative avec l’objet analysé. Voilà donc la tâche du sémioticien : passer de la structure-modèle, qui n’existerait que pour être re-connue, au travail de la structuration comme révélation de l’in-connu. |
39 Barthes lui-même dit que « l’analyse proposée porte uniquement sur le signifié » et que ses unités de lecture (les lexies) sont « l’enveloppement d’un volume sémantique ». S/Z, op. cit., p. 19. |
Références Barthes, Roland, S/Z, Paris, Seuil, 1970. Derrida, Jacques, La voix et le phénomène, Paris, PUF, 1967. Descombes, Vincent, Le même et l’autre, Paris, Minuit, 1979. Genette, Gérard, Figures III, Paris, Seuil, 1972. Greimas, Algirdas J., « L’actualité du saussurisme » (1956), rééd. in id., La mode en 1830, Paris, P.U.F., 2000. — « Eléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique », Communications, 8, 1966. — Maupassant. La sémiotique du texte : exercices pratiques, Paris, Seuil, 1976. — « Entretien avec A.J. Greimas sur les structures élémentaires de la signification », in F. Nef (éd.), Structures élémentaires de la signification, Bruxelles, Complexe, 1976. — et Joseph Courtés, « Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. Hjelmslev, Louis, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, 1968. Lévi-Strauss, Claude, « La structure des mythes », Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958. — « La structure et la forme » (1960), Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 1973. Maniglier, Patrice, « Les années 1960 aujourd’hui » in id. (éd.), Le Moment philosophique des années 1960 en France, Paris, P.U.F., 2011. Martinet, André, Économie des changements phonétiques (1955), Berne, A. Francke, 1964. Mounin, Georges, « Lévi-Strauss et la linguistique », Introduction à la sémiologie, Paris, Minuit, 1969. Ricœur, Paul, Temps et récit II, Paris, Seuil, 1984. Riffaterre, Michael, La production du texte, Paris, Seuil, 1979. Worms, Frederic, La philosophie en France au XXe siècle, Paris, Gallimard, 2009. |
|
1 L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, 1968, p. 16. 2 V. Descombes, Le même et l’autre, Paris, Minuit, 1979, p. 106. 3 Au début, dans le prolongement de l’idée de la sémiologie de Saussure, on les appelait « systèmes secondaires de signes ». Dans la sémiotique de Greimas, le système secondaire à décrire, c’est le système des discours d’une substance quelconque et, plus tard, de n’importe quelle entité signifiante immanente, c’est-à-dire ayant des limites dans l’espace et le temps : un texte, un rite, une pratique, une interaction. Greimas abandonne progressivement le concept de signe et passe à celui de signification car il considère que la problématique du signe est le plus grand obstacle à tout progrès théorique. Cf. « Entretien avec A.J. Greimas sur les structures élémentaires de la signification », in F. Nef (éd.), Structures élémentaires de la signification, Bruxelles, Complexe, 1976, p. 18. 4 A.J. Greimas, « L’actualité du saussurisme » (Le français moderne, 1956), rééd. posthume in A.J. Greimas, La mode en 1830, Paris, P.U.F., 2000. Voir p. 378. 5 A.J. Greimas, Maupassant. La sémiotique du texte : exercices pratiques, Paris, Seuil, 1976, p. 263. 6 Op. cit., p. 9. 7 P. Ricœur, Temps et récit II, Paris, Seuil, 1984, p. 18. 8 Ibid. 9 Op. cit., p. 19. 10 R. Barthes, S/Z, Paris, Seuil, 1970, p. 9. 11 Ibid. En disant « le retour », Barthes fait allusion au concept connu de Nietzsche, « l’éternel retour du même ». 12 S/Z, op. cit., p. 12. 13 Cf. F. Worms, La philosophie en France au XXe siècle, Paris, Gallimard, 2009, pp. 469-470, 482. Voir la critique de cette idée par P. Maniglier dans « Les années 1960 aujourd’hui » in id. (éd.), Le Moment philosophique des années 1960 en France, Paris, P.U.F., 2011, p. 17. 14 G. Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972. 15 Lévi-Strauss le souligne : « les véritables unités constitutives du mythe ne sont pas les relations isolées mais des paquets de relations », in « La structure des mythes », Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 234. Cf. A. Martinet, Économie des changements phonétiques (1955), Berne, A. Francke, 1964, pp. 70, 72. 16 Op. cit., p. 230. Cela permet d’opposer le mythe à la poésie. « La substance du mythe ne se trouve ni dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la syntaxe, mais dans l’histoire qui y est racontée. Le mythe est langage ; mais un langage qui travaille à un niveau très élevé, et où le sens parvient, si l’on peut dire, à décoller du fondement linguistique sur lequel il a commencé par rouler ». Op. cit., p. 232. 17 Op. cit., pp. 230, 232. 18 Op. cit., p. 229. 19 Cf. op. cit., p. 234. 20 « La substitution permet de reconnaître les variables dans le cadre d’une structure d’invariances ». A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979, entrée « Substitution », p. 369. 21 Projet collectif dont témoigne, dès 1966, le célèbre numéro 8 de la revue Communications consacré à « L’analyse structurale des récits ». 22 Cf. J. Derrida, La voix et le phénomène, Paris, PUF, 1967, pp. 109-111. 23 Voir l’analyse de l’agrammaticalité comme l’élément productif de la signification dans la théorie intertextuelle de Michael Riffaterre, La production du texte, Paris, Seuil, 1979. 24 Voir « Eléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique » (Communications, 8, 1966, pp. 37-38), où Greimas, reprenant l’analyse d’un mythe faite par Lévi-Strauss, propose de concevoir le système mythique (à l’époque encore qualifié de « code ») en termes non seulement paradigmatiques mais aussi syntagmatiques. 25 Je soutiens l’observation critique de Georges Mounin : Lévi-Strauss confond la distinction entre synchronie et diachronie avec celle entre paradigme et syntagme. La diachronie du système n’est pas la même chose que les rapports syntagmatiques. Cf. G. Mounin, « Lévi-Strauss et la linguistique », Introduction à la sémiologie, Paris, Minuit, 1969, pp. 199-214. 26 Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., p. 245. 27 Cl. Lévi-Strauss, « La structure et la forme » (1960), Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 1973, surtout pp. 144, 158, 165, 168-172. 28 Maupassant, op. cit., p. 8. 29 Op. cit., p. 266. 30 Op. cit., p. 8. 31 « Éléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique », art. cit., p. 35. 32 Cf. Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., p. 245. 33 Cf. « Éléments pour une théorie... », art. cit., pp. 40-42. 34 Sur ce qui les différencie, cf. Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., pp. 334-335. 35 Cf. Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., p. 337, sur la taxinomie des « sièges » conçue par B. Pottier. 36 Sémiotique. Dictionnaire, op. cit., p. 383. 37 N. Kersyté, « Par où le scandale arrive : Nabokov et ses méprises littéraires”, Actes Sémiotiques, 116, 2013 ; « La sémiotique en action », in A.Cl. de Oliveira (éd.), As interações sensíveis, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2013. 38 Des observations de Lévi-Strauss sur ces deux contes « symétriques et inverses dans les moindres détails », ne retenons ici que ce qui convient pour le film de Wilder : « Les deux personnages sont des figures phalliques (médiateurs entre les sexes) (…) et des médiateurs sociologiques (alliance matrimoniale entre (…) riches et pauvres) ». Anthropologie structurale, op. cit., p. 250. 39 Barthes lui-même dit que « l’analyse proposée porte uniquement sur le signifié » et que ses unités de lecture (les lexies) sont « l’enveloppement d’un volume sémantique ». S/Z, op. cit., p. 19. |
|
______________ Résumé : Quel est, selon l’approche structurale, le rapport entre une œuvre singulière et le système général dont elle relève ? Si on conçoit cette approche comme ayant pour objectif de mettre en évidence et de décrire le système de tous les phénomènes réels, mais aussi possibles, et donc prédictibles, alors tout phénomène particulier (un texte, un discours, une œuvre, un événement) apparaît comme une simple réalisation d’un schéma, d’un modèle ou d’une structure connue d’avance et a priori. En ce cas, toute « créativité » serait exclue. Mais parmi les divers modèles structuraux, la sémiotique de Greimas fait exception. Elle se distingue par un ensemble de choix épistémologiques et méthodologiques (grammaire générative du discours, description du système en termes syntaxiques et paradigmatiques, sémantique discursive non taxinomique) qui la rendent tout à fait apte à saisir la singularité d’une œuvre, du moins dès le moment où on la pratique de manière inventive et non pas dogmatique. Les analyses concrètes menées dans ce cadre montrent que la nouveauté ou l’inventivité d’un discours se laisse le mieux saisir sur le plan de la sémantique discursive, considérée dans ses rapports avec la structure narrative. Resumo : Como se define a relaçaõ entre uma obra singular e o sistema geral na perspectiva estrutural ? Se esta perspectiva tem como objetivo fazer aparecer e descrever o sistema de todos os fenômenos reais ou possíveis e, portanto, previsíveis, entaõ todo e qualquer fenômeno (um texto, um discurso, um filme, um evento) aparece como uma simples realizaçaõ de um esquema, um modelo ou uma estrutura conhecida adiantadamente e a priori. Em tais condições, naõ pode haver “criaçaõ”. Mas, entre as várias abordagens estruturais, a semiótica de Greimas faz exceçaõ. Ela se distingue por um conjunto de escolhas epistemológicas e metodológicas (gramática gerativa do discurso, descriçaõ do sistema em termos sintáticos e paradigmáticos, semântica discursiva naõ taxonómica) que a tornam perfeitamente capaz de capturar a singularidade de uma obra — isso, com a condiçaõ de praticá-la de modo inventivo e naõ dogmático. As análises concretas feitas neste quadro mostram que a novedade, a inventividade, de um discurso revela-se melhor no nível da semântica discursiva, considerada em relaçaõ com a estructura narrativa. Abstract : According to the structuralist approach, what are the relations between a given singular work and the general system it stems from ? If this approach described the system of all real or possible (and thereby predictable) phenomena, any particular occurrence (a text, a discourse, a film, an event) would appear as the simple realisation of a schema, a model or a structure known in advance and no “creation” would then be conceivable. But among structuralist undertakings, Greimas’s semiotics is an exception. It stands out in reason of a series of epistemological and methodological options (generative grammar of discourse, description of the system in sintactic and paradigmatic terms, discoursive and not taxinomic semantics) which make it perfectly capable of grasping and accounting for the singularity of a work — as long as it is used in an inventive and non dogmatic way. Concrete analyses have shown that the novelty and the inventiveness of a discourse are best grasped at the level of discoursive semantics considered in relation with the narrative structure. Mots clefs : approche structurale, inventivité, singularité, système. Auteurs cités : Roland Barthes, Gérard Genette, Algirdas J. Greimas, Claude Lévi-Strauss, Paul Ricœur. Plan : Introduction : prévisibilité et nouveauté dans la perspective structurale 1. Le rapport entre particulier et général dans les systèmes secondaires 1. La place du singulier dans l’approche structurale 2. Le système, entre paradigmatique et syntagmatique 2. La particularité de l’approche sémiotique 1. La grammaire générative du discours 2. Au-delà de la canonicité, la syntaxe narrative 3. La sémantique : cohérence sans systématicité |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |
|
Recebido em 26/10/2022. / Aceito em 12/11/2022. |