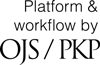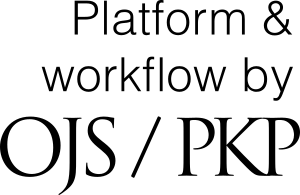Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
In vivo
|
Au nom de la guerre, « la nôtre » Nijolé Kersyté
Publié en ligne le 26 décembre 2022
|
|
|
La société en tant que territoire de la guerre La guerre traditionnelle est un conflit physique, une lutte armée entre des forces opposées (factions, groupes politiques, États) dans un territoire défini. Cependant, une guerre n’a jamais lieu uniquement sur un champ de bataille, un territoire, mais aussi dans l’esprit et dans l’imagination. Les théories modernes de la guerre commencent à en tenir compte avec l’introduction de l’expression « guerre hybride ». Et pour la guerre hybride on distingue trois territoires, trois espaces d’exercice : le champ de bataille classique, la population civile de la zone de conflit, et la communauté internationale. Certains penseurs et praticiens de la guerre moderne voient là un changement radical concernant les enjeux de l’affrontement : par exemple, le général russe Gerassimov, il y a plus de sept ans (avant l’annexion de la Crimée), affirmait que l’objet et le but de la guerre étaient désormais la société plutôt que le territoire. Mais que faut-il entendre quand on parle de « la société » en tant que champ de bataille ? Que faut-il entendre par faire la guerre dans ou à une société, et non plus sur et pour un territoire ? Si on conçoit la société comme une entité physique, alors ce sera, par exemple, l’implication indirecte des civils, leur mobilisation en faveur de la guerre, ou, au contraire, tout ce qui peut tendre à les dissuader de la soutenir. Et si on la voit comme une conscience collective, alors on parlera de la propagande, de la désinformation, etc., c’est-à-dire du façonnement actif de la compréhension, par les citoyens, du « bombardement » de leurs consciences. C’est ce qu’on appelle la guerre de l’information ou guerre idéologique. |
|
|
Terre, territoire ou territorialisation ? Lorsque la conscience humaine est considérée comme un nouveau champ de lutte, elle est identifiée à un territoire vide qui peut être occupé, saisi, subjugué et peuplé d’images ou d’idées. Mais cette représentation est trompeuse, car les territoires qui font l’objet de la lutte sont des territoires déjà habités, ou en principe habitables. Un territoire est par définition une zone de terre habitée, occupée par des groupes d’hommes ou d’animaux qui la contrôlent et la soumettent à leur propre pouvoir, c’est-à-dire en protègent et en défendent les frontières. Or, de même qu’il n’y a donc pas de territoires vides, il n’y a pas non plus de conscience vide tel un réceptacle sans contenu dans lequel on verserait des images, des croyances... Pour cette raison, il serait plus juste de considérer la conscience non pas comme territoire mais comme territorialisation. Entendons par là le mouvement par lequel la conscience acquiert ou occupe un territoire, mais aussi se « déterritorialise » ou se « reterritorialise » constamment, pour emprunter les néologismes inventés par Gilles Deleuze. La conscience n’est pas un espace stable, c’est un mouvement nomade à la recherche de territoires qu’elle façonne ou refaçonne ou abandonne. Certains nomades se transforment en sédentaires, ils ne bougent plus alors des positions qu’ils viennent occuper. Mais ce mouvement de stabilisation, cette immobilisation ou cette stagnation, ne nie pas la nature mobile de la conscience. Et contrairement aux animaux, la conscience peut trouver son territoire n’importe où : dans un souvenir, un fétiche, une idée, une théorie, une croyance. Il est vrai que, comme le remarquent Deleuze et Guattari dans Qu’est-ce que la philosophie ?, certains animaux « peuvent refaire territoire sur quelque chose d’une autre nature (l’éthologue dit que le partenaire ou l’ami d’un animal “vaut un chez-soi”, ou que la famille est un “territoire mobile”) » (p. 67). Néanmoins, dans le monde animal, le territoire coïncide généralement avec la terre ou au moins avec le corps de l’autre. En revanche, souvent, dans le monde humain, le territoire et la terre ne coïncident pas. Non seulement une personne peut déplacer sa terre (sa propriété) vers un autre territoire, mais son territoire — ce à quoi elle s’accroche par ses pensées, s’enracine par ses sentiments, ce qu’elle s’approprie ou à quoi elle s’identifie — peut ne pas coïncider avec le sol sur lequel elle marche, ou même n’avoir rien à voir avec la terre où elle habite. |
|
|
De la guerre factuelle à la guerre de conscience La conscience n’est donc pas un territoire vide en attente d’être occupé. Au contraire, elle se reterritorialise et se déterritorialise elle-même constamment. La conscience peut déterminer la présence ou l’absence des événements militaires eux-mêmes. De la part des conscrits comme des réservistes (et généralement aussi de leurs proches), c’est elle qui détermine, sur le plan individuel, l’acceptation ou le refus de « faire la guerre », à commencer par l’acceptation ou le refus de la mobilisation. Et dans la guerre même, c’est d’elle, sous la forme ce qu’on appelle le « moral » des soldats (et aussi de « l’arrière »), que dépend pour une part essentielle le comportement collectif des troupes, depuis l’héroïsme sur le champ de bataille jusqu’à son contraire avec tous ses degrés, la panique, la fuite, la déroute ou même la désertion. Ainsi la guerre ne se ramène pas à des événements réels mais dépend beaucoup de leur perception. Les gens voient un conflit comme leur propre guerre — ou non. Et par conséquent s’y engagent, ou non. Par exemple, face à l’invasion nazie, la grande majorité des Français n’ont pas participé à la Résistance. Bien que la France ait déclaré la guerre à l’Allemagne après l’invasion de la Pologne, les soldats français sont restés inactifs dans les tranchées pendant près d’un an. Et lorsque les Allemands sont entrés sur leur territoire et que le gouvernement a déclaré un armistice, ils se sont dispersés pour rentrer chez eux. Certes, ils n’ont pas dit que ce n’était pas leur guerre, ils l’ont baptisée la « drôle de guerre ». Il est vrai qu’une partie de la population a par la suite rejoint la Résistance et même la lutte ouverte, mais cela n’a pas constitué un phénomène de masse comme c’était le cas notamment en Russie, où tout le pays, toute la population s’est engagée d’une façon ou d’une autre dans la guerre. Si la conscience d’un homme se déterritorialise par rapport à la terre où se déroule la guerre, il n’est pas étonnant que non seulement il n’y participe pas, mais qu’il quitte cet espace, émigre et devienne un « homme sans lieu ». Pendant la deuxième guerre mondiale, le cinéaste underground Jonas Mekas, par exemple, quitte la Lithuanie avec une perception très claire de la situation générale et de la sienne propre, ainsi que du destin de son pays : « Je ne sais pas distinguer un fusil d’un écusson. (...) Je ne suis ni un soldat ni un résistant. Je suis un poète. Que les grands se battent, mais nous, nous sommes tout petits. Ce monde passe par-dessus nos têtes. Si tu t’agites, il t’écrasera entre deux grosses roues, comme un rien. Quant aux petites nations qui sont au milieu, plus nous sommes nombreux à être en vie, mieux c’est »1. Aujourd’hui, pour beaucoup de Lithuaniens, ces considérations pourraient paraître scandaleuses. A l’époque en effet, dans les années 1944-1949, tant de jeunes gens sont partis à la résistance et y sont péri, tandis que d’autres ont émigré et que certains parmi eux (mais pas tous !) ont organisé la résistance à partir de l’étranger. Ils ne considéraient évidemment pas que lutter n’a pas de sens. A présent, ces résistants sont considérés comme des héros. |
1 Jonas Mekas, Žmogus be vietos. Nervuoti dienoraš?iai (L’homme sans lieu. Journal énervé), Vilnius, éditions Baltos lankos, 2000, p. 9. |
|
Bien sûr, à l’époque, aucun pays de l’Europe de l’Est ne disposait de médias aussi puissants qu’aujourd’hui, capables de former systématiquement, vis-à-vis de la guerre, une attitude de masse à laquelle même les esprits les plus critiques auraient peine à résister. A l’époque, ni les masses ni les médias n’exigeaient des intellectuels et des artistes qu’ils déclarent publiquement à quel camp ils appartiennent ou qu’ils s’engagent sans équivoque dans « notre guerre ». Alors le cinéaste lithuanien pouvait écrire, en quittant son pays : « Si vous voulez m’accuser de manque de patriotisme ou de courage, allez au diable ! C’est vous qui avez créé cette civilisation, ces frontières, ces guerres. Je ne comprends ni ne veux de votre civilisation ni de vos guerres. Fichez-moi la paix, occupez-vous de vos affaires. (...) Car moi, je suis libre, même face à vos guerres »2. Quel écrivain, quel artiste contemporain pourrait-il écrire de tels mots aujourd’hui sans qu’on s’en indigne, sans qu’on l’accuse de « servir les forces ennemies », secrètement ou involontairement ? |
2 Op. cit., pp. 9-10. |
|
D’un autre côté, il est vrai que parmi ceux qui ont émigré à l’époque de l’après-guerre, beaucoup n’ont pas cédé à la résignation. Certains ont au contraire continué à participer aux luttes en se reterritorialisant à partir d’autres territoires, d’autres terres que la terre natale. Ce fut notamment le cas de Greimas, organisant la résistance depuis l’Ouest. En pareil cas, la séparation entre le territoire et la terre était tout à fait évidente : reterritorialisée sur une terre qui n’était pas occupée par le corps, la conscience participait à la résistance à distance. C’est aussi ce qui est arrivé à beaucoup d’Européens de l’Est après le déclenchement de la guerre en Ukraine : une participation à la guerre purement par l’imagination, alimentée quotidiennement par tous les médias, une reterritorialisation dans une guerre qui se déroule sur les terres étrangères. Ce sont précisément ces cas inversés qui semblent les plus intéressants : lorsqu’une guerre sur sa propre terre n’est pas considérée comme « ma » ou « notre » guerre, mais comme « leur » guerre ou « votre » guerre, celle « des grands ». Ou bien, au contraire, lorsqu’une guerre sur une terre étrangère devient « notre » guerre. Au demeurant, cette distinction notre / votre n’est pas stable mais peut changer d’un moment à l’autre par rapport à un même conflit. De la Seconde Guerre mondiale par exemple — que les Soviétiques appelaient la Grande Guerre patriotique —, les Lithuaniens d’aujourd’hui se sont complètement déterritorialisés. Comme s’il s’agissait d’une catastrophe naturelle arrivée sur leur terre, passée puis repartie et oubliée. Le territoire de la patrie et ses frontières ayant changé après la chute de l’Union soviétique, cette guerre n’est plus considérée comme une guerre lithuanienne, bien qu’elle se soit déroulée en partie sur le sol lithuanien. Et cela en dépit du nombre de Lithuaniens qui y ont participé ainsi que du nombre de morts, y compris parmi la population juive. Aujourd’hui, la Grande Guerre patriotique est considérée en Lithuanie comme une guerre des autres, des Russes. Pour cette époque, la seule guerre « à nous », c’est la guérilla qui eut lieu durant dix ans après la Seconde Guerre mondiale sur le territoire lithuanien lorsqu’une partie de la population s’est insurgée contre l’intégration du pays dans l’Union soviétique — intégration considérée comme une pure et simple occupation. A l’époque soviétique, cette guérilla n’était pas perçue sans ambiguïté. Tous les Lithuaniens ne la considéraient pas comme leur guerre. La lutte était féroce. Non seulement ceux qui faisaient la résistance dans les forêts sacrifiaient leur vie dans la lutte contre les occupants, mais, qui plus est, personne, surtout parmi les habitants des campagnes, ne pouvait en fait y échapper. Il suffisait que quelqu’un de la famille soit favorable au nouveau pouvoir soviétique pour que toute la famille y compris les enfants puisse être punie, massacrée par les maquisards ; à l’inverse, il suffisait que quelqu’un de la famille aille à la résistance, et toute une famille était envoyée en Sibérie. Pourtant, aujourd’hui, c’est devenu la guerre patriotique de tous, autrement dit, le grand mythe national, comme l’appellent les historiens, par opposition à l’autre mythe, celui des Soviétiques, la Grande Guerre patriotique. La guerre de résistance est devenue un sensus communis. Si bien que ceux qui ne voulaient pas y participer à l’époque, qui ne la considéraient pas comme leur guerre, sont maintenant parfois méprisés en secret. Il est probable que depuis vingt ans, dans l’esprit des Lithuaniens, le soutien croissant de ce grand mythe national — la guerre de résistance — a façonné leur compréhension de la guerre en général et plus spécialement leur attitude envers la guerre défensive surtout quand il s’agit du même occupant, les Russes. Cela explique peut-être pourquoi la population, dans son immense majorité, n’a pas hésité à appeler la guerre ukrainienne « notre guerre » et a manifesté son mécontentement face aux raisons pour lesquelles nous, les Lithuaniens, n’y prenons pas part, ne sommes pas directement impliqués, ne faisons qu’observer. Et pas seulement « nous », mais aussi tous les Européens. Pourquoi ce monde occidental « pourri et corrompu » ne veut-il pas faire la guerre ? Oh ! tout simplement parce que ces occidentaux n’ont jamais vu que leur propre intérêt, parce qu’ils nous ont toujours trahis, ne serait-ce qu’après la Seconde Guerre mondiale en nous livrant aux Russes... Quels hypocrites, avec toute leur soi-disant haute culture, leur art et leur philosophie. Dans l’Europe divisée entre ceux qui ne veulent pas de guerre (mondiale) et ceux qui insistent sur le fait que nous sommes tous déjà dans une guerre (mondiale) et que les Ukrainiens meurent pour tout le monde, y compris pour nous, deux images de la guerre ont émergé : la vision traditionnelle, qui associe la guerre au territoire à défendre, et la moderne, qui voit la guerre avant tout comme une guerre de société et une guerre au sein de la société. La guerre réelle a été rapidement et facilement transformée en une guerre des consciences et des imaginaires avec l’aide des technologies modernes de l’information. |
|
|
La conscience reterritorialisée Que se passe-t-il dans notre pays avec « notre guerre », cette guerre qui se déroule sur un territoire qui n’est pas le nôtre ? Tout d’abord, on se l’approprie de toutes les manières possibles, pour la faire « nôtre » : en son nom, on fait toutes sortes de bonnes actions, communautaires, sacrificielles, mais aussi ordinaires. Dans cette appropriation, on dirait qu’on attribue un rôle particulier au monde intellectuel et artistique. Les artistes, comme tous les autres, non seulement proclament chaque jour leur solidarité, mais aussi laissent sentir un remords, comme si on les accusait : Comment osez-vous faire des choses aussi futiles alors qu’il y a la guerre, la nôtre ? Aussi bien, dès les premiers jours de cette invasion, on les a vus s’employer à justifier leurs activités : c’est au nom de l’Ukraine et pour l’Ukraine que nous faisons ces expositions, ces concerts, ces performances. Jamais l’art n’avait joué un tel rôle de serviteur ou même d’otage, jamais il n’avait été autant molesté. Des processus encore plus inquiétants se déroulent dans le monde intellectuel. Certains ont commencé à abandonner leur travail à cause de la guerre — sans y être contraints par qui que ce soit. Ils déclarent ne plus croire à la valeur du travail intellectuel. En même temps, certains expriment de la rancune vis-à-vis des intellectuels, des artistes et même de la population en général des autres pays, de « tous ces Français, ces Allemands, ces Italiens » qui ne montrent pas une volonté zélée de se battre, de participer à la guerre devenue celle de tout le monde, de faire des sacrifices, de renoncer à leurs richesses. Comment osent-ils ne pas considérer cette guerre comme leur guerre, notre guerre ? Comment osent-ils ne pas vouloir se battre ? D’autres, les Ukrainiens, se battent et meurent pour eux. Le gouvernement lithuanien ayant décidé (comme ceux des autres pays de l’OTAN) de ne pas participer militairement avec sa propre armée, c’est la société tout entière qui semble devenir une armée et vivre selon la logique de la guerre : tout ce qu’on fait doit être pour la guerre ou au nom de la guerre ; seule la guerre peut justifier une activité, quelle qu’elle soit, et lui donner de la valeur. Les intellectuels, les artistes, tous les travailleurs de la sphère intellectuelle ou spirituelle en sont ainsi arrivés à ne plus juger ce qu’ils font qu’en prenant la guerre comme la mesure absolue. Comme si la guerre n’était pas une exception dans le cours de la vie sociale et par rapport à notre condition mais son essence, sa base, ce qui permet de tout évaluer. Quoi d’autre fait-on encore au nom de « notre guerre » ? On prône ouvertement la censure. Lors d’un débat à la télévision publique, une journaliste des plus progressistes demande sans le moindre détour pourquoi l’État n’impose pas la censure pour lutter contre la littérature de propagande en provenance de la Russie. Et puisque « la propagande agit comme un virus », un spécialiste des relations publiques suggère que l’État prenne soin de la « sécurité de la pensée » au lieu de « tout laisser à la pensée critique ». Car, voyez-vous, « la société est très diverse »... Mais le pire, c’est de voir les intellectuels succomber à la propagande douce qui s’est rapidement intensifiée dans tous les médias du pays. Sauf rares exceptions, plutôt que de chercher à démultiplier les points de vue, à comprendre la diversité des réactions, la polyphonie des voix face à l’état de guerre, plutôt que de défendre l’idée qu’il n’y a pas qu’une seule vérité indiscutable, les voilà qui au contraire soutiennent en chœur qu’il n’y a qu’une seule bonne opinion et que tout le monde doit voir et réagir de la même façon. Soutenir le contraire ne veut pas dire que tout le monde a raison mais que du moins tout le monde a le droit de penser différemment, et que chaque pensée est déterminée par une certaine perspective, par certains intérêts, par l’histoire. On ne peut pas, par exemple, vouloir que les Français, les Italiens ou les Allemands voient la guerre d’Ukraine de la même manière que les Lithuaniens (sans parler de la grossière simplification qui réduit des sociétés aussi hétérogènes à des unités nationales monolithiques... « les » Français, « les » Allemands, « les » Américains, etc.). Mais le désastre, la défaite, « notre défaite » est précisément de voir une société dans laquelle même les intellectuels, devenus sédentaires, s’installent définitivement dans le territoire sûr du sens commun au lieu de rester comme étrangers à leur propre société et de regarder avec les yeux de l’autre ce qui est familier aux indigènes. En somme, au lieu d’être des nomades qui ne supportent aucune installation définitive sur aucune terre. Car si la guerre de propagande vise à conquérir les consciences comme on prend un territoire, la guerre des intellectuels ne devrait-elle pas, à l’inverse, chercher à déterritorialiser la conscience, à la forcer à constamment partir en quête de nouveaux territoires où se reterritorialiser ? |
|
1 Jonas Mekas, Žmogus be vietos. Nervuoti dienoraš?iai (L’homme sans lieu. Journal énervé), Vilnius, éditions Baltos lankos, 2000, p. 9. 2 Op. cit., pp. 9-10. |
|
______________ Résumé : Le déclenchement de la guerre en Ukraine et surtout sa présentation par les médias des pays voisins (notamment en Lithuanie) incite à se poser des questions : qu’appelle-t-on « notre guerre » ? quand l’appelle-on ainsi ? et que fait-on aujourd’hui au nom de cette guerre dite « la nôtre ». Il est frappant d’observer que cette dénomination ne dépend plus du territoire où la guerre a lieu : les gens considèrent que la guerre est la leur même si elle se déroule en terre étrangère. Ce phénomène n’est pas nouveau. On peut en donner d’autres exemples comparables, ou inversés, dans l’histoire du XXe siècle. Cela incite à concevoir la conscience non pas comme un récipient vide que les médias et la propagande rempliraient d’idées et de représentations mais en tant que mouvement constant de déterritorialisation et de reterritorialisation selon la vision deleuzienne. Resumo : A guerra na Ucrânia, e sobretudo sua apresentação na mídia dos países vizinhos (especialmente a Lituânia), levanta questões : o que é chamado de “nossa guerra” ? quando fala-se assim ? e o que está sendo feito hoje em nome desta guerra chamada de “nossa”. É impressionante observar que esta denominação não depende mais do território onde a guerra acontece : as pessoas consideram a guerra como sendo sua, mesmo que ela ocorra em solo estrangeiro. Este não é um fenômeno novo. Encontramos outros exemplos comparáveis, ou invertidos, na história do século 20. Isto nos leva a promover o conceito de consciência não como um recipiente vazio que a mídia e a propaganda atual encheriam de ideias e representações, mas como um movimento constante de desterritorialização e reterritorialização de acordo com a visão Deleuziana. Abstract : The outbreak of the war in Ukraine and above all its presentation by the media in neighbouring countries (especially Lithuania) raises questions : what is called “our war” ? when is it called this way ? and what is being done today in the name of this so-called “our war”. It is striking to observe that this denomination no longer depends on the territory where the war takes place : people consider the war to be theirs even if it takes place on foreign soil. This phenomenon is not new. There are other comparable, or reversed, examples in the history of the 20th century. This suggests that consciousness should be conceived not as an empty vessel that the media and propaganda fill with ideas and representations, but as a constant movement of deterritorialisation and reterritorialisation according to the Deleuzian vision. Mots clefs : guerre, médias, territoire, territorialisation. Plan : La société an tant que territoire de la guerre Terre, territoire ou territorialisation ? |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |
|
Recebido em 10/10/2022. / Aceito em 25/10/2022. |