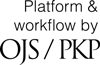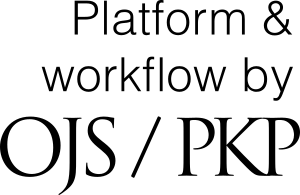Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
Forum-dossier : Quelques paradoxes du « post- » consumérisme
|
(Re)penser la marque à l’ère Jean-Paul Petitimbert Publié en ligne le 22 décembre 2021
|
|
|
Le monde contemporain n’a plus rien de commun avec celui dans lequel le marketing et la marque sont nés, il y a un siècle environ. L’accélération de l’histoire et du rythme des bouleversements qui l’ont émaillé (technologiques, économiques, et aujourd’hui climatiques) affecte de nombreux métiers, qui ne peuvent que s’efforcer d’y faire face au mieux. Le marketing n’échappe pas à la règle. Or la face sombre du modèle de consommation issu du capitalisme industriel sur lequel précisément repose le principe même du marketing est de plus en plus visible. A l’insoutenabilité écologique s’ajoute la déception croissante de consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à aspirer à consommer mieux, quitte à consommer moins : effets négatifs sur la santé, obsolescence programmée des produits, promesses de marques non tenues, etc. Et plus généralement, sentiment diffus que le fait de consommer toujours davantage n’a, in fine, plus vraiment de sens, si tant est qu’il en ait jamais eu un. La question du sens est donc au cœur des interrogations qui taraudent le marketing d’aujourd’hui. Et ses préoccupations portent, d’après nous, sur des phénomènes essentiellement sémiotiques et non pas strictement marchands ou économiques. En effet, l’indifférenciation grandissante entre marques opérant dans les mêmes univers de produits, la remise en question par les clients de la valeur des valeurs échangées avec les marques, ainsi que l’affaiblissement des liens de fiducie qu’ils avaient tissés avec elles sont autant de problèmes qui relèvent d’une discipline qui s’est donné pour objet l’étude de la signification, de la construction du sens, précisément. Nil novi sub sole ? Si ce grand précurseur en la matière qu’était Jean-Marie Floch s’attaquait déjà à ces problématiques il y a plus de trente ans, c’est sans doute que ce qu’on appelle le « post-consumérisme » était déjà en herbe. Il semble bien qu’il ait pris aujourd’hui une ampleur telle que les questions auxquelles Floch s’attaquait à son époque sont à présent d’une inquiétante acuité puisqu’elles vont jusqu’à ébranler ce qu’il est convenu d’appeler le « paradigme marketing » et à remettre en question la doxa qui l’accompagne. |
|
|
1.1. L’hypertrophie du contrat Cette doxa qui prévaut tant au sein de la communauté des marketeurs que des quelques trop rares praticiens de la « sémiotique commerciale » (ces « petites compagnies de voltigeurs très agiles », comme les appelle Eric Landowski1), a tendance à réduire la relation marque / consommateur à une relation de type contractuel établie sur la base des promesses et des propositions que la publicité ou d’autres moyens de communication font au client visé (la « cible ») et que celui-ci accepte au travers de l’acte d’achat, prélude à ce qu’on appelle la « consommation » des produits mis à sa disposition. C’est en partie vrai, surtout si on limite la compréhension sémiotique de ce qu’est une marque aux résultats des seules analyses des messages diffusés par ses campagnes publicitaires. |
1 Cf. « Régimes de sens et formes d’éducation », intervention au colloque « Sémiotique et sciences humaines et sociales : la sémiotique face aux défis sociétaux du XXIe siècle », Limoges, 25-27 novembre 2015 (http:/ /www.unilim.fr/colloquesemiodefisshs/wpcontent/ |
|
La notion de brand contract, ou « contrat de marque », est de fait relativement courante dans la littérature et l’enseignement du marketing. Elle y est présentée comme la dimension essentielle de la marque, comme ce qui l’amène à s’engager vis-à-vis de ses publics, au travers de sa communication, qu’elle soit publicitaire ou packaging. En général, cet engagement peut prendre deux formes : soit la proposition de valeurs fonctionnelles d’usage (ou promesses dites objectives), liées aux produits, soit celle de valeurs émotionnelles d’image (ou bénéfices dits subjectifs), liées à la personne de l’utilisateur potentiel visé. Ces engagements sont la plupart du temps assortis de ce que le marketing désigne sous les appellations de reason why et de reason to believe. Il s’agit ni plus ni moins que de « preuves » ou de « supports » des messages, c’est-à-dire d’arguments censés étayer la crédibilité et renforcer le pouvoir de conviction des propositions faites par la marque pour mieux y adhérer. |
|
|
Mais réduire la relation marque / consommateur à cette seule argumentation contractuelle, ce serait oublier une donnée fondamentale en matière de marketing et de branding. En ces temps dits de « post-consumérisme » qui menacent les constructions marketing que sont les marques, il nous paraît opportun de la rappeler ici, en profitant de l’occasion offerte par ce dossier de recherche. Cette donnée nous avait pourtant déjà été rappelée, dès 1990, par le regretté Jean-Marie Floch qui écrivait alors que si « la marque naît d’une fiducie, d’une confiance donne?e et maintenue ; elle meurt par trahison ou de?ception »2. Que nous révèle cette petite phrase ? Elle rappelle en termes très clairs que dans cette relation entre une marque et ses consommateurs ou clients, il n’y a pas que du contrat : il y a aussi une grosse part de sanction, et que celle-ci peut bien entendu s’avérer négative. |
2 J.-M. Floch, Marketing, sémiotique et communication : Sous les signes les stratégies, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p. 75. |
|
Pourquoi s’attarder sur ce qui ne paraît et pourrait n’être finalement qu’un petit détail, relevé au détour d’une courte phrase trouvée sous la plume de Floch ? C’est qu’à notre avis, c’est précisément l’hypertrophie de la notion de contrat qui, dans les théories (sémiotique et mercatique) comme dans la pratique du branding et des analyses du sens, a amené aux questionnements qui occupent la plupart des contributions marketing du présent dossier. |
|
|
1.2. Retour sur quelques fondamentaux Qu’est-ce qu’une marque ? On trouve encore, ici ou là dans la littérature spécialisée contemporaine, la définition qu’en donnait en 1962 l’American Marketing Association : « signe ou symbole servant à distinguer un produit afin de le différencier des produits concurrents ». Or une telle définition ne correspond vraiment qu’aux « protomarques » dont les seules fonctions étaient l’identification de l’origine du produit, la différentiation et la garantie. En effet, on sait que dès la plus haute antiquité, de nombreux artisans ou producteurs avaient déjà pris l’habitude d’apposer des signes distinctifs sur leurs produits, en général des monogrammes, pour les distinguer de ceux de leurs concurrents. Ainsi, les archéologues retrouvent régulièrement des marques de producteurs sur des amphores de vin ou d’huile qui, pouvant paraître toutes identiques aux yeux de leurs acheteurs, permettaient de les différencier et d’identifier leur provenance. Depuis ces époques lointaines, l’évolution de la pratique du branding a étendu le rôle de la marque bien au-delà de ces seules fonctions et a amené à se départir de cette vision primitive et exclusivement signalétique de la marque qui la réduit à un simple repère, ou symbole différentiel. Dans le texte déjà cité plus haut, Jean-Marie Floch abondait aussi dans ce sens : « La marque n’est pas un pur trait distinctif, sans autre fonction que d’aider a? identifi?er le fabricant d’un produit ou le prestataire d’un service. La marque n’est pas non plus “d’abord et avant tout” un signe, une griffe ou un mythe : de telles de?fi?nitions sont de?ja? des philosophies de la marque, des attentions exclusives porte?es a? telle ou telle de ses dimensions »3. |
3 Ibid. La référence au « mythe » renvoyait à une théorie dominante à l’époque, que Floch s’est d’ailleurs attaché à analyser dans ce même ouvrage, à propos de la marque Citroën (pp. 143-144). |
|
Le dispositif assez complexe qu’est la marque commerciale telle que nous la connaissons aujourd’hui s’est surtout développé à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe. C’est sous l’influence des industriels qui l’ont mis au point, pour contourner ou passer outre le pouvoir des distributeurs — à une époque où la vente de détail se faisait au travers d’un comptoir sous la haute autorité d’un vendeur qui, seul, maîtrisait l’argumentaire —, que la marque a pris l’essor qu’on lui connaît et qui lui a permis d’accéder à la place centrale qu’elle occupe dans le système marchand contemporain. Dès l’avènement de la marque, le client n’entrait plus dans un magasin pour demander des céréales pour son petit déjeuner, il se mettait à demander des Kellog’s ou des Quaker Oats ; ni à chercher du savon, mais du Ivory ou du Lifebuoy ; ni à vouloir une montre, mais à désirer qui une Patek Philippe, qui une Jæger Lecoultre, etc. La marque, et avec elle sa publicité (sa « réclame », comme on disait à cette époque-là), était donc le moyen de contraindre le détaillant à vendre ce que proposait l’industriel. Il s’ensuit, aussi paradoxal que cela puisse paraître dans le monde marchand d’aujourd’hui, que la marque moderne est née et s’est ensuite développée comme une arme pour lutter contre le commerce ! Pour preuve, le titre et le sous-titre d’un livre paru en 1926, puis de très nombreuses fois réédité par la suite, La marque, son lancement, sa vente et sa publicite?. – La lutte entre l’industrie et le commerce4. Cette formulation souligne assez clairement que la fonction première d’une marque est de permettre de battre en brèche le distributeur, de le court-circuiter en tenant un discours destiné à se substituer au sien, permettant ainsi de créer un lien direct entre le producteur et le consommateur final. La marque est ainsi devenue une instance de médiation entre le fabricant et son client, l’interface de remplacement qui s’est substituée à celle, plus opaque est moins maîtrisable, que représentait le distributeur. Le développement rapide du libre-service, attelé à celui des mass-media, a ensuite permis d’amplifier très largement le phénomène. |
4 Par Francis Elvinger, un des premiers publicitaires français, formé à l’« école américaine » de la communication. Paris, Librairie d’économie commerciale, (1926) 7e éd., 1935. |
|
Mais au-delà de ce seul stratagème de court-circuit, l’idée des industriels était aussi, bien entendu, que le client non seulement demande (ou « réclame ») au détaillant une marque plutôt qu’un simple produit générique — ce que la marketing appelle la « décommodification » —, mais surtout qu’il la lui redemande à chaque passage dans son établissement. La deuxième des grandes fonctions assignées à la marque consistait donc à fidéliser la clientèle. Aussi, au fil de son histoire, le marketing a-t-il développé deux grands types de stratégies : d’une part la stratégie dite de conquête, d’autre part celle dite de fidélisation. La première consiste essentiellement à augmenter le nombre d’acheteurs — la « part de marché » — en se faisant préférer aux autres marques concurrentes en présence (c’est aussi ce qu’on appelle la stratégie de pénétration, ou de recrutement). La seconde vise à se faire préférer plus souvent, autrement dit à apparier les objectifs de préférence et de fréquence des occasions d’achat : il s’agit simplement de se faire préférer non seulement une fois, mais deux fois, … n fois. Or, d’un point de vue sémiotique, les logiques à l’œuvre dans l’un et dans l’autre cas de figure sont radicalement différentes. |
|
|
1.3. Conquête ou fidélisation : deux syntaxes distinctes La culture marketing est obnubilée par la métaphore guerrière, tout comme les marketeurs qui la font, la nourrissent et la vivent: guerre des prix, conquête, campagne, chef de produit, objectif, cible, forces en présence, position, plan de manœuvres, tactique, vague (média), territoire de marque, navire amiral (ou flagship), etc. sont tous des termes du jargon couramment utilisé dans la profession. Dès lors, le tropisme de la « prise de part de marché » — assorti de l’obsession pour la « persuasion du consommateur » qui en est l’avatar — en est venu à phagocyter, voire à oblitérer, toute autre façon de considérer le cœur du métier. Pour un sémioticien, une telle approche, parce qu’elle est avant tout soucieuse de différenciation, de segmentation, de catégorisation, relève d’une logique essentiellement paradigmatique. Elle découle d’une vision du monde où la valeur des choses et le sens qu’elles prennent sont organisés dans des scénarios de choix, de comparaison, d’arbitrage, de supériorité ou d’équivalence et d’éventuelle substitution, c’est-à-dire selon une logique qui les inscrit dans un système de relations ou… ou… Ainsi, la notion de « positionnement », propre au marketing qui l’a inventée et en fait toujours un abondant usage, découle-t-elle d’une telle conceptualisation. La théorie du positionnement consiste pour une marque à s’efforcer d’imprimer chez ses clients et prospects une trace mentale distincte de celle de ses concurrents : l’eau d’Evian veut représenter la jeunesse, alors que Contrex — son concurrent — table sur la minceur ; Coca Cola propose du bonheur, le chocolat Milka « vend » de la tendresse, les ordinateurs Apple de l’anticonformisme, les automobiles Peugeot du plaisir, etc. Le positionnement est donc le résultat d’un mécanisme par lequel la marque vise à investir et à s’approprier une portion de contenu (une idée, un « concept », une valeur) et à l’implanter durablement dans l’esprit des publics. Cette forme de pensée amène très vite à n’envisager la relation marque / client que sous le seul angle de la manipulation dans une logique du faire-faire (faire-vouloir et in fine faire-acheter) qui passe non seulement par un faire-savoir (que le produit est disponible), mais aussi par un faire-croire (que les promesses faites sont fiables) à l’aide, comme on l’a évoqué plus haut, des reasons-why et reasons-to-believe. C’est d’emblée sur des micro-récits de proposition et d’acceptation, autrement dit sur des structures narratives de contrat, que se focalise l’attention du marketeur qui s’évertue par tous les moyens (publicitaire, packaging, merchandising, etc.) à affirmer et à illustrer les valeurs dont la marque investit son offre et auxquelles elle propose à ses publics d’adhérer. Les deux figures que sont au niveau thématique la marque et le consommateur endossent au niveau narratif les rôles actantiels respectifs de Destinateur et de Sujet-manipulé. L’un exerce un faire persuasif sur l’autre, lequel, en retour, exerce un faire interprétatif qui va l’amener à accepter (ou éventuellement refuser) la proposition, puis à agir, c’est-à-dire à passer (ou pas) à l’acte d’achat. Or, si dans l’encadrement axiologique qui ouvre et ferme l’algorithme narratif standard, c’est à l’épisode qui se trouve en amont que correspond la conquête, il n’en va pas de même pour la fidélisation. Celle-ci correspond plutôt à l’épisode situé en aval, celui de la sanction, où, une fois l’action réalisée, c’est-à-dire le contrat honoré, c’est au tour du Destinateur (devenu judicateur) d’exercer un faire interprétatif et d’examiner si le paraître des choses correspond bien à leur être, autrement dit si ce qui a été convenu a été effectivement réalisé. A cette inversion d’attribution du faire interprétatif au niveau actantiel correspond dans le cas présent une inversion symétrique au niveau thématique : le rôle actantiel de Destinateur n’y est plus « joué » par la marque, mais bien par le consommateur qui l’évalue. Et de même, c’est la marque qui à son tour endosse celui de Sujet-opérateur soumis au jugement de sa clientèle. A ces inversions actantielle et thématique correspond aussi une inversion aspectuelle. Si l’orientation prospective de la conquête se traduit par des scénarios d’interpellation et d’affirmation des valeurs qu’on propose dans l’espoir d’y faire adhérer, la fidélisation, elle, suppose au contraire qu’on rappelle ces mêmes valeurs, qu’on montre que la « promesse » initiale a été tenue, que le « bénéfice » a bien été délivré. La fidélisation d’un consommateur à une marque se conçoit donc en termes de mémoire : son orientation est rétrospective. Et à ce titre, ce n’est pas selon une logique de type paradigmatique qu’il convient de penser la fidélisation, mais plutôt selon une approche syntagmatique où les choses, dans un jeu de relations et… et…, prennent sens et valeur en fonction de leurs enchaînements et du procès que construisent au fil du temps ces consécutions, dans des rapports successifs de présupposition qui ne sont reconnaissables qu’après-coup, par une sorte de « lecture à rebours ». Même si les deux approches ne sauraient s’opposer frontalement l’une à l’autre, du fait de la complémentarité de leurs natures paradigmatique et syntagmatique respectives, force est de constater que sous l’influence de l’idéologie de la croissance et sous l’effet du diktat « consumériste » de l’innovation permanente qui en résulte, et donc du lancement fréquent de nouveaux produits ou services, mais aussi de nouvelles marques (sous l’impulsion des « start-ups » qui, à la faveur du développement du numérique, poussent aujourd’hui comme des champignons), les marketeurs s’obstinent à privilégier la conquête au détriment de la fidélisation, à préférer pour ainsi dire les discours d’appel (des consommateurs) aux discours de rappel (des valeurs). D’un point de vue modal, leur attention se porte donc plus sur le faire-faire qui caractérise la manipulation initiale que sur l’être de l’être qui, lui, caractérise la sanction finale. Dans la pratique quotidienne du marketing, ce constat revient à s’intéresser davantage au client visé, à l’étude de ses « attentes, besoins et insatisfactions » (supposés ou réels) dans le but d’y répondre en lui faisant la promesse de les combler, qu’à la compréhension en profondeur de la marque elle-même. |
|
|
C’est sans doute là une des dérives du marketing qui ont amené à la situation préoccupante que nous connaissons et qui motive le titre de ce dossier, « La consommation — et ensuite ? ». Cette négligence pour la fonction de fidélisation de la marque est par ailleurs d’autant plus dommageable qu’une grosse partie de ce qui fait sa valeur financière (rappelons, si besoin est, que les marques se vendent et s’achètent couramment entre entreprises) est précisément constituée de sa clientèle acquise. Quand une entreprise achète une marque, elle n’achète pas que des actifs matériels et immatériels exclusivement industriels, technologiques ou juridiques. La valeur de ce qu’elle achète — ce qu’on appelle la brand equity, ou capital de marque en français5 — est avant tout constituée de ce qu’on peut mesurer des comportements adoptés (sanction pragmatique) et des jugements portés (sanction cognitive) par les consommateurs : la taille et le poids du segment de ses clients fidèles (sa part de marché), les attributs dont ils créditent son offre (sa qualité perçue), et l’image qu’ils ont d’elle (sa réputation). Acheter une marque, c’est aussi, et on pourrait dire surtout, « acheter ses consommateurs » et ce qu’ils pensent d’elle, voire ce qu’ils éprouvent à son égard (leur attachement). |
5 Deux expressions nées dans les années 1980, époque où eurent lieu de spectaculaires opérations de rachat qui montrèrent que la valeur d’une marque ne repose pas que sur son chiffre d’affaires. |
|
Or pour une même marque, on le constate fréquemment dans de nombreux univers de produits, cette dérive se traduit non seulement par la prolifération d’innovations (de plus en plus insignifiantes tant elles se ressemblent toutes du fait du mimétisme induit par la pratique généralisée du benchmark6), mais aussi par la surenchère de messages nouveaux (de nouveaux contrats) qui viennent s’empiler comme dans un mille-feuilles sur les messages qui les ont précédés, voire les annuler pour les remplacer. Ainsi en est-il de la récente « mode » du brand purpose. |
6 Le benchmark consiste à « partir à la pêche aux bonnes idées » en pratiquant un exercice régulier de veille concurrentielle sectorielle, avec pour visée de s’inspirer des trouvailles ou tout simplement de les copier à son profit. |
|
2. Dérives, paradoxes et apories 2.1. Le dernier mantra du branding post-consumériste Voici une dizaine d’années maintenant que dans les milieux marketing est née la désormais célèbre théorie du why ? — et du purpose, sa réponse — et qu’elle s’est ensuite largement développée et même diffusée jusque dans le conseil en stratégie d’entreprise7. Il s’agit d’un raisonnement selon lequel les marques dont la finalité (ou brand purpose) va au-delà du simple profit pour embrasser une cause générale désintéressée ou un projet mobilisateur, seraient préférées, par les consommateurs dits « post-consuméristes », à celles de leurs concurrentes qui n’affichent pas ce genre d’engagement militant. C’est ainsi qu’aujourd’hui le purpose est la plupart du temps directement relié aux notions de responsabilités sociale et sociétale de la marque, à l’éthique qu’elle prétend respecter et aux efforts qu’elle affirme déployer pour améliorer la vie non seulement de ses consommateurs, mais aussi celle de ses publics internes et, au-delà, des populations au sens large. |
7 Voir en particulier Simon Sinek, Start With Why : How great leaders inspire everyone to take action, New York, Portfolio, 2009 ; Find Your Why : A Practical Guide for Discovering Purpose for You and Your Team, New York, Portfolio, 2017. |
|
En quelques mots, pour cette théorie, le why (le pourquoi, assorti du purpose qui lui donne une réponse) constitue le noyau d’un système à trois niveaux. Au deuxième niveau, il s’articule avec le how ? (le comment) pour déboucher en fin de course sur le what ? (le quoi). Selon ses défenseurs, la plupart des marques n’ont aucune idée de leur purpose — hormis la finalité qui consiste à générer du profit (alors que ce n’est en fait là qu’un résultat) — et se contentent de valoriser leur what, c’est-à-dire les produits qu’elles offrent, en les différenciant de ceux de leurs concurrents par une argumentation sur leur how. Aussi prétendent-ils que c’est en tenant un raisonnement inverse que les marques peuvent avoir de plus grandes chances de succès : i) voici mon purpose (why) ; ii) voici comment je m’y prends pour l’atteindre (how) ; iii) et enfin voici ce que cela donne concrètement (what). La principale raison avancée pour faire appel à ce modèle est la non moins célèbre tarte à la crème socio-culturelle du « besoin de sens » des marchés qui, telle un serpent de mer, ressurgit à chaque soubresaut ou crise que connaît le système marchand. Et dans le contexte économique et écologique actuel, c’est en termes d’inquiétudes environnementales que ce « besoin de sens » est la plupart du temps interprété par les marketeurs. C’est ainsi que les communications d’un nombre croissant de grandes marques s’évertuent à diffuser des allégations sur leur soi-disant souci de contribuer à préserver la planète.8. |
8 « Making the Earth a better place to live in » est devenu en quelques années le syntagme figé le plus usé (au sens littéral d’éculé) par de nombreuses grandes marques sur leurs sites internet institutionnels : de Danone à L’Oréal en passant par Starbucks, Ben & Jerry’s, Patagonia et cent autres. |
|
Quelques remarques d’ordre général à ce propos. D’une part, il est navrant de constater que non seulement ce sont souvent les mêmes qui, après avoir pendant des années contribué à déséquilibrer l’écosystème, pillé les ressources naturelles et pollué l’environnement avec toutes sortes de déchets, tentent aujourd’hui de se « racheter une bonne conduite » (sans d’ailleurs faire de réel mea culpa9) mais aussi que les contre-vérités qu’ils profèrent de la sorte sont on ne peut plus favorablement accueillies par de larges segments du public. Il était sans doute grand temps qu’ils se convertissent, et les effets manifestes de l’anthropocène montrent qu’il est peut-être même un peu trop tard… D’autre part, cette envahissante vague téléologique parfumée à la verte chlorophylle n’est évidemment pas empreinte que d’innocents effluves bucoliques. Elle laisse aussi s’échapper certains relents de l’opportunisme dont le marketing est coutumier, lui qui, de longue date, sait (justement) flairer l’air du temps, et en faire son beurre. |
9 Seules quelques-unes se risquent à faire l’exercice. Citons par exemple la marque de vêtements Balzac Paris qui sur son site n’hésite pas à avouer avoir conscience de travailler dans la deuxième industrie la plus polluante du monde (la mode) et l’assume avec le plus grand sens possible des responsabilités, en s’attaquant frontalement et de manière volontariste aux difficultés que représente l’objectif de « limiter les dégâts ». Cf. https://balzac-paris.fr/pages/edito-ecologie. |
|
Comment des marques peuvent-elles être prises au sérieux en prétendant aujourd’hui avoir toujours porté aux nues ce qu’elles foulaient aux pieds hier (et que certaines continuent dans l’ombre à saccager ou détruire sans scrupule) ? Il est étonnant, à l’heure de la prétendue « transparence » où les réputations se font et se défont en quelques clics du fait du régime conversationnel à haut débit que le développement exponentiel du numérique et des réseaux sociaux a permis, qu’il n’y ait que si peu de voix pour s’élever et s’interroger avec lucidité et une pincée de sens critique sur ces soudaines professions de foi tout aussi vertueuses que surprenantes. Sans doute faut-il voir dans cette passivité (ou cette ingénuité) consensuelle un effet rémanent des habitudes que la société de consommation a si bien su instiller dans les esprits et installer dans la culture contemporaine, en particulier l’attrait, voire la fascination aveugle, pour les apparences. Il nous semble donc légitime de s’interroger sur le terme même de « post-consumérisme » : ne constituerait-il pas un abus de langage, et ne serait-il pas, à l’instar du purpose, rien de plus qu’un autre de ces mantras à la mode ? |
|
|
Cependant, soyons clair. Que les marques se préoccupent de l’avenir de la planète et s’efforcent d’intégrer de plus en plus de préoccupations environnementales dans leurs pratiques nous paraît bien sûr une excellente nouvelle compte tenu des excès que la production de masse a engendrés et de leurs effets dévastateurs. Mais s’agit-il pour autant d’en faire le principal moteur de la marque ? C’est au mieux la réponse à un how, éventuellement à un what, mais en aucun cas à un why10. |
10 Sauf quand on s’appelle Greenpeace ou WWF (mais peut-on véritablement parler de « marques » dans le cas de ces deux organisations ?). |
|
Pour en revenir à la question centrale, et en même temps à des considérations plus directement sémiotiques, force est de constater que la principale raison pour laquelle le purpose est devenu un « incontournable » de la théorie et de la pratique du branding, c’est qu’il se coule parfaitement dans les habitudes de pensée des marketeurs et s’accorde à souhait, en particulier, avec leur propension à réfléchir en termes de conquête plutôt que de fidélisation. En effet, d’une part c’est avant tout d’une logique paradigmatique que procède la théorie qui l’a engendré, puisqu’il s’agit une fois de plus pour la marque dotée d’un purpose de « se faire préférer » à ses concurrentes qui n’en ont pas. Il se situe donc d’emblée dans une perspective de choix auquel la marque confronte le public qu’elle vise, en tâchant par ce biais de le persuader de faire le « meilleur choix ». D’autre part, compte tenu de la valeur mobilisatrice qu’on lui accorde, en général sous couvert d’un prétendu désintéressement, il est évident que le purpose n’est rien d’autre qu’un nouvel outil de manipulation de masse qui vient s’ajouter à l’arsenal déjà bien fourni de ceux que le marketing a de longue date mis au point pour « passer contrat » avec ses publics. Or, soit dit en passant, ce qui est frappant aux yeux des observateurs de la vie des marchés, c’est qu’une telle utilisation de cette nouvelle « arme » dans l’arsenal guerrier des marketeurs se retourne paradoxalement contre les marques qu’ils sont pourtant censés gérer et défendre. Si une des deux principales fonctions des marques est, comme on l’a vu, d’une nature paradigmatique consistant à s’efforcer de créer de la différence au travers de l’établissement de leurs positionnements respectifs, alors l’adoption par la plupart d’entre elles du même genre de purpose, tourné vers le sauvetage de notre environnement naturel et la préservation de la planète, fait s’effondrer le paradigme et annule ces mêmes efforts pour conduire inexorablement à l’indifférenciation et à la perte de sens des marchés. C’est-à-dire exactement l’inverse de l’effet recherché. La déroute actuelle des marques et le désamour que les consommateurs semblent manifester vis-à-vis d’un nombre croissant d’entre elles tient donc en grande partie, selon nous, à cette hypertrophie de manipulations et de contrats à répétition que les marketeurs s’ingénient à proposer et accumuler sans cesse, apparemment persuadés que le cœur de leur métier se résume à faire et à multiplier les promesses et les engagements, quitte à énoncer les mêmes tous en chœur. L’engouement généralisé pour ce « must » dernier cri qu’est le brand purpose en est la manifestation la plus récente. |
|
|
2.2. Rétablir la valeur de la sanction Certes, si la porosité d’une marque aux modes et à l’air du temps fait partie de l’ensemble des conditions de sa pérennité, se contenter d’être dans le vent la conduirait à n’avoir « qu’un destin de feuille morte », pour reprendre une expression imagée que nous empruntons à Benoît Heilbrunn11. Aussi pensons-nous qu’au lieu de réfléchir à quel nouvel argument de vente « à la mode » il va pouvoir mettre en avant pour conquérir son client, lui « faire-acheter » ses produits ou services, il conviendrait bien davantage que le marketeur s’interroge sur l’être de l’être de la marque dont il a la responsabilité et la garde. Autrement dit, à l’heure de la prétendue « post-consommation », il nous semble urgent de passer d’une syntaxe de la manipulation à une syntaxe de la sanction, et de redonner au consommateur sa juste place, celle de Destinateur-judicateur et à la marque la sienne, celle de Sujet-opérateur. Il s’agit-là, ni plus ni moins, d’une petite révolution culturelle tant il est vrai que dans le marketing « old habits die hard ». |
11 B. Heilbrunn, « Identité de marque : entre cohérence et contradictions », https://www.bearingpoint.com /fr-fr/blogs/blog-cpg-retail- |
|
Participant pleinement de la dimension cognitive du récit, l’épisode de sanction comporte, comme chacun sait, trois séquences : i) l’information (sur l’action), ii) l’évaluation (la véridiction), et iii) la rétribution (positive ou négative) où le Sujet se voit attribuer par le Destinateur un « objet-message » qui lui signifie son identité de Sujet reconnu (ou à l’inverse, de traître confondu). Ainsi présentées, ces trois séquences semblent se succéder dans un ordre chronologique. Or, comme toujours en sémiotique, ce sont leurs rapports qui présentent un intérêt analytique. Et de même que la sanction présuppose l’action, de même la rétribution présuppose l’évaluation qui, elle-même, présuppose l’information. |
|
|
La question ultime concerne donc la nature de l’objet-message qui constitue la rétribution finale accordée par le Destinateur-consommateur au Sujet-marque. S’il résulte du faire cognitif exercé au cours de l’évaluation de l’information qui précède, il n’est cependant pas lui-même de nature cognitive, mais fiduciaire. C’est évidemment à la fidélité que nous pensons en tant qu’elle est la résultante d’une relation de confiance établie entre celui qui la donne et celui qui la reçoit. Rappelons que pour Floch, « les marques sont avant tout des fiducies ! Sinon comment comprendre qu’une marque puisse vous “décevoir”, vous “rassurer” ou vous “étonner” ? »12. Fiducie, confiance, fidélité : trois mots qui ont pour racine commune le latin fides, la foi ou la croyance. Or qu’est-ce qu’un consommateur fidèle si ce n’est quelqu’un qui accorde un certain crédit à la marque ? |
12 J.-M. Floch, « Logiques de persuasion du consommateur et logiques de fide?lisation du client », Comment parler au consommateur aujourd’hui et demain ? Paris, Institut de Recherches et d’Études Publicitaires, 1998, p. 46. |
|
Une fois établie la nature de l’objet-message communiqué lors de la rétribution, la question qui suit porte sur l’évaluation qu’elle présuppose. La séquence d’évaluation de l’épisode de sanction, en bonne orthodoxie sémiotique, consiste pour le Destinateur à exercer un faire interprétatif en vue de statuer sur l’être du Sujet (son identité), à partir de l’information qu’il délivre sur lui-même. C’est dire que d’un point de vue marketing, il ne s’agit plus pour la marque d’appâter, de faire des promesses ou de s’engager, mais de rappeler qui elle est. Ainsi, c’est à partir de ce même constat qu’au cours de ses nombreux travaux sur le phénomène des marques Floch en est venu à développer et à adapter le concept d’identité narrative proposé par le philosophe Paul Ricœur. Nous n’allons pas le reprendre ici dans son ensemble13. La seule des réflexions que nous retiendrons de lui est la suivante : Un client fidèle n’est pas une personne qui est satisfaite du bénéfice qu’elle attendait d’un produit ; c’est une personne confiante dans la marque parce qu’en fait elle crédite la marque d’une fidélité à elle-même. C’est en ces termes que le client conçoit, explicitement ou implicitement, l’instauration d’une relation durable avec sa marque.14 L’idée centrale que nous voulons souligner est celle de « fidélité à soi-même » et plus précisément celle de symétrie entre les deux fidélités en jeu : fidélité de l’un envers l’autre contre fidélité de l’autre envers soi-même. La sanction positive recherchée est obtenue dans la mesure où l’évaluation des termes échangés montre qu’ils sont équivalents. La relation intersubjective à laquelle elle donne lieu est donc bien de nature fiduciaire et les valeurs échangées ont effectivement la même valeur. Il s’ensuit que ce dont le Sujet-marque doit faire la démonstration face à son Destinateur-consommateur au cours de la séquence d’information qui « déclenche » l’épisode de sanction en amont et conduit à l’évaluation, c’est qu’il est « fidèle à lui-même » et qu’il est bien ce qu’il a toujours été. |
13 Le lecteur trouvera l’essentiel de cette théorie dans Identités visuelles, Paris, Presses Universitaires de France, 1995 ; en particulier dans le chapitre consacré à l’annonce Waterman, « Deux jumeaux si différents, si semblables », pp. 13-41. 14 « Logiques de persuasion… », op. cit., p. 46 (c’est nous qui soulignons). |
|
Si on accepte l’idée, défendue par Floch et nombre de sémioticiens à sa suite, que la marque est une parole et que ce sont ses prises de parole (verbales et non-verbales) qui portent son identité, alors il faut admettre que, comme une parole, la marque se reconnaît à une certaine façon d’articuler et une certaine façon de penser ; autrement dit, elle possède des constantes d’expression et des constantes de contenu qui lui assurent son identité. Si l’on considère ses constantes de contenu, la marque est une approche particulière du marché, une « vision du monde » différente des autres dès la conception du produit ou du service. De ce point de vue, le produit ou le service ne préexiste pas à la marque.15 C’est cette approche de l’identité que nous avons personnellement essayé d’illustrer au travers de l’analyse de l’offre de discours et de produits d’une marque comme MUJI16. Force est de reconnaître que présentée ainsi, une telle conception de l’identité peut amener à s’imaginer qu’elle est implicite et doit être « saisie » plutôt que « lue »17, ou bien qu’elle se situe à un niveau tellement « profond » que sa mise au jour suppose de faire appel aux compétences expertes de sémioticiens chevronnés pour la déceler dans les relations invariantes des formes de l’expression et du contenu des manifestations de la marque. Il n’en est rien et il existe, fort heureusement, des marques bien gérées qui savent parfaitement qui elles sont et l’expriment clairement. Illustrons ce point par un court exemple. |
15 Sémiotique, marketing et communication, op. cit., p. 75. 16 Voir ici même, « The value of emptiness ». Certains ont cru voir dans ce travail l’apologie béate et naïve de ce qui n’est qu’une stratégie manipulatoire de plus, mise au point par une marque retorse qui avance masquée sous les accoutrements du régime de l’ajustement pour mieux appâter bobos et autres gogos. Notre propos était évidemment tout autre, puisqu’il s’agissait pour nous d’une simple défense et illustration par l’exemple des apports de la socio-sémiotique et de ses modèles, tels que développés respectivement par Floch (sur l’identité) et par Landowski (sur les interactions). 17 Sur le distinguo entre « saisie » et « lecture », voir E. Landowski, Passions sans nom, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, pp. 94-96. |
|
2.3. « Hermès, artisan contemporain depuis 1837 » C’est en 2011 que la campagne publicitaire de la marque Hermès signa pour la première fois ses annonces avec ce slogan. C’est ce même slogan qu’on retrouve encore aujourd’hui sur le site internet de la marque, en tête de la rubrique « à propos d’Hermès », rubrique qui permet également de découvrir l’histoire de la marque à travers les grandes étapes qui ont marqué son déroulé18. Il n’est pas nécessaire d’en faire une lecture savante approfondie pour y déceler d’une part la catégorie modale de l’être (même si être un artisan présuppose aussi un faire, et même encore au-delà un savoir-faire !), et d’autre part, aussi bien l’orientation rétrospective que suppose l’expression de la fidélité à soi-même (ici aspectualisée selon la durativité), que la logique syntagmatique qu’une telle affirmation emprunte (surtout quand elle est illustrée, cette fois sous son aspect itératif, par le défilé des moments clés de l’historique de la maison). |
18 https://www.hermes.com/fr/fr/story/235001- |
|
La même année, Patrick Albaladejo, son Directeur Général Adjoint en charge de de la stratégie et de l’image, qui avait incidemment présidé à la mise au point de cette campagne et de son slogan, était invité par le magazine Clés, disparu depuis, à participer à une table ronde sur le thème du « sens de la marque ». La teneur de son exposé — en partie reproduit ci-dessous19 — fait largement écho à ce que nous venons de développer sur l’idée d’une revalorisation de la sanction (en lieu et place des sempiternels « contrats de marque ») et l’urgence qu’il y a, d’après nous, à mettre un terme aux stratégies qui ne peuvent aboutir qu’à « un destin de feuille morte », ballotée au gré de l’air du temps : En fait, ce sens profond de la marque, il perdure. Il est défini une fois pour toutes. Il ne s’accommode pas des circonstances. Il doit rester cette trajectoire qu’une maison, qu’une marque se fixe. Et parfois ce sens que l’on donne à son action est en résonance avec le marché, avec les attentes. Notons deux éléments qui nous paraissent importants : d’une part le désintérêt patent, l’indifférence affichée vis-à-vis des « attentes » du marché (au cours des années bling-bling) dont l’étude par d’autres marques qui, elles, s’y intéressent, les amène à imaginer des réponses circonstancielles ; ce sont en fait les « attentes » qui, in due course, après les années bling-bling, sont entrées en résonnance avec la marque, et non l’inverse. D’autre part, le refus de s’accommoder des circonstances, c’est-à-dire de jouer la carte de l’opportunisme qui se coule dans dans la facilité, la mode et les « tendances ». Chez Hermès, l’effort d’attention se porte essentiellement sur la marque et non sur le consommateur. |
19 Les propos rapportés sont le fruit de la retranscription personnelle d’un enregistrement vidéo de l’évènement qui fut un temps disponible sur le site internet du magazine Clés, malheureusement disparu em même temps que le titre de presse. |
|
Par ailleurs, et nous terminerons sur ce point, Patrick Albaladejo attire l’attention de son auditoire sur la valeur relative qu’une telle gestion de la marque engage à attribuer à la publicité, même si, par ailleurs, il vient de lancer la nouvelle campagne et son slogan devenu la signature institutionnelle de la maison : « Hermès, artisan contemporain depuis 1837 ». Il souligne le rôle central qu’y jouent les produits, à l’instar de Jean-Marie Floch qui pensait qu’une marque « parle » aussi à travers eux, car ils sont des objets de sens au même titre que la communication, et estimait qu’une sémiotique de la marque devrait « pouvoir rendre compte non seulement du discours sur les produits, mais aussi du discours des produits »20. Chez Hermès nous considérons que nos valeurs et le sens de notre action sont avant tout transmis par les objets. Pas par la publicité que nous faisons, pas par les actions que nous menons. C’est d’abord et avant tout l’objet qui doit traduire en permanence le sens de notre maison. Et ensuite il faut que toutes les actions que nous faisons soient dans une absolue cohérence par rapport au sens que nous voulons donner à notre maison. (…) Et avoir ce sens constamment présent à l’esprit dans toutes les décisions de façon à garantir une cohérence absolue, c’est quelque chose à quoi nous prêtons la plus grande attention. |
20 J.-M. Floch, « Logiques de persuasion… », op. cit., p. 42 ; pour une application, cf. ici même « The value of emptiness ». |
|
L’ère du « post-consumérisme » (si tant est qu’elle existe vraiment, mais c’est une autre question) incite non pas à repenser la marque et son fonctionnement, déjà profusément et précisément décrit par diverses disciplines, mais à en faire un usage plus réfléchi, plus « juste ». Elle invite à méditer et reméditer cette affirmation de Floch que nous citions déjà en commençant : « La marque naît d’une fiducie, d’une confiance donne?e et maintenue ; elle meurt par trahison ou de?ception ». C’est ce risque que le « post-consumérisme » fait peser actuellement sur de plus en plus de marques : leur survie semble parfois être en jeu. Le diagnostic et l’hypothèse que nous proposons consistent à resaisir toute la dimension cognitive de l’encadrement axiologique de l’algorithme narratif qui sous-tend l’ouvrage auquel sont attelés le marketing et le branding, et à rééquilibrer le métier, actuellement un peu bancal du fait de l’hypertrophie de la notion de contrat (et de manipulation), en redonnant tout son poids à la logique de la sanction. Plus précisément, il nous paraît nécessaire de redonner à la marque sa juste place de Sujet-opérateur, c’est-à-dire de cesser de lui accorder le statut d’instance transcendante, omnipotente et omnisciente que certains spécialistes sont tentés de lui accorder. Nous pensons ici à nombre de théories, un peu métaphoriques, que nous nous sommes abstenu d’évoquer, tant elles sont rebattues. Par exemple celle sur « la souveraineté de la marque » qui fait d’elle un potentat autoritaire, ou sur « le territoire de marque » où elle règne en monarque absolu, et bien d’autres encore qui vont jusqu’à ériger les marques en religions et leurs clients en adeptes ! Toutes ces théories abondent dans la foisonnante (et parfois délirante) littérature dont les rayons des librairies spécialisées en marketing management sont encombrés et où celle du why semble avoir aujourd’hui le vent en poupe. Symétriquement, il nous paraît également urgent de remettre les clients à leur juste place, celle de Destinateur-judicateur, parce que c’est eux qui in fine et de facto peuvent décider du destin d’une marque et s’ils le souhaitent, par exemple lassés par les déceptions successives qu’elle leur a causées, l’abandonner en lui tournant le dos, puis l’oublier et la laisser définitivement s’étioler pour finalement mourir d’inanition malgré le train de belles promesses qu’elle n’aura pas manqué de leur faire, même au cours de son agonie. |
|
|
Aussi pensons-nous que les marketeurs, les publicitaires et toute « la corporation de ces “persuadeurs” et même de ces manipulateurs par profession (...) que sont les spécialistes du management d’entreprise », comme les appelle Eric Landowski, ont intérêt à reconsidérer leurs pratiques, et à changer de point de vue sur la marque21. Car elle n’est pas qu’un levier de conquête des marchés, avides de promesses toujours nouvelles, elle est aussi, et nous serions tentés de dire surtout, un moyen sûr de bâtir et de consolider une clientèle fidèle, à la condition de rester fidèle à elle-même et d’en faire la démonstration tant par ses discours que par ses comportements (notamment par rapport aux tendances et à l’air du temps). La marque Hermès, mais ce n’est pas la seule, nous a semblée à ce titre exemplaire. Elle a su, entre autres choses, résister aux sirènes du brand purpose qui ont séduit tant d’états-majors d’entreprises et tant de marketeurs, aussi influençables que perméables aux dernières théories managériales en vogue, quelque fumeuses qu’elles soient. S’il est loin d’être certain qu’elle a fait appel à des sémioticiens, il est en revanche probable qu’elle pourraît être sensible à leurs approches et à leurs analyses, tant la culture du « sens de la marque » et de son identité paraît solidement ancrée dans cette maison. C’est pourquoi nous restons persuadés de la pertinence de l’intervention de la sémiotique et des disciplines du sens dans le champ professionnel, et en particulier dans le marketing qui, à l’heure du « post-consumérisme », semble en avoir plus que jamais besoin. |
21 E. Landowski, « De la stratégie, entre programmation et ajustement », avant-propos à Erik Bertin, Penser la stratégie dans le champ de la communication, Nouveaux Actes Sémiotiques, 89, 2003, p. 8. |
Ouvrages cités Elvinger, Francis, La Lutte entre l’industrie et le commerce. La marque, son lancement, sa vente, sa publicité, Paris, Librairie d’économie commerciale, 7e éd., 1935. Floch, Jean-Marie, Marketing, sémiotique et communication. Sous les signes les stratégies, Paris, Presses Universitaires de France, 1990. — Identités visuelles, Paris, Presses Universitaires de France, 1995. — « Logiques de persuasion du consommateur et logiques de fide?lisation du client », in Comment parler au consommateur aujourd’hui et demain ?, Paris, Institut d’Études et de Recherches Publicitaires, 1998. Heilbrunn, Benoît, « Identité de marque : entre cohérence et contradictions », https://www.bearingpoint.com/fr-fr/blogs/blog-cpg-retail-luxury/identité-de-marque-entre-cohérence-et-contradictions. Landowski, Eric , « Régimes de sens et formes d’éducation », intervention au colloque « Sémiotique et sciences humaines et sociales : la sémiotique face aux défis sociétaux du XXIe siècle », Limoges, 25-27 novembre 2015 (http://www.unilim.fr/colloquesemiodefisshs/wp-content/uploads/sites/16/2015/11/Educ.Landowski.28oct.pdf). — Passions sans nom, Paris, Presses Universitaires de France, 2004. — « De la stratégie, entre programmation et ajustement », avant-propos à Erik Bertin, Penser la stratégie dans le champ de la communication, Nouveaux Actes Sémiotiques, 89, 2003. Sinek, Simon, Start With Why : How great leaders inspire everyone to take action, New York, Portfolio, 2009. — Find Your Why : A Practical Guide for Discovering Purpose for You and Your Team, New York, Portfolio, 2017. |
|
1 Cf. « Régimes de sens et formes d’éducation », intervention au colloque « Sémiotique et sciences humaines et sociales : la sémiotique face aux défis sociétaux du XXIe siècle », Limoges, 25-27 novembre 2015 (http:/ /www.unilim.fr/colloquesemiodefisshs/wpcontent/uploads/sites/16/2015/11/Educ.Landowski.28oct.pdf). 2 J.-M. Floch, Marketing, sémiotique et communication : Sous les signes les stratégies, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p. 75. 3 Ibid. La référence au « mythe » renvoyait à une théorie dominante à l’époque, que Floch s’est d’ailleurs attaché à analyser dans ce même ouvrage, à propos de la marque Citroën (pp. 143-144). 4 Par Francis Elvinger, un des premiers publicitaires français, formé à l’« école américaine » de la communication. Paris, Librairie d’économie commerciale, (1926) 7e éd., 1935. 5 Deux expressions nées dans les années 1980, époque où eurent lieu de spectaculaires opérations de rachat qui montrèrent que la valeur d’une marque ne repose pas que sur son chiffre d’affaires. 6 Le benchmark consiste à « partir à la pêche aux bonnes idées » en pratiquant un exercice régulier de veille concurrentielle sectorielle, avec pour visée de s’inspirer des trouvailles ou tout simplement de les copier à son profit. 7 Voir en particulier Simon Sinek, Start With Why : How great leaders inspire everyone to take action, New York, Portfolio, 2009 ; Find Your Why : A Practical Guide for Discovering Purpose for You and Your Team, New York, Portfolio, 2017. 8 « Making the Earth a better place to live in » est devenu en quelques années le syntagme figé le plus usé (au sens littéral d’éculé) par de nombreuses grandes marques sur leurs sites internet institutionnels : de Danone à L’Oréal en passant par Starbucks, Ben & Jerry’s, Patagonia et cent autres. 9 Seules quelques-unes se risquent à faire l’exercice. Citons par exemple la marque de vêtements Balzac Paris qui sur son site n’hésite pas à avouer avoir conscience de travailler dans la deuxième industrie la plus polluante du monde (la mode) et l’assume avec le plus grand sens possible des responsabilités, en s’attaquant frontalement et de manière volontariste aux difficultés que représente l’objectif de « limiter les dégâts ». Cf. https://balzac-paris.fr/pages/edito-ecologie. 10 Sauf quand on s’appelle Greenpeace ou WWF (mais peut-on véritablement parler de « marques » dans le cas de ces deux organisations ?). 11 B. Heilbrunn, « Identité de marque : entre cohérence et contradictions », https://www.bearingpoint.com /fr-fr/blogs/blog-cpg-retail-luxury/identité-de-marque-entre-cohérence-et-contradictions. 12 J.-M. Floch, « Logiques de persuasion du consommateur et logiques de fide?lisation du client », Comment parler au consommateur aujourd’hui et demain ? Paris, Institut de Recherches et d’Études Publicitaires, 1998, p. 46. 13 Le lecteur trouvera l’essentiel de cette théorie dans Identités visuelles, Paris, Presses Universitaires de France, 1995 ; en particulier dans le chapitre consacré à l’annonce Waterman, « Deux jumeaux si différents, si semblables », pp. 13-41. 14 « Logiques de persuasion… », op. cit., p. 46 (c’est nous qui soulignons). 15 Sémiotique, marketing et communication, op. cit., p. 75. 16 Voir ici même, « The value of emptiness ». Certains ont cru voir dans ce travail l’apologie béate et naïve de ce qui n’est qu’une stratégie manipulatoire de plus, mise au point par une marque retorse qui avance masquée sous les accoutrements du régime de l’ajustement pour mieux appâter bobos et autres gogos. Notre propos était évidemment tout autre, puisqu’il s’agissait pour nous d’une simple défense et illustration par l’exemple des apports de la socio-sémiotique et de ses modèles, tels que développés respectivement par Floch (sur l’identité) et par Landowski (sur les interactions). 17 Sur le distinguo entre « saisie » et « lecture », voir E. Landowski, Passions sans nom, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, pp. 94-96. 18 https://www.hermes.com/fr/fr/story/235001-hermes-artisan-contemporain-depuis-1837 19 Les propos rapportés sont le fruit de la retranscription personnelle d’un enregistrement vidéo de l’évènement qui fut un temps disponible sur le site internet du magazine Clés, malheureusement disparu em même temps que le titre de presse. 20 J.-M. Floch, « Logiques de persuasion… », op. cit., p. 42 ; pour une application, cf. ici même « The value of emptiness ». 21 E. Landowski, « De la stratégie, entre programmation et ajustement », avant-propos à Erik Bertin, Penser la stratégie dans le champ de la communication, Nouveaux Actes Sémiotiques, 89, 2003, p. 8. |
|
______________ Mots clefs : conquête, contrat, fidélisation, marketing, marque, sanction, stratégie. Auteurs cités : Francis Elvinger, Jean-Marie Floch, Benoît Heilbrunn, Eric Landowski, Simon Sinek. Plan : 1.1. L’hypertrophie du contrat 1.2. Retour sur quelques fondamentaux 1.3. Conquête ou fidélisation : deux syntaxes distinctes 2. Dérives, paradoxes et apories 2.1. Le dernier mantra du branding post-consumériste |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |
|
Recebido em 23/11/2020. / Aceito em 25/09/2021. |