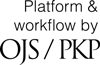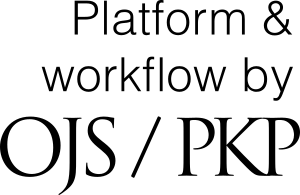Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
Forum-dossier : Quelques paradoxes du « post- » consumérisme
|
Dossier : « Post-» consumérisme Jean-Paul Petitimbert Publié en ligne le 22 décembre 2021
|
|
|
La pensée de la seconde moitié du XXe siècle semble dominée par le préfixe latin « post- » : le post-colonialisme, le post-modernisme, le post-structuralisme… et voici qu’à présent surgissent ici et là le post-consumérisme, la post-consommation et les post-consommateurs ! Même si le préfixe semble indiquer une forme de dépassement et de remplacement, tant au plan notionnel qu’au plan historique, force est de reconnaître que le concept demeure encore assez vague, sans qu’on sache précisément s’il signifie un changement complet de paradigme ou une simple inflexion sous forme de vaguelette. Entre tsunami et clapottis, la seule chose certaine, c’est qu’il est question de consommation et de la « société de consommation », bien sûr. Mais, de quoi s’agit-il au juste ? Une expression à la mode ? Une utopie, au même titre que « la société post-industrielle », abstraction inventée par la sociologie, sur laquelle personne ne s’accorde, et donc toujours aussi hypothétique ? L’expression désigne-t-elle un rééquilibrage, le passage (salutaire) d’une période excessive — boulimique ? — où régnait la surconsommation à une période plus sage de consommation raisonnable et raisonnée ? Ou bien encore cherche-t-on, par euphémisme, à adoucir le phénomène naissant et encore marginal de déconsommation, voire d’anti-consumérisme ? Il faut d’abord constater que le terme « consumérisme » est lui-même ambigu. Son sens premier, devenu désuet semble-t-il, renvoyait à l’origine à l’idée de défense du consommateur et de protection de ses intérêts par des associations qui s’étaient engagées dans ce combat. Remplacé aujourd’hui par un autre néologisme, la « consommaction », il a pris le sens que lui donnent les sociologues, celui qui désigne un mode de vie essentiellement axé sur une pratique intensive de la consommation de biens et de services, et caractérisé chez les individus par une tendance à acheter systématiquement les nouveaux produits que le marketing et la publicité ne cessent de leur proposer. Que la société de consommation traverse actuellement une zone de turbulences, personne ne peut en douter. Les diverses crises (économique, environnementale, sanitaire, migratoire…) que connaît le monde d’aujourd’hui ont un effet indéniable sur nos sociétés dites développées. Celles-ci entrent-elles pour autant dans une ère qu’on puisse qualifier de « post-consumériste » ? A l’heure où l’innovation, notamment technologique, n’a jamais été aussi florissante et aussi massivement, et rapidement, adoptée par des cohortes entières de la population, au point qu’en être tenu ou s’en tenir à l’écart peut, pour une minorité, constituer un sévère handicap social (l’« illectronisme »1), il semble légitime de se poser la question. Du point de vue de la compréhension de notre temps et des courants qui traversent le champ de la réflexion, elle ne manque donc pas d’intérêt. |
1 Aussi dénommé « illétrisme électronique », ce handicap touche soit la frange marginale de la population qui n’a financièrement pas accès aux technologies numériques, soit ceux qui, à cause de leur âge avancé ou tout simplement de leur tempéramment personnel, sont ce qu’il est convenu d’appeler des technophobes. |
|
D’un certain côté, l’usage répandu de l’expression ressemble à cette forme d’exorcisme symbolique qui, pour se rassurer face à ce qui a tendance à inquiéter, consiste à « mettre un nom » sur ce qu’on ne connaît pas ou dont on cerne mal les contours. D’un autre côté, il peut aussi parfaitement s’inscrire dans la pratique langagière aujourd’hui courante qui, pour donner à la banalité une façade plus reluisante, la rebaptise d’un nom à consonnance technocratique ou scientifique qui connote le « sérieux », un peu sur le modèle du « politiquement correct » dont le mécanisme aurait débordé du champ lexical qui lui était réservé (celui des « minorités socialement discriminées ») pour envahir l’ensemble des phénomènes observables et nommables. En quoi serait-il légitime pour la sémiotique se s’emparer du sujet ? Il y a, en tout premier lieu bien sûr, la question qu’on vient d’évoquer des rapports entre « le son et le sens », autrement dit tout le problème du « débroussaillage » du plan du contenu de l’expression. Mais bien au-delà (ou en deçà), il n’est pas inutile de rappeler que le gros des développements de la sémiotique standard s’est constitué à une époque où dominait l’idéologie de la « société de consommation » et où celle-ci battait son plein, entre les années soixante et soixante-dix, autrement dit pendant la période qu’on a appelée les « trente glorieuses ». Et ce n’est guère un hasard si toute la syntaxe narrative dite canonique s’enracine dans le principe de l’échange d’objets, à base d’opérations de jonction (d’attribution ou d’appropriation, de dépossession ou de privation, etc.), ainsi que dans une vision somme toute assez utilitariste de la valeur et une conception essentiellement contractuelle des relations entre sujets. Mutatis mutandis, au risque de choquer certains, on peut avancer qu’il y a comme un substrat « mercantiliste », fait de gains et de pertes, sous-jacent à la constitution du corpus de concepts de la théorie sémiotique classique2. C’est pourquoi les outils qu’elle a développés, notamment en matière de syntaxe narrative, sont particulièrement adéquats pour aborder l’analyse de ce nébuleux courant post-consumériste qui ébranle soi-disant le système marchand. |
2 Cf. E. Landowski, « Logiques de la valeur », Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004, pp. 69-76. Id., « Politiques de la sémiotique », Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 13, 2, 2019. |
|
N’oublions pas non plus que si la sémiotique a pu s’étendre à d’autres disciplines que la seule littérature et acquérir les lettres de noblesse qui lui permettent d’aborder un tel sujet aujourd’hui, c’est en très grande partie grâce aux travaux de Jean-Marie Floch et de ses émules qui en ont « exporté » les méthodes dans l’univers marchand : dans le milieu des études de marché d’abord, puis ceux de la publicité et du design. Il est justement l’auteur d’une « axiologie de la consommation » qui a beaucoup contribué à sa notoriété bien sûr, mais aussi, et surtout, à la diffusion de la sémiotique en dehors du seul domaine réservé de la recherche académique3. A diverses occasions4, il s’était d’ailleurs exprimé sur ce qui, dans les années quatre-vingt-dix, aurait pu déjà porter l’étiquette de post-consumérisme et qu’on se contentait de désigner à cette époque-là, plus modestement sans doute et plus poétiquement peut-être, comme une « panne du désir » chez les consommateurs. |
3 Cf. J.-M. Floch, Marketing, sémiotique et communication. Sous les signes les stratégies, Paris, P.U.F., 1990, pp. 119-145. 4 Par exemple au cours des journées d’études qui étaient fréquemment organisées par l’Institut de Recherches et d’Études Publicitaires de Paris (I.R.E.P.). |
|
Mais la sémiotique non-littéraire ne s’est pas arrêtée aux seules analyses de Floch et à la sémiotique narrative standard avec laquelle il travaillait. La socio-sémiotique de son côté, Eric Landowski en tête, tâchait de la dépasser et de proposer une syntaxe complémentaire à celle de la jonction, à partir de la problématique des interactions actantielles, débouchant sur le méta-modèle des divers régimes qu’il n’est plus besoin de présenter tant il est aujourd’hui solidement établi : manipulation, programmation, assentiment (à l’accident) et ajustement. Aussi, le présent dossier sera-t-il bigarré, non seulement du fait de la diversité des thèmes traités par les auteurs : dispositifs publicitaires (C. Alfeld Rodrigues), stratégies d’entreprises (P. Cervelli), stratégies consommatoires et réponses commerciales (J.B. Ciaco), offres d’expériences de consommation (A. Perusset), de la lexicographie à l’idéologie (G. Ceriani), positions actantielles des marques et de leurs publics (votre serviteur) ; mais aussi du fait des approches privilégiées par chacun : narrative, interactionnelle, discursive, axiologique, etc. Leur point commun est à l’évidence que les mécanismes à l’œuvre dans le post-consumérisme qu’ils prennent pour objet d’analyse sont loin d’être réductibles à des causes seulement économiques, mais sont avant tout des phénomènes sémiotiques, touchant à la construction du sens et des valeurs. |
|
1 Aussi dénommé « illétrisme électronique », ce handicap touche soit la frange marginale de la population qui n’a financièrement pas accès aux technologies numériques, soit ceux qui, à cause de leur âge avancé ou tout simplement de leur tempéramment personnel, sont ce qu’il est convenu d’appeler des technophobes. 2 Cf. E. Landowski, « Logiques de la valeur », Passions sans nom, Paris, P.U.F., 2004, pp. 69-76. Id., « Politiques de la sémiotique », Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 13, 2, 2019. 3 Cf. J.-M. Floch, Marketing, sémiotique et communication. Sous les signes les stratégies, Paris, P.U.F., 1990, pp. 119-145. 4 Par exemple au cours des journées d’études qui étaient fréquemment organisées par l’Institut de Recherches et d’Études Publicitaires de Paris (I.R.E.P.). |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |