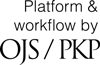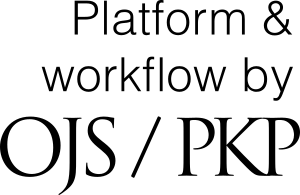Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
La présence perdue
|
Critique sémiotique de Massimo Leone Publié en ligne le 4 mars 2021
|
|
La pandémie de l’année 2020 a radicalement transformé de nombreuses activités humaines. Exerçant un impact sans précédent sur les croyances, les émotions et les actions, elle a bouleversé des communautés, ébranlé des institutions et modifié des styles de vie. Le monde numérique n’a pas été exclu de ces changements. Au contraire, à bien des égards, il en a été le centre. Déjà avant la pandémie, une partie importante de la vie humaine avait sa représentation, son reflet ou sa contrepartie dans le monde numérique, mais de nombreux comportements et activités se situaient encore de manière prioritaire en dehors de la sphère numérique, comme les fêtes, les voyages, ou les cérémonies, même si seuls très peu d’entre eux ne laissaient aucune trace dans la sphère numérique et, surtout, dans les réseaux sociaux. Il ne suffisait pas de souffler les bougies d’un gâteau d’anniversaire, d’explorer les temples d’Angkor Wat ou d’être témoin à un mariage, il était aussi de plus en plus socialement significatif d’associer ces expériences de la vie non-numérique à une sorte d’empreinte, souvent déformée, généralement auto-glorifiante, dans l’univers numérique. Ce besoin social était si impérieux que la relation de cause à effet, ainsi que l’équilibre des priorités esthétiques qu’elle impliquait, avaient commencé à basculer : les fêtes, les voyages et les cérémonies devaient être organisés de manière à préprogrammer la possibilité d’en laisser un impact numérique approprié dans les réseaux sociaux. Lorsque ce réarrangement n’était pas possible (parce que la fête était trop triste, parce qu’il y avait trop de monde à Angkor Wat, ou parce que le marié n’était pas si beau), alors diverses méthodes populaires et répandues venaient à l’aide, les « filtres » numériques étant parmi les plus courantes et prêtes à l’emploi. Il suffisait d’ajouter un peu de lumière à la scène des bougies sur le gâteau d’anniversaire, d’effacer numériquement les autres touristes de l’entrée du temple, ou de rajeunir le visage du marié pour produire, sur les réseaux sociaux, des simulacres numériques qui amélioraient la qualité souhaitée des tranches de vie représentées, promettant ainsi un avantage social, en termes de statut et de sympathie, pour les protagonistes du matériel affiché. 1. Critique des pratiques générales du numérique 1.1. De la dépendance numérique à la sensibilisation numérique La grande majorité des utilisateurs des réseaux sociaux ont été passionnés par ces pratiques esthétiques, avec plus ou moins de talent pour créer un sentiment de distinction sociale numérique. Certains ont été extrêmement habiles à améliorer la représentation numérique de leurs vies sans donner l’impression de le faire, ou du moins sans donner l’impression d’en faire trop, tandis que d’autres, moins habiles, tombaient irrémédiablement dans le piège du kitsch. Dans les deux cas, l’effet final dépendait d’une combinaison de facteurs et, surtout, de la mise en correspondance ou, au contraire, de la désadaptation entre le style numérique de l’auteur des « post » et le goût numérique de leur public, sachant que dans l’arène bariolée des réseaux sociaux on est toujours un peu kitch pour quelqu’un d’autre. Le degré zéro du kitsch, d’ailleurs, n’y existe pas vraiment, en dépit des efforts pathétiques de ceux qui déclarent régulièrement qu’ils vont « abandonner Facebook car il n’est plus ce qu’il était », quitte à y réapparaître quelques semaines plus tard, ou de ceux qui proclament leur intention « d’éviter tout narcissisme sur Facebook » tout en excluant comiquement de la gamme du narcissisme la publication redondante de photos de leurs enfants à l’aspect pas particulièrement exceptionnel... ou encore de ceux qui emploient du temps et de l’énergie à fabriquer des « post » sophistiqués (coins de maison mignons et une quantité affreuse de selfies avec animaux sauvages ou au bord de précipices, etc.) qui disparaissent ensuite en quelques secondes de l’attention de leurs lecteurs. Il est impossible d’être présent dans les réseaux sociaux, d’y produire des avatars et des simulacres, et d’y atteindre simultanément le degré zéro du kitsch, car ces plateformes numériques sont un océan qui dévore tout, avale tout, mâche tout, et crache tout, transformant chaque contenu par le fait même qu’il a été placé dans un cadre numérique, exerçant une puissance de mise en forme irrésistible. Rester loin des réseaux sociaux n’est pas une solution non plus étant donné que les moindres actes de chacun se trouvent inévitablement traduits, quoique de manière indirecte, par quelque sorte de représentation numérique. A l’ère de Facebook, publier un livre sans aucune annonce dans le web (par l’auteur, la maison d’édition, la librairie) demande un effort énorme, une stratégie de réticence que, suite à Wikileaks, même les services secrets ne peuvent plus se permettre. La gamme des stratégies rhétoriques et des styles esthétiques dans Facebook est apparemment ample, depuis ceux qui prétendent que « d’habitude je ne poste rien, en raison de mon humilité, mais voici tout de même la couverture de mon nouveau livre », jusqu’à ceux qui affichent des images d’eux-mêmes pendant qu’ils écrivent un livre, lorsqu’ils en lisent les épreuves, lors de la préparation de la couverture, et ainsi de suite, avec un post à chaque présentation de livre, à chaque fois que le livre est mentionné dans un journal, etc. L’ensemble de ces stratégies confirme la dépendance de la vie non-numérique vis-à-vis de la vie numérique et l’incapacité de la première à subsister sans être affectée par la seconde, dont l’hypertrophie a désormais atteint presque tous les aspects de l’existence, de la naissance à la mort et même au-delà. 1.2. L’hypertrophie numérique pendant le confinement Qu’est-il arrivé à cette hypertrophie avec la pandémie de 2020 ? Comme il fallait s’y attendre, la situation sans précédent d’une grande partie de la population mondiale confinée à domicile par la loi a eu des conséquences également sur la relation entre le monde de l’expérience physique et son homologue numérique. Lorsque des conditions techniques appropriées étaient disponibles, toutes les activités impliquant une interaction humaine qui pouvaient être numérisées ont été numérisées, avec pour conséquence une re-numérisation des pratiques qui étaient déjà partiellement ou totalement dans la sphère numérique. Les différents cas peuvent être disposés dans une matrice combinatoire. Les relations qui n’impliquaient aucun contact numérique dans la vie pré-pandémique ont dû être numérisées en partie ou complètement ou bien elles ont dû être abandonnées. En Italie, aller à la pizzeria du coin était une activité non-numérique, du moins dans l’interaction entre le propriétaire et le client. Pendant la pandémie, seule la livraison est devenue licite, et aussi numérisée que possible, ce qui signifie que la numérisation a permis une interaction fluide entre le propriétaire et le client via un intermédiaire, le « rider », service d’intermédiation numérique qui était déjà disponible avant la pandémie mais s’est considérablement développé depuis. Dans ce cas, cependant, ce qui était partiellement numérisé n’était pas l’expérience elle-même de manger une pizza mais celle de l’acheter physiquement dans une pizzeria ou celle de la consommer sur place. Il est pléonastique de rappeler qu’avec la pandémie, seules les activités humaines liées aux sens dont les stimuli pouvaient être assez facilement numérisés purent subir un tel processus. L’expérience d’entrer dans une parfumerie et d’y renifler divers échantillons, par exemple, ne pouvait pas être numérisée et dut s’arrêter jusqu’à la fin du confinement, pour redémarrer, avec d’innombrables précautions, après le confinement. De même, l’expérience humaine de se trouver immergé dans l’eau chaude d’un spa avec une multitude d’autres êtres humains dut être interrompue, et dans ce cas aussi elle n’a été reprise qu’à un stade ultérieur, avec des protocoles rigides de stérilisation. D’autres expériences, impliquant pour la plupart la proprioception et le sentiment parfois enivrant de se retrouver coincé au milieu d’une foule, ont été complètement arrêtées et n’ont jamais pu être reprises : faire partie d’une vague humaine géante dans un stade lors d’un match de football ; recevoir le corps d’un chanteur de rock sautant sur le public depuis la scène lors d’un concert ; frotter son corps contre ceux de dizaines d’étrangers dans un club bondé — toutes ces activités sont devenues impossibles et illégales dans de nombreuses sociétés, et personne ne sait si et quand elles seront à nouveau autorisées ; probablement, elles ne le seront jamais tant qu’une vaccination ne sera pas disponible et largement mise en œuvre, et ne reprendront probablement pas de la manière habituelle. La seule exception dans cette catégorie de comportements est représentée par des types de multitudes humaines qui prennent forme illégalement, ou aux frontières de la légalité, comme dans les nombreux affrontements entre manifestants et forces de police qui se sont produits dans le monde pendant la pandémie, bien que très rarement lorsque la pandémie était à son apogée ; dans ces circonstances également, cependant, la plupart des manifestants portaient des masques médicaux, à l’exception des manifestants « négationnistes » protestant contre les masques eux-mêmes (bien que certaines situations paradoxales se soient également produites, avec des manifestants masqués manifestant contre les masques). 1.3. Le traumatisme subreptice de l’enseignement en ligne Le changement des comportements humains et même des habitudes a été très généralement vécu comme pénible ; pour certains, l’impossibilité de sentir son corps « emporté par la foule » a été traumatisant, du moins pour ceux qui considéraient ces expériences comme essentielles dans leur vie sensorielle et émotionnelle. Le changement a été si radical qu’il était impossible de ne pas le remarquer. Il était évident pour tout le monde que la rencontre avec des milliers d’autres danseurs à un concert de rock n’était plus possible. Dans d’autres cas, cependant, le changement a été plus subtil mais aussi plus subreptice ; on a eu l’impression de pouvoir continuer à faire ce qu’on faisait avant la pandémie, car une infrastructure et un protocole de numérisation étaient déjà en place, quitte à se rendre vite compte que la version numérique de l’activité auparavant partiellement ou même totalement incarnée n’était pas exactement la même. L’enseignement a été certainement un exemple important dans cette catégorie. Avant la pandémie, des formes de didactique en ligne ou mixte existaient déjà. De nombreuses universités pouvaient déjà s’appuyer sur des plateformes numériques pour faciliter la transmission des contenus des enseignants aux étudiants, et le passage des retours didactiques dans les deux sens. Il y avait même des universités dont la totalité de l’enseignement était constituée par la fourniture de contenus en ligne, même si elles conservaient encore une forme d’interaction en face à face (les universités en ligne continuaient à donner des cours particuliers et dans certains cas à examiner les étudiants en présence). Dans les universités traditionnelles, cependant, l’enseignement reposait principalement sur l’activité séculaire de l’enseignant qui allait dans une salle de classe, y trouvait des étudiants, et leur enseignait. Ainsi, même dans les universités qui pouvaient déjà s’appuyer sur des plateformes, des réseaux, des logiciels et des protocoles d’enseignement en ligne, l’interruption soudaine et forcée de toute forme d’interaction en face à face a été une sorte de choc. Non seulement l’enseignement, mais aussi les heures de bureau, les activités de laboratoire, les séminaires, les examens, les diplômes, les discussions de thèse de doctorat, jusqu’aux concours d’embauche de nouveaux professeurs ont dû soudainement passer à la version en ligne. Inévitablement, le changement a été accompagné par une attitude récalcitrante, résistante, et même hostile de la part de beaucoup, surtout lorsque la réintroduction prudente de certains enseignements en présentiel est devenue une question de choix, impliquant inévitablement des options personnelles en termes de risque mais aussi en termes d’idéologie de l’éducation. La plupart des réactions au changement étaient néanmoins émotionnelles, compte tenu de la situation de stress grave dans laquelle elles avaient pris forme. Les enseignants, les élèves, et les parents ont approuvé ou critiqué, accepté ou résisté, toléré ou combattu, selon leur humeur personnelle et, souvent, sans un examen approfondi de ce qui était réellement en train de changer. Le fait que l’enseignement soit, du moins apparemment, principalement fondé sur les sens, assez facilement numérisables, de la vue et de l’ouïe a conduit à la négligence générale d’autres aspects sémiotiques de l’expérience didactique moins visiblement modifiés par le changement. Si on avait adopté une idéologie de l’enseignement comme le simple transfert de notions de l’enseignant à l’élève, la version en ligne aurait pu être vécue comme satisfaisante ; il n’est pas surprenant que, parmi ceux qui partageaient cette idéologie, les plaintes se soient concentrées avant tout sur des questions de transmission, telles que la rapidité de débit du réseau, la fiabilité des plateformes ou la possibilité de contrôler les étudiants lors des examens. 1.4. L’urgence d’une considération sémiotique Mais en l’occurrence une compréhension simplement linguistique (voire « multimodale ») du phénomène ne suffit pas. Si on se concentre uniquement sur les aspects verbaux de l’enseignement, ou d’ailleurs sur ceux qui sont liés uniquement à l’ouïe et à la vue, alors la numérisation est susceptible d’être considérée comme une question purement technique et non comme une question profondément anthropologique. Une perspective sémiotique, au contraire, de façon intrinsèque prend en compte des aspects de la pratique d’enseignement qui impliquent d’autres sens et dimensions, dont l’altération lors de la digitalisation imposée par la pandémie a été plus clandestine ; mais il n’est pas à exclure que cela puisse avoir un impact durable et profond sur l’expérience existentielle d’être un enseignant, d’être un étudiant. Considérer attentivement la sémiotique de l’enseignement en ligne signifie encourager l’évaluation rationnelle d’un tel impact, au-delà de tout excès émotionnel et idéologique dans l’observation, la stigmatisation ou, au contraire, la minimisation des conséquences du confinement anti-pandémique sur les modalités par lesquelles la culture et les connaissances sont transmises de génération en génération. Pour la première fois probablement dans l’histoire, pendant une période de plusieurs mois (et qui pourrait se prolonger bien davantage), la transmission institutionnelle d’information non-génétique entre les générations a été entièrement déléguée à la communication en ligne, sans aucune sorte d’interaction en face à face. Une analyse sémiotique de ce phénomène sans précédent vise à éviter au moins partiellement l’excès idéologique consistant à vanter les vieilles traditions d’enseignement ou à les dénigrer selon des réflexes idéologiques automatiques. Quelles sont donc les principales caractéristiques de l’enseignement exclusivement en ligne ? 2. La spatialité comme condition fondamentale de l’enseignement 2.1. La centralité sémiotique de l’espace dans l’enseignement Tout d’abord, l’enseignement en ligne implique une sémiotique de l’espace qui est très différente par rapport à celle de l’enseignement traditionnel. Diverses formes d’enseignement à distance ont existé dans l’histoire ; on pourrait en fait suggérer que le début de la possibilité d’enseigner et de recevoir un enseignement sans aucune interaction face à face coïncide avec le début de l’écriture ; l’invention de cette technique et l’opportunité extraordinaire de retranscrire à travers une forme graphique le son et le sens d’une voix vivante impliquaient aussi la possibilité de transmettre le contenu d’un enseignement loin dans l’espace et le temps. Plus récemment, de nombreux médias modernes, du service postal à la radio, ont élargi le spectre de l’enseignement à distance, avec diverses formes d’institutionnalisation, depuis les cours d’enseignement supérieur radiophoniques des années 1950 jusqu’aux universités en ligne actuelles. Cependant, toutes ces modalités d’enseignement et d’apprentissage à distance ont toujours été considérées comme complémentaires et, à vrai dire, secondaires par rapport à un cadre plus traditionnel impliquant la présence d’un ou plusieurs enseignants, d’un ou plusieurs élèves, partageant le même temps et le même espace. Ces deux éléments, qui sont en réalité deux dimensions, temporelle et spatiale, doivent toujours être pris en compte lorsqu’on parle des effets sémiotiques de l’enseignement en ligne et, plus généralement, de la digitalisation de toute activité. Il est faux de dire, en effet, que la numérisation fonctionne à son meilleur avec deux des cinq sens, la vue et l’ouïe, tandis qu’elle fonctionne encore, mais imparfaitement en ce qui concerne le toucher et l’odorat, et plus du tout avec le goût, tout en restant par ailleurs toujours en difficulté avec la proprioception. Ce n’est là qu’une partie de la vérité. Le cadre de la réflexion devrait effectivement inclure aussi le temps et l’espace. La numérisation modifie profondément les dimensions temporelles et spatiales dans lesquelles les activités humaines se déroulent habituellement. Dans le cas de l’enseignement, le fait que l’enseignant et l’élève partagent le même espace n’est pas seulement accessoire. Au contraire, l’espace constitue un élément sémiotique inévitable et essentiel dans la construction du contexte communicatif de l’enseignement, ainsi que des conditions de son énonciation. L’espace (de même, on le verra, que le temps de l’enseignement) peut difficilement être pensé en termes purement abstraits. Quand on dit qu’un enseignant partage le même espace physique qu’un élève, ces deux partenaires ne sont pas imaginés dans le vide mais dans un lieu, c’est-à-dire entourés d’un espace matériel. L’enseignement peut prendre place dans divers types de « lieux », et l’histoire a enregistré de nombreuses variations dans la matérialisation physique de l’espace abstrait d’enseignement dans des lieux spécifiques : de la rue à la place, des couvents aux jungles. Mais aujourd’hui, dans les pays technologiquement avancés, la plupart imagineront sans doute l’enseignement comme inextricablement lié à l’idée et au concept d’une salle de classe. Pour ma part, en tant que professeur, si j’imagine l’enseignement, je tends à me voir en train d’enseigner dans une salle de classe, bien que ma première leçon universitaire ait en réalité eu lieu dans une salle de cinéma, à Sienne, et qu’il me soit parfois arrivé d’enseigner dans des lieux alternatifs : des bois aux montagnes, des prisons aux hôpitaux. Une salle de classe, cependant, ne doit pas être conçue exclusivement comme un espace physique, doté de son mobilier stéréotypé. Encore une fois, la plupart des individus contemporains meubleraient probablement leur classe imaginaire avec une chaire et un tableau noir, des rangées de tables et de chaises ou de pupitres. Ils imagineraient la salle de classe comme une pièce bien éclairée et carrée, avec quelques objets fonctionnels accrochés aux murs, ou bien comme un vaste amphithéâtre. Cela n’a pas vraiment d’importance. D’un point de vue sémiotique, la phénoménologie spatiale d’une scène d’enseignement n’est constituée ni par la forme ou la taille de la salle ni par la qualité et la quantité des meubles s’y trouvant ni par la technologie pédagogique disponible, des vieux tableaux noirs aux projecteurs les plus modernes. Rien de tout cela n’est indispensable. Bien entendu, un enseignant peut être attaché à certains de ces éléments et envisager de mieux enseigner si la salle de classe a une certaine forme et une certaine taille ; si le mobilier est d’un certain type ; si une certaine technologie est disponible. J’aime moi-même donner mes cours dans une petite salle de classe avec des meubles essentiels et un tableau noir traditionnel. Pourtant, encore une fois, en examinant la question en profondeur, tout cela n’est pas du tout essentiel. La dimension spatiale de la salle de classe n’est pas construite sémiotiquement et ne fonctionne pas essentiellement sur la base de ces éléments. Une salle de classe est faite de regards. L’espace d’enseignement se compose à partir de parcours de regard. Cela pourrait être dit de manière plus abstraite, pour tenir compte du fait que la spatialité de l’enseignement peut prendre forme même en l’absence de regards scopiques, par exemple dans le cas d’un cours pour étudiants aveugles. En effet, ce qui est fondamental dans ces regards qui construisent la sémiologie de la spatialité de l’enseignement n’est pas réellement la vue : les yeux de l’enseignant, ainsi que les yeux des élèves, ne sont que l’incarnation d’un principe plus abstrait sous-tendant le fonctionnement des regards constructeurs d’espace, ce principe étant en fait la directionnalité. La directionnalité est l’élément clé derrière la constitution du lieu où se déroule l’enseignement. Une salle de classe n’est en réalité rien d’autre que l’incarnation physique, à travers une série de figures (chaises, tables, tableaux, etc.), d’un réseau de vectorialités. Les figures pourraient bien changer (les étudiants assis sur le sol, les enseignants debout sur un bureau comme dans le film La Société des poètes disparus, des rétroprojecteurs au lieu de tableaux noirs, etc.), mais la structure de directionnalités orientées que ces figures manifestent doit être présente. Bref, et essentiellement, la spatialité de l’enseignement est constituée par le fait qu’un esprit humain ou, généralement, plusieurs, se dirigent à travers leurs corps, et donc aussi à travers leurs sens de l’ouïe et de la vue, vers une source commune de connaissances. L’espace d’enseignement résulte d’une convergence physique d’attentions incarnées. Dans le réseau des regards — un réseau de directivités qui n’est en fin de compte qu’un réseau d’attentions incarnées — regards qui composent la spatialité de l’enseignement, une asymétrie spatiale abstraite subsiste, même lorsque l’enseignant est silencieux, même quand il n’a pas encore parlé ou a fini de le faire ; de plus, le réseau subsiste même lorsque l’enseignant n’est plus là, lorsque les élèves sont sortis ; lorsqu’on entre dans une salle de classe universitaire vide, on a souvent l’impression que les mots potentiels de l’enseignement persistent dans l’air vide, on a le sentiment que la tension du désir de savoir qui sous-tend le réseau de l’enseignement est toujours là, vibrant dans l’espace de la classe, même lorsqu’elle est vide. Par ailleurs, comme c’est souvent le cas avec la fonctionnalité, ici aussi elle se transforme fréquemment en terrain de relation sémiotique : le parapluie est bien un objet dont la morphologie résulte de la nécessité de se protéger des agents dangereux tombant du haut à cause de la force de gravité (pluie, neige, grêlons, mais tomates dans des concerts ratés ou avec des publics hostiles, dont la rage remplace la force de gravité), pourtant cette morphologie se transforme alors en signifiant (ou en representamen, dirait Peirce) de la fonction qui est à son origine : un parapluie devient un signe de la nécessité de se protéger de quelque chose (au point que la superstition dans le sud de l’Italie voit les parapluies laissés ouverts à la maison comme un mauvais présage, le signe d’un mal à venir contre lequel on est censé se protéger moyennant un parapluie). De même, la salle de classe existe en tant que lieu parce que sa morphologie a évolué dans le temps pour être spatialement et sensoriellement adaptée à la constitution effective de ce réseau de directionnalités orientées qu’est finalement l’espace d’enseignement ; pourtant, dans la culture où elle a pris sa forme, cette morphologie devient un signe de sa fonction ; dès qu’on pénètre dans un espace aménagé en lieu d’enseignement, en salle de classe, on a le sentiment que c’est un lieu d’enseignement, que cet espace doit être un espace où des esprits, à travers des corps, se dirigent vers d’autre esprits afin de permettre la transmission systématique de connaissances, le passage d’une culture de génération en génération, la constitution de la mémoire non-génétique de l’humanité. 2.3. La spatialité de la classe en tant que matrice de rôles éducatifs Mais il y a plus. Ce n’est pas seulement qu’en entrant dans une salle de classe, on a l’impression que l’enseignement et l’apprentissage s’y déroulent. En y entrant, on a aussi le sentiment que soi-même on fera partie de ce réseau de directivités orientées, de ce lieu de regards qui établissent la spatialité de l’enseignement. Cela n’arrive pas seulement aux étudiants, mais aussi aux enseignants. En tant qu’étudiants, en franchissant le seuil de la salle de classe — seuil symbolique mais aussi physiquement et architecturalement matériel, qui sépare la salle de classe du monde extérieur, du couloir par exemple — on entre dans un espace mais aussi dans un lieu, c’est-à-dire dans un espace physiquement et sémiotiquement agencé de manière à favoriser la transformation des corps en corps apprenants, en corps qui s’orienteront pour faciliter le passage des informations du corps de l’enseignant vers eux. De la même manière, en passant le même seuil, l’enseignant voit son personnage complètement changé : il n’est plus un individu, il devient un enseignant. On pourrait suggérer qu’un enseignant en est toujours un, même en dehors de la classe et qu’une salle de classe n’est pas nécessaire pour que quelqu’un devienne et agisse comme un enseignant ; cela semble évident dans la déformation professionnelle, assez fréquente, qui fait que les enseignants parlent en tant que tels même lorsqu’ils sont entre amis, sur un ton de conférence parfois ennuyeux. Mais si cette déformation professionnelle existe, de même le ton ennuyeux qui en résulte, c’est parce qu’ils ont tous deux pris forme par l’enseignement et qu’ils ont été créés précisément dans le cadre de ce réseau orienté de directionnalités qu’est la spatialité de l’enseignement. En d’autres termes, il est vrai qu’on peut être enseignant en dehors de la classe, et que souvent on l’est même malgré soi, mais l’assurance professionnelle de l’enseignant est aussi une conséquence de la spatialité dans laquelle elle a été créée. 2.4. La classe comme lieu sacré L’idée que ce réseau de directionnalités orientées, cette structure asymétrique d’attention puisse avoir lieu en dehors d’un lieu est une sorte de rêve idéaliste ; il implique le préjugé d’une parole qui puisse devenir enseignement, éducation, mémoire, et finalement culture, tout en restant totalement immatérielle. Cela semble reproduire, dans le domaine de l’éducation, le vieux rêve d’un sacré qui resterait tel sans entretenir aucun rapport avec un lieu précis. Mais y-a-t-il un sacré sans lieu sacré ? Dans les cultures religieuses qui nous sont les plus proches, ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de sacralité catholique sans espace catholique sacré, sans lieux catholiques. Mais c’est aussi vrai pour le protestantisme, qui a su purger de la religion chrétienne les idées de relique, de sainteté, d’icône, mais pas celle de lieu. Les protestants ont aussi leurs temples. Il est impossible d’exclure l’idée que la manière dont de nombreuses cultures ont imaginé l’espace du sacré — comme essentiellement et inextricablement lié à la possibilité de circonscrire certains lieux, à la possibilité de séparer le lieu du sacré de l’espace profane — a profondément influencé la manière dont les mêmes cultures ont imaginé et créé la spatialité de l’enseignement. On pourrait même suggérer que les deux tendances, une certaine manière d’imaginer le sacré comme inséparable d’un espace circonscrit, d’un lieu sacré, et une certaine manière d’imaginer l’enseignement comme se déroulant (à la fois physiquement et conceptuellement) dans une salle de classe ne sont en fait que deux manifestations d’une même dynamique profondément ancrée dans l’anthropologie humaine, dont l’une des fonctions et des résultats les plus fondamentaux serait la possibilité de conférer un rôle spatial à des êtres humains désignés. Il est vrai que le prêtre n’est pas nécessairement celui qui peut accéder à l’espace sacré, mais le fait qu’il puisse le faire est essentiellement lié à sa transformation en un personnage qui n’est plus simplement un individu mais quelqu’un qui incarne une fonction. Voilà pourquoi il faudrait peut-être suggérer que l’existence d’un seuil (et un seuil est souvent normatif, c’est une ligne symbolique mais aussi une spatiale qu’on ne peut franchir que dans des circonstances spécifiques) est en réalité fondamentale pour la création de ce réseau de directionnalités orientées, de cette structure d’attention qu’est l’enseignement. L’enseignement a besoin d’une salle de classe, mais la salle de classe a besoin d’un seuil, d’une ligne plus ou moins matérielle marquant le début et la fin du cercle de l’enseignement, ou tout au moins le périmètre au-delà duquel un enseignant ne cesse pas, bien sûr, de l’être (parce que cela ne serait pas possible), mais cesse d’agir comme tel. La porte de la classe qui se ferme avant le début de la leçon est comme les lignes qui délimitent le terrain de football. Pour pouvoir jouer, il faut que ces lignes soient là. Afin que l’enseignement ait bon jeu, à la Gregory Bateson, avec ses rôles appropriés d’enseignant et d’élève, la porte de la classe doit être fermée. Cela n’est pas incompatible avec les idéologies prônant la démocratisation de l’enseignement. Et, simultanément, souligner l’importance de cette porte fermée n’est pas nécessairement conservateur non plus. Les voix qui, en particulier à partir de la seconde moitié du XXe siècle, ont proclamé la nécessité idéologique d’ouvrir la salle de classe au monde extérieur et ont promu l’abolition de toutes les lignes circonscrivant son emplacement (une tendance parallèle s’est manifestée dans les religions), ont profondément mal interprété les idées d’ouverture et de démocratisation ; elles étaient, en effet, des voix idéologiquement nuisibles ; elles proposaient d’ouvrir un lieu en le dissolvant. Mais avoir accès à un désert n’affranchit pas du tout ; prôner la démocratisation de la spatialité de l’enseignement ne doit pas signifier supprimer la porte ou les murs de la classe ; c’est une manière très simpliste et, en fait, démagogique d’éluder le problème. Au contraire, une éducation démocratique implique la construction d’une salle de classe assez grande pour laisser entrer tout le monde. Dissoudre le périmètre symbolique de l’éducation, qui est aussi un périmètre architectural, dans l’illusion d’un espace d’enseignement qui ne devienne jamais un lieu, qui s’étende à toute la spatialité concevable du monde, signifie diluer ce réseau de directionnalités orientées, cette structure d’attention qui est constitutive à la fois de l’enseignement et de l’apprentissage. L’éducation a besoin de salles de classe tout comme la religion a besoin de temples parce que la fonction de transmission de la culture d’une génération à l’autre, la transformation de l’information en nouvelles connaissances, et de ces connaissances en culture est aussi délicate et sacrée que la fonction du prêtre. La spatialité matérielle de la salle de classe est essentielle pour soutenir symboliquement la formation délicate du rôle de l’enseignant tout comme la spatialité matérielle du temple l’est pour soutenir symboliquement la constitution non moins fragile d’un rôle qui est plus qu’un personnage, et en fait plus qu’un individu. Car, de même que le rôle de médiateur religieux est de relier deux dimensions par ailleurs séparées et mutuellement intouchables, celle de la transcendance et celle de l’immanence, de même le rôle de l’enseignant est de présider au passage, également transcendantal, de la culture de génération en génération. L’enseignement est le sacerdoce d’une telle transcendance. Et la salle de classe est son temple. 3. Un temple numérique pour l’enseignement ? 3.1. L’intentio auctoris des lieux d’enseignement en ligne Mais qu’en est-il de la possibilité d’un temple numérique de l’enseignement, de l’apprentissage et de l’éducation ? Un tel temple des chiffres peut-il réellement fonctionner ? Et si ce n’est pas le cas, quelles sont les raisons profondes d’un tel échec ? Dire que l’enseignement en ligne n’a pas de spatialité serait inexact. Rien n’est dépourvu de spatialité, pas même le temps, comme l’indique la physique contemporaine. La spatialité de l’enseignement en ligne est évidemment différente de celle de l’interaction en face à face entre enseignant(s) et élève(s) : pure trivialité tant qu’on n’entreprend pas d’analyser cette spatialité en profondeur dans toutes ses composantes. Tout d’abord, l’enseignement en ligne comporte lui aussi un espace physique. Enseignants et étudiants ne se connectent pas à partir d’un vide mais depuis un espace matériel qui est inévitablement meublé d’une série de figures, chacune conférant une nuance sémiotique particulière à l’espace lui-même, le transformant ainsi en lieu doté d’une personnalité, avec un rôle spatial et parfois même actoriel (selon la terminologie de Greimas). Dans la plupart des cas, en particulier pendant la pandémie, le lieu physique des enseignants et des élèves a été un espace privé, généralement leurs propres domiciles. Ici, la célèbre distinction formulée par Umberto Eco entre trois types d’intentio (ou intentionnalité signifiante) est fort utile. Cet espace physique domestique de connexion est chargé, d’abord, d’une intentio auctoris, c’est-à-dire du sens que « l’auteur » de l’espace lui-même veut lui attribuer pour qu’il soit reçu par son public potentiel et ensuite par ses observateurs réels. C’est là une première différence importante avec l’espace de la salle de classe, lieu créé lui aussi, d’une certaine manière, mais dont l’auteur est pour l’essentiel impersonnel et collectif. La forme et le mobilier de la salle de classe sont déterminés par des réglementations nationales et locales, des règles administratives, des besoins et des initiatives bureaucratiques plus ou moins conformes à une certaine « mode » dans le public et, en particulier, dans l’architecture scolaire. Pour qui a un œil exercé, il ne sera pas très difficile, en entrant dans une salle de classe pour la première fois, de déterminer avec un certain degré de précision à quelle époque et à quel style elle appartient. Les souvenirs personnels et, par conséquent, l’imaginaire de la salle de classe sont probablement façonnés autour du script visuel et architectural caractérisant une salle de classe à une certaine époque (chaises de bois plus ou moins fatiguées et bureaux en résine mélamine-formaldéhyde sont probablement centraux dans l’imaginaire de classe de ceux qui y sont entrés pour la première fois dans les années 1970). Ensuite, ce lieu d’enseignement et d’apprentissage mis en forme par une mode publique, institutionnelle, bureaucratique, et architecturale est au moins partiellement modifié par les comportements et surtout par les « pratiques d’écriture » des utilisateurs, ce qui pourrait être vu, suivant Michel de Certeau, comme infléchissant l’espace public par des touches personnelles. Il faut cependant dire, en quelque sorte en ligne avec de Certeau, que ces infléchissements n’échappent jamais complètement à la mode (les graffitis sur les tables de classe, et même les chewing-gums collés par en-dessous suivent des tendances de mode spécifiques bien que pour la plupart inconscientes, évoluant au fil du temps). Les vêtements des élèves accrochés aux murs, leurs livres et cahiers, leurs stylos et crayons, ainsi que leurs propres corps, complètent le mobilier visuel de la salle de classe, qui pourtant résulte toujours d’une instance collective, jamais personnelle. Cela est prouvé de manière spectaculaire chaque fois qu’une réglementation publique pour l’organisation de la salle de classe est contredite par une initiative personnelle ou corporative. Un exemple typique, en Italie, est la décision périodique de telle ou telle personne de retirer le crucifix ou l’image du président de la République des murs d’une salle de classe, où ils doivent obligatoirement figurer selon la loi. L’espace physique de l’enseignement et de l’apprentissage en ligne est au contraire, par définition composé de deux lieux distincts, celui de l’enseignant et celui — ou plutôt ceux — des élèves, l’un et l’autre agencé selon une intentio auctoris majoritairement privée. Lorsque la caméra web est allumée, montrant partiellement l’arrière-plan derrière l’enseignant ou l’élève, ce qu’on peut voir est généralement un lieu non pas public et collectif mais privé et personnel. La mode s’y insinue comme toujours, avec ses diverses tactiques de distinction, y compris la distinction de l’indistinction ostentatoire. Mais c’est une mode assez permissive, qui n’est pas filtrée par les réglementations étatiques et les règles administratives mais interprétée selon une logique multiforme obéissant à une gamme beaucoup plus large de facteurs sociologiques et en particulier socio-économiques. Alors que la salle de classe est l’espace de la classe, où tous partagent le même lieu avec le même niveau de distinction esthétique et, donc, socio-économique, l’espace, ou plutôt les nombreux lieux d’enseignement en ligne constituent un espace de classe, dans le sens de catégorisation et classement socio-économiques et de pouvoir. Bien sûr, il y a des classes plus riches et plus pauvres, avec des meubles plus vétustes ou plus récents, une technologie plus ou moins avancée, de la papeterie plus sophistiquée ou plus banale, des gens plus ou moins bien habillés, mais tous ceux qui partagent physiquement l’espace de la salle de classe sont confrontés au même lieu, entourés par lui, et chacun est invité à le considérer non pas comme son propre espace éducatif individuel mais comme l’espace éducatif d’un groupe, d’une petite communauté rattachée à la communauté sociétale plus large qui a été déterminante dans la formation de ce lieu d’apprentissage lui-même. Cet effet de communauté sémiotique de la classe a été considéré si important que, dans certaines circonstances — par exemple dans les classes italiennes à plusieurs époques historiques —, un tablier a été imposé aux enfants (et à leurs familles) afin que leurs vêtements individuels ne nuisent pas, avec leur inévitable zest de distinction, à l’homogénéité de classe dans la classe. Lorsque cette classe physique homogène est fragmentée et diversifiée en de nombreux lieux physiques hétérogènes de connexion, ceux-ci deviennent immédiatement et inévitablement autant d’objets d’interprétation et, potentiellement, de distraction. Un élève peut certes « interpréter » l’espace de la salle de classe en y entrant pour la première fois, mais au fil des heures, des jours et des semaines, cet espace cesse d’être un objet d’interprétation porteur de nouvelles sémiosis et se transforme en un arrière-plan neutre, banalisé, qui devient l’incarnation spatiale, sensorielle et visuelle de sa fonction. Ce processus se comprend mieux par comparaison, encore une fois, avec une église. En entrant pour la première fois dans une église catholique, l’attention pourrait bien être attirée par la nouveauté du lieu, de sa morphologie, de ses aménagements plastiques, de ses meubles et de ses personnages ; pourtant, messe après messe dans la même église, tout cela aussi se transforme inévitablement en un espace banalisé ; même l’église la plus somptueuse, même la basilique Saint-Pierre au Vatican, devient le lieu de sa fonction, non plus un objet à interpréter à travers une nouvelle chaîne d’interprétants, mais une habitude, le contenant spatial d’une cérémonie. Au contraire, lorsque l’espace physique de la classe est fragmenté en ses homologues en ligne, on n’est jamais entièrement sûr du type de contexte susceptible d’apparaître en arrière-plan de l’interlocuteur. Cela devient matière à interprétation et, par conséquent, également l’objet d’une gamme de stratégies de communication et d’effets de sens. Il a été curieux de voir, lors du confinement et de la multiplication des activités en ligne qui s’ensuivit, combien d’enseignants, et parfois même d’étudiants, ont choisi de se placer devant la webcam avec un fond d’étagères emplies de livres. La nouvelle habitude esthétique s’est rapidement transformée en tendance de mode, puis en cliché et, avec la vitesse frénétique habituelle du web, en objet d’ironie sous la forme de memes. Le cliché, comme d’habitude, a également donné lieu à un anti-cliché qui, bien que plus sophistiqué dans ses intentions, s’est à son tour facilement transformé en une autre tendance de mode « outsider », contre-culturelle (ou plutôt contre-classe), puis en nouveau cliché ; les jeunes chercheurs qui ne possédaient pas une grande bibliothèque, ou qui en possédaient une mais adoptaient un style de distinction « outsider », se sont mis à délivrer de manière ostentatoire des conférences et des leçons depuis leur cuisine, le chauffe-eau apparaissant dans leur dos comme une sorte de clin d’œil bobo. En tout cas, le passage de l’habitude spatiale publique et collective à la représentation spatiale privée et personnelle réintroduit, dans la spatialité de l’enseignement en ligne et de sa sémiotique, une dynamique de classe, dans le sens de classement socio-économique. De nombreux professeurs avaient la possibilité d’enseigner à partir de leurs bureaux privés, visuellement et acoustiquement bien isolés du reste de la maison, à l’abri des intrusions potentielles des membres de leur famille et en particulier des enfants. Occasionnellement, certains de ces enfants, ou des chats, fervents et austères, passaient élégamment devant la caméra, mais c’était l’exception, comme un signe de distinction supplémentaire, encore plus sophistiqué, sachant que le bureau d’un « savant » ne peut aller sans un chat et un minimum de chaos, bien sûr contrôlé et toujours « artistique ». Le chaos menaçant l’espace de connexion en ligne des enseignants ou étudiants moins aisés, avec des familles plus nombreuses et plus bruyantes, était en revanche d’un genre totalement différent : un chaos impossible à apprivoiser, menaçant ou compromettant sans cesse l’audition et la concentration du locuteur autant que de ses interlocuteurs, impossible en tout cas à prendre pour un signe volontaire de distinction mais immédiatement vécu, au contraire, comme une nuisance. 3.2. L’intentio lectoris des lieux d’enseignement en ligne Même pour ceux qui disposaient d’une bibliothèque à montrer en arrière-plan ou qui pouvaient transformer son absence en signe de distinction style bobo, le résultat sémiotique — l’effet de sens — de la disposition des lieux dans l’interaction n’était jamais sûr. La théorie de l’interprétation d’Eco est claire à ce sujet : l’intentio auctoris, la visée de sens de l’auteur ne coïncide pas toujours avec l’intentio lectoris, c’est-à-dire la façon dont le destinataire finit par s’approprier le sens attaché à un message par son destinateur. Par exemple, les bibliothèques des professeurs snobs qui cherchaient à afficher grâce à elles leur distinction et leur haute culture pouvaient être lues comme de pures marques d’arrogance ; de même, les jeunes chercheurs affichant le chic du va-comme-je-te-pousse pouvaient être perçus comme de simples malappris. De plus, dans cette communication particulière, un degré zéro de l’arrière-plan n’était pas possible ; certaines plateformes de visioconférence offraient la possibilité de transformer son arrière-plan en une image floue, voire de le remplacer par un scénario tropical, mais dans les deux cas il n’y avait aucun moyen d’éviter d’être perçu comme quelqu’un dont l’image d’arrière-plan réelle aurait quelque chose d’inapproprié, quelque chose à cacher. De même, éteindre sa caméra n’était une option acceptable que si elle était accompagné de l’excuse que la connexion était déficiente. Certes il pouvait arriver que ce soit effectivement le cas. Surtout au début du confinement, les enseignants, les étudiants et les responsables des établissements scolaires pouvaient rêver de mettre en place une sorte de nouveau panoptique dans lequel tous les professeurs et tous les élèves pourraient effectivement être visibles les uns aux autres et se regarder comme s’ils se trouvaient dans l’espace physique d’une salle de classe, avec pour seules limites les inévitables angles des caméras. Mais on s’est vite rendu compte qu’un tel panoptique était un rêve illusoire de numérisation pré-pandémique ; le débit de la connexion était dans la plupart des cas insuffisant pour permettre aux gens de montrer l’image en mouvement de leur visage ; la plupart ont été surpris par le confinement avec une connaissance plus que limitée ou nulle des outils de vidéoconférence et d’enseignement en ligne ; ils se sont en outre souvent trouvés dans des endroits sans connexion ou avec une connexion insuffisante. La première lacune a été traitée à la hâte par des cours d’introduction intensifs, souvent complétés par des conseils fébrilement recueillis auprès de parents, amis ou collègues plus experts ; mais la seconde était beaucoup plus difficile à combler car il a été difficile et, dans de nombreux cas, très coûteux d’organiser une connexion Internet par fibre. Une nouvelle différence de classe est donc apparue dans la classe numérique, où on s’est mis très vite à redouter les individus à connexion lente, avec leur vidéo fragmentaire, leur voix intermittente et leurs messages de plus en plus associés à de mauvaises conditions de livraison. Corrélativement, un nouveau type de bluff a commencé à avoir lieu, dans lequel il était très facile d’éviter de montrer son visage en vidéo, ou même de parler, ou de sauter une réunion entière, avec l’excuse que « la connexion Internet est mauvaise aujourd’hui ». 3.3. L’intentio operis des lieux d’enseignement en ligne La sémiotique souligne ensuite que l’échange de sens n’implique pas seulement une intentio auctoris et une intentio lectoris mais aussi une intentio operis, à savoir le sens qui se dégage de la structure même du message compte tenu de la communauté d’interprètes où il circule. Il est évident que quelle que soit la manière dont les enseignants et les étudiants peuvent organiser l’espace physique de leur interlocution virtuelle, quel que soit le contexte qu’ils choisissent et la stratégie qu’ils pourraient adopter, ils ne peuvent rien contre une limite intrinsèque de l’intentio operis de l’enseignement en ligne : le domicile personnel n’est pas une école ; le bureau privé d’un professeur n’est pas une université ; la cuisine d’un étudiant n’est pas une salle de classe. Or, quelle que soit la façon dont la rhétorique de la rencontre virtuelle entre l’enseignant et l’élève cherche à souligner sa normalité, quels que soient les efforts ou les astuces visant à faire comme s’il n’y avait pas de rupture par rapport à l’interaction en classe en face à face, il est impossible que pendant la pandémie les enseignants et les élèves oublient qu’ils sont en ligne depuis leur domicile parce qu’un virus pernicieux les empêche de se retrouver là où ils étaient censés le faire, c’est-à-dire dans un lieu désigné, à cet endroit que l’histoire, la culture, et surtout le résultat de leur sédimentation, c’est-à-dire une communauté d’interprètes, détermine comme l’espace où l’éducation doit réellement s’accomplir : à savoir dans le seul lieu où les individus puissent être transfigurés en enseignants et étudiants, où ils peuvent se rencontrer non pas en tant qu’individus avec leurs bibliothèques et leurs cuisines, leurs chats, leurs enfants et leurs conjoints mais en tant qu’acteurs sociaux — en tant qu’incarnations de macro-fonctions culturelles, en tant que destinateurs et destinataires dans un processus narratif intégrant plusieurs générations dans le processus de transmission de la mémoire non-génétique de l’humanité à travers le temps. La cuisine d’un étudiant et le bureau privé d’un savant ont certes des portes, mais franchir ces portes ne comporte pas le rituel d’efficacité symbolique qui est nécessaire pour faire fonctionner la transformation d’une personne en un enseignant, d’un individu en un élève. Il se peut qu’en ligne un enseignant soit, ou plutôt reste un enseignant, mais en ce cas ce ne peut être qu’en vertu de la mémoire de ce qu’il était dans le monde physique, avant la pandémie, quand il entrait dans la classe et se trouvait transfiguré en une incarnation de la fonction de l’enseignement. Avec le temps, et si l’impossibilité de revenir à l’enseignement présentiel persistait, une telle mémoire pourrait devenir de plus en plus ténue, s’estomper progressivement, jusqu’à n’être plus qu’une relique culturelle, jusqu’à ce qu’elle soit évacuée de la communauté d’interprètes et de leur sémiosphère. 4. Temporalité et actorialité d’un vivre ensemble 4.1. La temporalité partagée de l’enseignement Ainsi donc, la transfiguration des individus en enseignants et élèves est garantie par la présence d’un espace physique socio-culturel dans lequel une telle transfiguration est censée s’opérer à la fois littéralement et métaphoriquement. Mais elle est aussi garantie par le fait que la matérialité d’un tel espace implique que le rituel de franchissement du seuil, la pénétration symbolique au-delà de la porte de la salle de classe, prend du temps : pour les élèves comme pour les enseignants, le rituel s’accomplit et ne peut s’accomplir que dans une temporalité partagée. Une salle de classe, en effet, n’est pas seulement une spatialité participative pour la transmission culturelle ; c’est aussi une temporalité partagée pour la construction de la mémoire intergénérationnelle. En entrant dans le même temple symbolique au même moment, les enseignants et les étudiants respectent une loi non-écrite selon laquelle une communauté ne reconstruit pas toute sa sémiosphère ex-novo à chaque génération mais s’insère au moins partiellement dans la sémiosphère transmise par les époques précédentes. Bien que de plus en plus sophistiquée, la spatialité virtuelle de l’enseignement en ligne ne fournit pas aux participants une expérience liminale efficace. Malgré la prolifération des dénominations métaphoriques cherchant à masquer la différence entre spatialité réelle et spatialité virtuelle de l’enseignement, entrer dans une « salle virtuelle » n’implique pas la même sémiotique que l’entrée dans une salle de classe. On peut évidemment souligner, comme cela se produit actuellement dans de nombreux cours universitaires virtuels à travers le monde, que « les enseignants et les étudiants » pénètrent dans l’espace virtuel de l’éducation pour partager une leçon ; en réalité, quelle que soit la force de cette rhétorique de la liminalité virtuelle, les enseignants et les étudiants continueront à être incarnés et auront le sentiment irrésistible que leur vraie personnalité, ainsi que leur esprit, ne vont en réalité nulle part, à travers aucun seuil, dans aucun espace partagé, mais restent exactement là où ils sont, dans l’espace privé, personnel et idiosyncratique de leur bureau ou de leur cuisine, partagé avec personne d’autre, sauf ceux (conjoints, enfants, animaux de compagnie) qui se trouvent là par inadvertance alors qu’ils devraient être ailleurs. Certains des moments les plus gênants que les plateformes de visioconférence ont connu ces derniers mois, notamment dans les situations d’enseignement et d’apprentissage, ont précisément été liminaires. 4.1.1. Une proxémique maladroite Dans le monde non-numérique, la distance corporelle globalement adoptée comme défense contre la propagation du virus a partout radicalement modifié la proxémique humaine ; l’un de ces changements est particulièrement frappant : Dans la plupart des proxémiques éducatives, l’entrée de l’enseignant dans l’espace symbolique partagé de la classe était marquée par des signes. Dans les circonstances les plus formelles, les étudiants se levaient, reconnaissant l’arrivée non de l’individu mais de l’acteur social qu’il personnifiait, exactement de la même manière que l’arrivée du prêtre, l’autorité religieuse, est saluée lorsqu’il entre dans l’espace sacré de l’église. Mais même dans les proxémiques éducatives les plus démocratisées, voire démagogiques, une forme de salutation marquait le début de l’interlocution entre enseignants et élèves. Sur les plateformes numériques de visio-conférence, au contraire, on peut toujours entrer dans la « salle virtuelle » en tant qu’avatar privé, invisible et non entendu par quiconque jusqu’à ce qu’on décide d’activer la caméra et le microphone. Le résultat est que même l’espace virtuel partagé de la classe en ligne peut être « privatisé » à volonté à tout moment ; à tout moment, l’avatar peut se transformer en fantôme et être là sans y être réellement. Qui plus est, toute absence sera toujours par définition excusable, en tant qu’imputable à tel ou tel problème technique. 4.1.2. Stratégies de distraction Tout enseignant, ainsi que tout étudiant, a eu l’expérience d’une leçon ennuyeuse pendant laquelle l’esprit de l’étudiant à un moment donné quitte cognitivement la salle de classe et commence à vagabonder ailleurs, à l’extérieur, dans un autre monde imaginaire, où des choses plus intéressantes se produisent. L’histoire de la spatialité éducative pourrait d’ailleurs être écrite en considérant les opportunités de distraction offertes aux étudiants de chaque culture et génération. Les novices d’un couvent ne pouvaient laisser échapper leur esprit qu’en secret, puisque même la position de leur corps était strictement réglementée, de sorte que détourner le regard du livre n’était pas permis ou était même puni. Dans les écoles modernes, les possibilités de distraction ont augmenté à travers les deux voies de fuite caractéristiquement offertes aux étudiants : les toilettes et la fenêtre. Pour échapper à une leçon ennuyeuse ou à un examen imminent, l’étudiant pouvait soit simuler un besoin pressant, soit regarder par la fenêtre (ou encore s’amuser du spectacle offert par les autres étudiants). L’introduction des téléphones portables et autres appareils de communication numérique à distance a considérablement multiplié la gamme des échappatoires possibles : tout enseignant, depuis les années 2000, a eu à lutter pour retenir l’attention d’élèves qui, à tout instant, pouvaient plonger dans leurs smartphones. Pourtant, la distraction avait encore une limite, déterminée par le corps même des étudiants. Ils regardaient leurs smartphones, mais ils étaient toujours physiquement là, dans l’espace éducatif partagé de la classe. Avec la pandémie, la salle de classe étant devenue virtuelle, la fenêtre numérique à travers laquelle les étudiants peuvent désormais échapper à la salle de classe est devenue presque aussi grande que la salle de classe elle-même ; elle a, en fait, remplacé la salle de classe. Si bien que le rapport entre concentration et distraction a été inversé. Désormais, une leçon virtuelle est un arrière-plan en ligne sur lequel on peut revenir de temps en temps lorsqu’on s’ennuie des d’autres activités virtuelles. Les deux dimensions, en outre, celle de la concentration sur la leçon et celle de la distraction, se brouillent de plus en plus ; dans le passé, les élèves pouvaient dessiner des images amusantes de l’enseignant, mais le risque d’être pris et puni était encore très élevé ; maintenant, pendant la pandémie, ils peuvent post-produire sur place en direct une leçon numérique en y ajoutant des effets spéciaux amusants que l’enseignant ne verra jamais ; jamais auparavant il n’a été plus facile de parodier les enseignants et l’enseignement. Les leçons en ligne risquent constamment de se transformer en intermittences amusantes dans un flux continu de divertissement et de jeux virtuels. Face à cette perspective tragi-comique, sinon même tout simplement tragique, de nombreux enseignants ont déjà renoncé à l’illusion de la spatialité virtuelle partagée de l’éducation et ont plutôt opté pour un enseignement asynchrone ; si les étudiants quittent maintenant la salle de classe à leur guise, proposer des cours enregistrés au lieu de cours en direct les incitera peut-être à revenir vers les cours, du moins à l’approche de la période des examens. 4.1.3. Les dangers de l’asynchronicité L’éducation en ligne asynchrone met cependant en danger un aspect de l’expérience didactique qui a été également mis en péril dans le passage de la classe réelle à la classe virtuelle. Les enseignants se plaignent souvent lorsqu’ils ont trop d’élèves. Cela implique en effet beaucoup de travail en termes d’examens, de discussions, de remise de diplômes, etc. Pourtant, tout en se plaignant du nombre excessif, les enseignants en sont aussi, généralement, fiers, surtout si leurs cours ne sont pas obligatoires mais librement choisis ; et ils se sentent au contraire mal à l’aise quand le nombre de leurs élèves diminue trop. Ils rêvent d’Oxford, où ils s’imaginent des professeurs assis dans leurs bureaux avec une demi-douzaine de disciples, mais ils ne sont pas satisfaits lorsqu’une salle de classe semble trop vide. S’il en est ainsi, c’est parce que l’enseignement n’a certes pas besoin de la spatio-temporalité, de la matérialité et de la proprioception d’une foule : l’enseignement adressé aux foules a toujours eu quelque chose de suspect, quelque chose qui ressemble plus à l’endoctrinement qu’à l’enseignement, plus à un comice politique ou à un sermon religieux qu’à une leçon. De fait, l’enseignement s’adresse par nature à des esprits individuels, non à des esprits qui auraient tendance à se perdre dans l’indistinction d’une identité collective. Cependant, si l’enseignement n’est pas pour les foules, il n’est pas non plus pour les individus ; l’enseignant n’enseigne pas à des personnes uniques, du moins pas dans le cadre habituel de l’éducation contemporaine. L’enseignement et l’apprentissage individuels appartiennent principalement à des époques passées, où les enseignants étaient des tuteurs pour les héritiers de familles aisées. Il est vrai que c’est une situation qui tend à se reproduire périodiquement, lorsque les inégalités socio-économiques (et aujourd’hui aussi technologiques) distinguent à nouveau des apprenants individuels privilégiés face à une majorité de la population sans accès à l’éducation. Dans l’école démocratique, cependant, comme dans l’université démocratique, si les professeurs n’enseignent pas à la foule, ils n’enseignent pas non plus aux individus — ils enseignent à des groupes humains particuliers qui portent le nom spécifique de « classes ». Combien d’élèves devrait-il alors y avoir dans une classe ? Il n’est pas possible de le définir, mais certainement pas les 5.000 individus que, par exemple, Facebook fixe comme limite au nombre d’« amis » qu’on est autorisé à avoir dans ce réseau social ; le nombre idéal d’une classe, en effet, est celui qui permet une coordination spatio-temporelle, physique, et proprioceptive raisonnable au sein de la micro-communauté constituée par l’enseignant et les étudiants. Les cours qui ont lieu dans deux espaces séparés, l’un avec la conférence proprement dite, et l’autre avec une vidéo-projection en direct de la première sur grand écran, créent déjà une inégalité inacceptable entre les privilégiés qui peuvent voir les enseignants en chair et en os et ceux qui ne le peuvent pas. Mais la visibilité de l’enseignant par les élèves ne détermine pas à elle seule la taille idéale d’une classe. C’est aussi l’inverse. S’il est important que l’enseignant puisse voir ses élèves, il l’est tout autant qu’il ne les considère pas simplement comme des individus, mais comme des membres d’une classe. Qu’est-ce que la classe, en effet, si ce n’est un groupe où chacun est censé apprendre en tant qu’individu, en tant qu’esprit individuel, tout en se trouvant placé en condition de le faire en coordination avec d’autres étudiants ? Le fait regrettable qu’avant la pandémie il y ait eu des universités qui pour des raisons économiques étaient obligées d’entasser dans les salles de cours un nombre excessif d’étudiants n’exclut pas qu’à l’autre extrême, l’inverse, c’est-à-dire un enseignement individuel, soit également à éviter. Si de toute évidence l’enseignement traditionnel implique généralement une interaction en face à face, cette dynamique ne devrait jamais se limiter à la relation entre le visage individuel de l’enseignant et celui de l’élève à qui il s’adresse. Pour les enseignants, c’est d’ailleurs une expérience commune que de voir les visages des élèves non pas en tant que visages individuels mais comme une entité mystérieuse, collective en même temps que composée d’individus — une sorte d’hydre (bienveillante). Il serait inapproprié, pour un enseignant, de regarder le visage d’un élève en particulier pendant une leçon entière, car cela impliquerait immédiatement que ce visage a été isolé de la classe et transformé en objet privilégié d’observation, en altérant ipso facto la relation visuelle et interactive avec le reste de la classe. Même lorsqu’un élève se distingue du groupe, par exemple en posant une question, mieux vaut (et c’est ce qui est généralement conseillé) ne pas répondre en s’adressant uniquement au visage de la personne qui a posé la question, mais plutôt partir de là pour ensuite balayer d’un regard plus englobant le reste de la classe. 4.2. Apprendre à vivre ensemble Tout ce qui précède découle du fait que les individus d’une classe apprennent mieux que les individus seuls ; ou du moins, ils apprennent différemment. La différence est le résultat de la spatio-temporalité particulière qui est créée par la matérialité de la salle de classe, elle-même liée à certaines conditions d’espace et de temps. A la vérité, en temps normal, sans la menace d’un virus, il n’est pas bien difficile de donner naissance à une salle de classe et d’y faire la classe : cela ne requiert qu’un temps limité de réunion, un espace limité de réunion, un enseignant, un groupe d’étudiants, et une règle conversationnelle essentielle, selon laquelle l’enseignant doit pouvoir exercer un contrôle prédominant sur la prise de parole dans la classe. Bien sûr, comme c’est de plus en plus à la mode surtout aux États-Unis, les étudiants peuvent participer et fournir eux-mêmes la parole de la leçon ; pourtant, si l’enseignant était incapable d’au moins encadrer de telles contributions, l’idée même de la leçon commencerait à s’effondrer et l’exercice relèverait alors d’une catégorie de discours différente, celle de la discussion entre étudiants. D’autres conditions sont accessoires mais tout de même importantes pour co-déterminer le résultat final de la classe. L’enseignant est généralement autorisé à se lever et se déplacer à l’intérieur de la classe, tandis que les étudiants ne le sont généralement pas ; une scène de classe au cours de laquelle l’enseignant serait tranquillement assis et parlerait alors que ses élèves se promèneraient tout autour serait pour le moins inhabituel ; elle donnerait l’impression que la hiérarchie discursive essentielle de la classe, qui est incarnée, symbolisée et ritualisée notamment par le contrôle des mouvements du corps, a été bouleversée. Bien sûr, certains pourraient rêver, comme il a été fait, d’une classe où les élèves parlent et les professeurs écoutent, où les premiers se déplacent et les seconds restent immobiles, le tout produisant une subversion complète de la sémiotique habituelle de l’éducation ; mais ces légitimes utopies de subversion seraient inconcevables et en fait insignifiantes si elles ne faisaient contraste précisément avec la norme qu’elles contredisent. Il s’agit donc là de provocations bienvenues, prônant plus de liberté et d’égalité dans l’éducation, mais qui déboucheraient probablement sur un chaos insupportable et surtout non-fonctionnel si elles étaient adoptées comme normes paradoxales (et anarchiques). De même, le théâtre expérimental qui lutte pour la suppression du « quatrième mur » et voudrait abolir toute séparation entre les acteurs et les spectateurs est un signe avant-coureur d’une liberté créative qui ne peut fonctionner comme telle qu’en contraste avec le théâtre traditionnel. 4.3. L’effroyable silence de l’enseignement en ligne Un espace et un temps limités produisant à la fois un cadre spatio-temporel, un individu incarnant le rôle de l’enseignant, un groupe d’individus incarnant le rôle des élèves, des règles déterminant la constitution du discours verbal et non-verbal dans la salle de classe : ce sont là des éléments simples mais essentiels pour donner naissance à cet effet de communauté d’apprentissage sur lequel reposent l’éducation et l’enseignement. Certains de ces éléments peuvent être traduits sous forme numérique, d’autres non. D’où une profonde altération de la scène éducative. Du fait de la pandémie, je peux me réunir à un moment donné avec mes étudiants sur une plateforme numérique, et une telle plateforme peut bien avoir certaines fonctions cherchant à reproduire, au format numérique, les règles du discours qui régissent l’échange conversationnel des leçons hors ligne. L’expérience que la plupart des utilisateurs ont de ces simulacres numériques de règles conversationnelles est cependant assez aliénante. Lever la main dans ces plateformes en cliquant sur l’icône correspondante n’est pas la même chose que lever la main dans une salle de classe, un geste avec une tradition très ancienne et un sens profondément incarné ; faire taire numériquement, de façon volontaire ou involontaire, des étudiants bruyants pendant une leçon numérique a toujours quelque chose de vaguement censurant, sans parler de ces séminaires numériques dans lesquels l’enseignant seul peut parler alors que les étudiants sont confinés dans des limbes silencieux dont ils ne peuvent sortir que s’ils y sont autorisés. Pendant une vraie leçon, les étudiants sont censés rester silencieux et écouter l’enseignant mais, grâce à Dieu, ils ne sont pas obligés de le faire ; leur silence est volontaire, même à l’école primaire, ce qui signifie qu’il est le sous-produit acoustique d’un choix moral, de l’adhésion à un système de valeurs, de l’intériorisation de la croyance que, dans cet espace et dans ce temps, mieux vaut rester silencieux et écouter quelqu’un d’autre, ce quelqu’un d’autre étant l’enseignant. Sur les plateformes numériques, les étudiants peuvent certes adhérer au même credo pédagogique et rester silencieux, mais ce silence est toujours médiatisé, et donc robotisé, par l’action volontaire de couper le son de leurs microphones. Cette intermédiation du silence introduit, comme toute intermédiation, la possibilité d’un simulacre vide : les élèves sont-ils inaudibles parce qu’ils ont réellement décidé d’écouter leur professeur, ou le sont-ils parce qu’ils ont mis en sourdine l’appareil leur permettant de parler, et qu’au lieu de prêter attention au cours ils sont en train de parler à quelqu’un d’autre dans un ailleurs numérique qui est à jamais exclu de l’espace virtuel de la conversation didactique, à jamais incontrôlable par elle ? Le corps et la voix de l’enseignant s’adressent aux avatars des élèves mis en sourdine — mais pendant ce temps, où sont, derrière eux, les corps et les esprits réels ? Confiné à un visage et à une voix, incapable de se déplacer, de se lever, et même de faire des gestes sans entraves, l’enseignant parle à un vide dont le contenu humain présente la même incertitude que toute la sphère numérique. Dans le monde pré-pandémique, l’enseignant avait peur que les élèves ne prêtent pas réellement attention, il craignait cette possibilité, qui est l’échec intrinsèque de tout enseignement, raison pour laquelle une série de stratégies étaient mis en place pour exorciser cette peur. Dans le monde post-pandémique, cette crainte est devenue une panique. L’enseignant est constamment terrifié à l’idée que les élèves ne soient pas là, que ce soit parce que leurs esprits sont ailleurs, parce que leurs yeux sont ailleurs, ou même parce que leurs corps sont ailleurs. Car même leurs avatars numériques peuvent être ailleurs, perdus à cause d’une regrettable panne technique dont les effets sont toujours découverts trop tard, alors que trop de discours réels ont déjà été prononcés, prononcés au vent numérique, comme un message dans une bouteille que personne ne sera jamais en mesure de retrouver. Malgré la création d’un cadre temporel et la simulation numérique d’une interaction spatiale, l’enseignant se sent seul. Peut-être que l’élève aussi se sent seul. Ils se sentent tous les deux l’un sans l’autre. Cela se produit parce que l’espace qu’ils habitent et sont censés partager est désormais désincarné. C’est un espace qui ne peut pas transformer le temps d’enseignement en synchronicité. Certes, les avatars se réunissent tous en même temps, mais être tous en ligne, enseignants et étudiants, sur la même plateforme éducative pendant les mêmes deux heures n’équivaut pas à de la synchronicité. Il ne peut y avoir synchronicité que lorsque des corps sont physiquement convoqués en même temps dans le même espace, de sorte que ce temps devient de l’espace partagé et que cet espace devient du temps partagé. La synchronicité est en effet plus que la simultanéité. Cela signifie que, dans ces deux heures passées par un groupe d’esprits et leurs corps respectifs dans l’espace d’une salle de classe, ils sont absorbés par la même contemplation, qui est étymologiquement l’acte mental de partager un temple, d’être ravis par la pensée à la fois mentale et physique d’une résonance. Lorsque l’enseignement réussit, les esprits des élèves résonnent les uns avec les autres, et tous ensemble ils résonnent avec celui de l’enseignant ; les corps, dans cette circonstance, deviennent l’incarnation quasi mystique d’une symphonie d’esprits. Seuls les très mauvais enseignants n’ont jamais connu un tel moment dans leur vie professionnelle, et tous ceux qui en ont fait l’expérience, même une seule fois, admettront probablement qu’il constitue un sommet de satisfaction existentielle, une sorte d’extase didactique. Dans ces circonstances, les esprits de tous ceux qui sont en classe sont augmentés par leur résonance avec les autres esprits, ils en sont énergisés, ils transcendent les limites des corps pour atteindre une dimension presque surhumaine. Ce n’est cependant pas la condition surhumaine de Nietzsche, celle d’individus subjuguant d’autres individus mais l’extase sublime à travers laquelle le langage permet aux esprits humains de se projeter au-delà d’eux-mêmes, au-delà de l’espace et du temps, à travers les générations. |
|
________________ Mots clefs : enseignement, espace, intentio auctoris/operis/lectoris, numérique, sacralité, synchronicité. Auteurs cités : Gregory Bateson, Michel de Certeau, Umberto Eco, Algirdas J. Greimas. Plan : 1. Critique des pratiques générales du numérique 1.1. De la dépendance numérique à la sensibilisation numérique 1.2. L’hypertrophie numérique pendant le confinement 1.3. Le traumatisme subreptice de l’enseignement en ligne 1.4. L’urgence d’une considération sémiotique 2. La spatialité comme condition fondamentale de l’enseignement 2. 1. La centralité sémiotique de l’espace dans l’enseignement 2. 3. La spatialité de la classe en tant que matrice de rôles éducatifs 2. 4. La classe comme lieu sacré 3. Un temple numérique pour l’enseignement ? 3.1. L’intentio auctoris des lieux d’enseignement en ligne 3.2. L’intentio lectoris des lieux d’enseignement en ligne 3.3. L’intentio operis des lieux d’enseignement en ligne 4. Temporalité et actorialité d’un vivre ensemble 4.1. La temporalité partagée de l’enseignement 4.1.1. Une proxémique maladroite 4.1.2. Stratégies de distraction 4.1.3. Les dangers de l’asynchronicité 4.2. Apprendre à vivre ensemble |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |